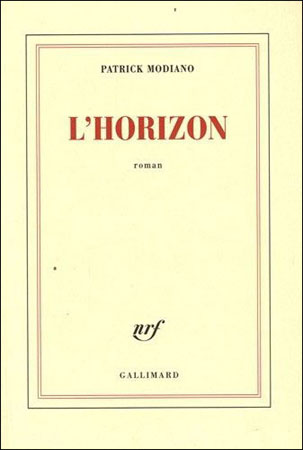 L’Horizon, Modiano
L’Horizon, ModianoL’horizon reste toujours un peu le même chez Modiano. Les lignes de fuite se recoupent souvent, très souvent, voire trop souvent. Qui connaît cet auteur ne sera pas surpris de retrouver les grandes problématiques, récurrentes : la quête d’identité, l’oubli, le passé revisité, les zones d’ombres, la femme mystérieuse,…Il y a tout cela dans ce nouveau livre, tout ça qui est pareil, dans un roman qui est tout de même nouveau.
Dès le début, le souvenir entre dans la danse ; Bosmans se remémore des bribes de son passé perdu, qui lui apparaissent comme des paillettes d’or au milieu de trous noir ; la "matière sombre", comme il l’appelle. De noms en noms, de lieux en lieux, il finit par se rappeler le plus important : Margaret Le Coz. Le Coz, ça sonne breton, et pourtant, elle est allemande cette jeune femme mystérieuse, un peu enfant, toujours fragile. Avec elle il entame une relation dont on ne saura rien, ou si peu ; un verre par-ci par-là, une attente à la sortie du travail, des sorties au parc, des visites chez des employeurs,… Une relation peut-être davantage fraternelle qu’amoureuse en tout cas.
Pour eux la vie n’est pas aisée. Elle, elle se sent tout le temps poursuivie. Un type qui s’appelle Boyaval (toujours des noms d’hommes commençant par B. d’ailleurs…), dont on ne sait pas grand-chose, mis à part sa prédilection pour le poker et la prise de risque. Lui, Bosmans, il essaie d’écrire. On ne sait trop quoi, on ne sait trop quand. En tout cas, ce qu’on nous raconte, c’est sa jeunesse, alors qu’il s’est lancé dans son premier livre. En attendant, il tient la librairie d’une maison d’édition. Des bouquins sur les sciences occultes.
Bosmans, parfois narrateur, toujours personnage, nous embarque dans ses souvenirs, à Paris, dans sa jeunesse ; vingt et un an. Il nous embarque avec lui, avec tout ce que cela implique de zones d’ombres et de points obscurs. C’est difficile de le suivre parfois, il faut jouer au détective. Cette fois il n’y en a pas dans l’économie des personnages, pas comme dans le Café de la jeunesse perdue. Il faut être attentif à chaque nom, à chaque épisode, presque à chaque mot. Des lignes de fuite, des indices sur une carte, qui mènent toutes au même horizon. Un horizon qui s’ouvre à la fin, mais un horizon de la boucle, l’horizon de Modiano. Ça se répète, mais ça n’est jamais pareil.
Bon, une chose est sure, j’ai bien aimé ce roman, parce que j’aime l’atmosphère que créé le style de cet auteur. Toutefois, elle n’était pas aussi opaque et aussi envoutante que les autres fois. Question d’habitude ? Comme un parfum capiteux et plaisant dont on perd les saveurs à force de l’humer ? Peut-être… Il m’a semblé que ce roman était plus « réaliste », davantage de l’ordre du réel que de celui du rêve. On y croit à son histoire, au point que le charme se romprait presque. Il se rattrape cependant, juste avant la chute, et la machine est relancée. C’est bien construit, mais au bord du précipice. Un funambule qui risquerait de manquer son coup… S’il continue ainsi, j’ai peur qu’un pas de trop et…
Néanmoins peut-être que c’est bien ainsi. Peut-être que cette chute imminente vers le réel, cette avancée vers l’horizon, loin de l’obscurité habituelle, montre que l’auteur, grâce à l’autofiction, s’approche de la lumière… ?
Enfin on verra bien. En tout cas ce nouveau roman n’apporte rien de bien neuf dans la galaxie Modiano. Juste un pas de plus. Un pas, ou un regard, mais vers l’horizon. N’est-ce pas l’espoir ?


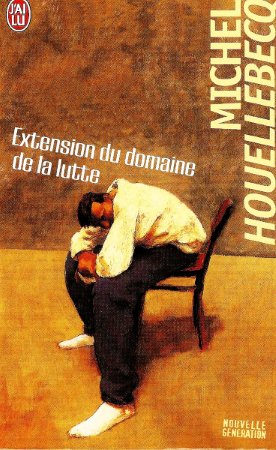 Extension du domaine de la lutte
Extension du domaine de la lutte Qui a tué Palomino Molero ? Mario Vargas Liosa
Qui a tué Palomino Molero ? Mario Vargas Liosa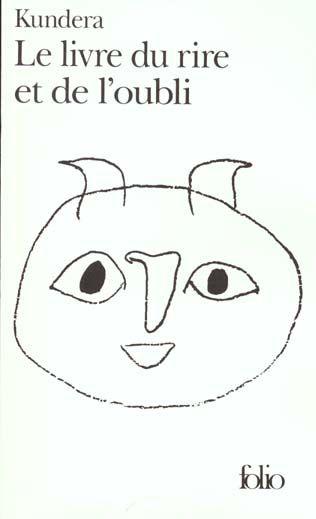 Le livre du rire et de l’oubli, Milan Kundera
Le livre du rire et de l’oubli, Milan Kundera Lent dehors, Philippe Djian
Lent dehors, Philippe Djian