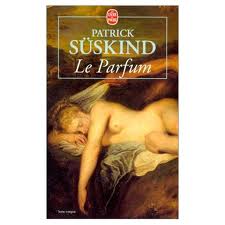 Le Parfum, Patrick Süskind
Le Parfum, Patrick SüskindJean-Baptiste Grenouille est né dans les restes de poisson et les miasmes de Paris ; rejeté par les nourrices, on le prend pour le Diable (faute d’être une grenouille de bénitier, sans mauvais jeu de mots). Pourquoi une telle stigmatisation ? Parce qu’il sent le poisson ? Non, justement ; c’est parce qu’il ne sent rien, strictement rien. Cet être plutôt laid et ingrat n’a pas d’odeur. Personne ne peut le sentir, c’est le cas de le dire. Pourtant, c’est bien ce handicap qui le rend inhumain et pourtant maléfique. Car si les autres ne peuvent pas le sentir, Grenouille lui, les sent, et à des kilomètres à la ronde. Ses narines sont les premières choses qui bougèrent en lui ; ses yeux globuleux restaient fermés alors même que ses narines palpitaient. Il sentait. Mais pas simplement une vague odeur ; il sentait toutes les odeurs alentours, capable de les distinguer toutes. Avant même de savoir lire, il possédait déjà à l’intérieur de lui un catalogue d’odeurs, plus précis que n’importe quelle encyclopédie.
Résistant à tout, aux pires maladies comme aux pires odeurs, Grenouille se forge un caractère de tique inattaquable et indestructible, prête à se laisser choir sur sa proie à la moindre occasion. Un vrai monstre aux subtiles narines ; le grotesque côtoie ici le sublime.
Sa rencontre avec Baldini est pour lui une révélation : il va pouvoir réaliser son rêve, devenir créateur de parfums. Et pas de n’importe quels parfums. Les meilleurs parfums que Paris et l’Europe aient jamais connus. Pour cela il s’inspire de tous les trésors que recèle la boutique de l’Italien, lui faisant du même coup profiter de son talent. Pourtant, un jour, Grenouille s’en va. Il en a assez de servir la magnificence d’une boutique, dont les produits esthétiques sont très éloignés, de son point de vue, de ce que peut et doit réaliser un grand parfumeur digne de ce nom. Alors il s’en va ; vers Grasse, la ville de la quintessence en matière de parfums. Mais en chemin, il prend goût à la solitude, et surtout à l’absence d’odeur qui l’accompagne. L’odeur humaine lui devient insupportable. Dès lors il trouve refuge sur une montagne, loin de toute présence humaine. Là, pendant des heures chaque jour, il s’adonne à une introspection intérieure des plus fantastiques. Il plonge en lui-même à la recherche des senteurs qui ont accompagné sa vie ; il ouvre la grande encyclopédie des odeurs et se compose un cocktail, tel Desesseintes et son orgue à bouche, à moins que ce ne soit celui de Boris Vian. Enivré, il se construit ainsi un royaume. Démiurge démoniaque mais sublime, Grenouille refait la Genèse olfactive du monde.
Malheureusement tous les rêves finissent par avoir une fin ; et quelle fin pour Grenouille ! Il se rend compte, en cauchemar, qu’il n’a pas d’odeur ; qu’il n’a pas d’odeur humaine, et encore moins qui lui soit propre. Il se rend compte qu’il ne peut plus se sentir. Alors il quitte la montagne…
…et se prend de l’idée d’user de son talent pour se créer une odeur ; une odeur humaine qui lui permette d’exister aux yeux mais surtout au nez des autres hommes. Car s’il est bien une chose que nous apprend ce texte, c’est l’importance des odeurs dans les relations humaines. Qui sent mauvais est exclu ; qui sent bon est reçu ; qui ne sent pas est invisible. Dès lors Grenouille, en grand maître des odeurs et de leur maniement, se fabrique divers parfums, telles des toilettes spécifiquement réalisées pour diverses occasions : être apprécié, susciter la pitié, être laissé tranquille, et j’en passe. A chaque odeur, une fonction. Et à chaque occasion, son odeur.
Mais j’ai oublié de parler du sous-titre de l’œuvre : Le Parfum, histoire d’un meurtrier. Si Grenouille est un génie sans odeur, son essence suprême n’en reste pas moins celle d’un meurtrier. La première de ses victimes n’est autre qu’une malheureuse jeune fille épluchant des mirabelles. Pas bien méchant me direz-vous. Et pourtant… Dès lors qu’il eut compris o combien l’odeur humaine est importante, et qu’il eut senti le parfum exquis d’une jeune vierge nubile, son unique ambition devint celle-ci : se procurer son parfum, et ce de manière sûre. Il va alors se lancer à la conquête des techniques de captures de parfums, diverses et variées, pour trouver la plus adéquate pour la réalisation de son projet. En bon criminel, ses préparatifs vont durer deux ans, pas moins. Deux ans au cours desquels il va se préparer à tuer, tuer pour exister.
Le reste je vous laisse le découvrir par vous-même. La manière dont il tue et s’emparer des âmes olfactives des donzelles est des plus artistiquement glaciale. Dénudées et scalpées, elles sont dépossédées de leur essence suprême. Bref, du grand art. Et à la fin…
Une fois découverte l’identité du meurtrier, une estrade est dressée pour son exécution. Et c’est alors que l’homme sans odeur, le gnôme ignoble, devient ce qu’il est vraiment : non pas un être doté d’une odeur des plus subtiles et des plus érotique, mais un personnage de roman. Face à la foule de ses semblables le tenant en odeur de sainteté, l’infâme Grenouille, devenu comme eux mais de manière exacerbée, devient ce qu’il est pour nous tous : un personnage de roman.
Désolée de vous gâcher le plaisir ; Grenouille n’existe pas ; ni pour nos yeux, et encore moins pour nos narines. Et pourtant, ses actes ressemblent à ceux des pires skyzophrènes… A la frontière du réel… C’est ça qui est fantastique.


 Lent dehors, Philippe Djian
Lent dehors, Philippe Djian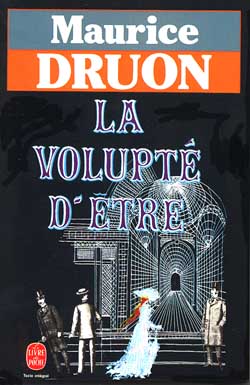 La volupté d’être, Maurice Druon
La volupté d’être, Maurice Druon L’Amour, roman, Camille Laurens
L’Amour, roman, Camille Laurens Le désert de l’amour, François Mauriac
Le désert de l’amour, François Mauriac