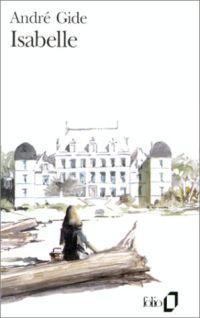« Je vous ai déjà dit que je ne suis pas gentil. Je suis très égoïste. Ce qu’il y a c’est que vous êtes un petit morceau de moi. » Il m’enlaça plus fort. « Vous êtes si douce à aimer. »
« Je vous ai déjà dit que je ne suis pas gentil. Je suis très égoïste. Ce qu’il y a c’est que vous êtes un petit morceau de moi. » Il m’enlaça plus fort. « Vous êtes si douce à aimer. » Il me reste encore une vingtaine de pages des Mandarins à lire, mais je ne peux me résoudre à l’envie de rédiger cet article. Peut-être pour retarder le moment où je devrais abandonner ces personnages, ce Paris de l’après-guerre, ces hommes et ces femmes blessés à jamais qui essaient de reconstruire le monde sur les nouvelles bases qui leur sont données. J’ai de la peine à quitter Henri surtout, l’un des deux personnages desquels ont suit les pensées, les actes, mais aussi les moments d’angoisse, de lassitude, les choix, les amours. Les chapitres pairs sont centrés sur le personnage d’Anne, par un procédé d’alternance du point de vue et de la focalisation interne. Avec Simone de Beauvoir, on n’en sait jamais plus que le personnage. C’était une loi qu’ils avaient établie avec Sartre. C’est selon moi ce qui fait le grand intérêt de ce roman, et qui fait que je me suis attachée à Henri. Journaliste et écrivain mûr, celui-ci ne peut supporter toutes les animosités suscitées par la politique, et tient à ce que son journal reste indépendant. Mais il comprend vite qu’en cette période de guerre froide, de découverte des camps, et de combat pour la suprématie, il faut agir, ou se taire. Et agir signifie prendre position. Il accepte de rallier son journal au parti de son ami Durhieu, qui ne se veut ni communiste ni gaulliste. Il continue à écrire un roman puis une pièce de théâtre, qui illustre les souffrances de la guerre. Tous ces personnages d’intellectuels ont été fortement touchés par celle-ci, dont ils gardent les séquelles. Et pour tous, il y a des peines de cœur : entre Paule qui vit pour aimer Henri d’un amour inconditionnel et qui en subira les conséquences, Nadine, la fille d’Anne, qui panse les plaies d’un amour américain fauché par la guerre, et Anne qui connaît les désillusion de l’attente, les femmes dans ce roman sont toutes des femmes blessées, blessées parce qu’elles ont choisi l’amour au prix de leur liberté.
Mais peut-on vivre sans aimer ? C’est peut-être à cette question que répond le roman. Et il semble qu’elle soit négative : chacun des personnages multiplie les liaisons, tente de trouver du réconfort dans les bras de divers hommes et diverses femmes, en pensant peut-être qu’ailleurs, c’est mieux. Mais la réalité a vite fait de rattraper le rêve. C’est ce que l’on ressent profondément en passant des chapitres qui concernent Anne à ceux centrés sur Henri. Elle voyage, aime passionnément, mais termine extrêmement déçue. Lui écrit, s’implique dans la vie intellectuelle, va jusqu’à se compromettre avant de choisir l’inaction pour un temps, et de fonder une famille. Mais le devoir l’appelle à nouveau, il ne peut rester sourd, et l’action le rattrape. La grande action du roman se situe à la fin, comme l’aboutissement de toutes les réflexions politiques de tous ces intellectuels de gauche.
Mais peut-on vivre sans aimer ? C’est peut-être à cette question que répond le roman. Et il semble qu’elle soit négative : chacun des personnages multiplie les liaisons, tente de trouver du réconfort dans les bras de divers hommes et diverses femmes, en pensant peut-être qu’ailleurs, c’est mieux. Mais la réalité a vite fait de rattraper le rêve. C’est ce que l’on ressent profondément en passant des chapitres qui concernent Anne à ceux centrés sur Henri. Elle voyage, aime passionnément, mais termine extrêmement déçue. Lui écrit, s’implique dans la vie intellectuelle, va jusqu’à se compromettre avant de choisir l’inaction pour un temps, et de fonder une famille. Mais le devoir l’appelle à nouveau, il ne peut rester sourd, et l’action le rattrape. La grande action du roman se situe à la fin, comme l’aboutissement de toutes les réflexions politiques de tous ces intellectuels de gauche.
Mon avis : Je me suis étonnée moi-même en lisant ce livre : je ne pensais pas être capable de comprendre et de m’intéresser à un livre traitant de politique. Mais c’est fait avec une telle fougue, un tel réalisme du fait que tout soit rapporté par les dialogues des personnages, qu’on s’attache à suivre ces péripéties qui sont intimement liées avec leur histoire et leurs personnalités. On apprend à connaître les personnages secondaires à travers les yeux des deux héros, qui côtoient le même monde mais en ont une vision – me semble-t-il- très différente. Peut-être Henri me touche-t-il plus dans la mesure où par sa voix, j’ai réussi à percevoir quels pouvaient être les enjeux et les responsabilités d’un intellectuel. Anne, bien qu’elle soit psychanalyste, est beaucoup plus centrée sur elle-même et ses propres histoires. A travers les aventures de ce personnage, c’est un roman dans le roman que Simone de Beauvoir nous offre dans le second tome.
Il y a bien sûr des clés dans ce roman (Simone, Sartre, Camus, Algren,…) mais ce n’est pas selon moi ce qui fait son intérêt. Je pense plutôt que c’est lié au style de l’auteur : vif, sans fioritures. C’est l’un des romans que j’ai lu le plus rapidement, et pourtant, chacun des tomes fait 500 pages. Il n’y a pas un temps mort, et les personnages évoluent au gré des évènements de la vie, de leurs rencontres, de leurs choix. On retrouve en quelque sorte la philosophie existentialiste de Sartre, et le regard que Beauvoir porte sur la femme y est acéré – surtout en ce qui concerne le personnage de Paule.
J’ai véritablement adoré ce roman. A la fin du premier tome, je n’avais qu’une hâte : rentrer chez moi et me plonger dans le second. Il est rare qu’un livre me fasse un tel effet – sauf, dans le même genre, les romans d’Aragon. Le plus étonnant est que ce roman est daté, il s’inscrit profondément dans une époque, et moi qui ne suis pas une grande historienne, j’ai tout de même compris beaucoup de choses. C’était l’histoire vécue de l’intérieur, au quotidien, par les intellectuels parisiens (les mandarins!), intermédiaires entre le pouvoir et le peuple.
Ce roman primé de Simone de Beauvoir m’avait longtemps narguée mais effrayée, dans la mesure où, en lisant des résumés, il semblait que ce soit un roman politique. Mais ce serait réduire la portée de cette fiction magistrale, qui reconstitue tout un univers. Je suis de plus en plus emballée par les œuvres de Beauvoir. J’avais littéralement avalé, digéré et inscrit dans ma peau les Mémoires d’une Jeune Fille rangée, ainsi que la Force de l’Age. J’avais poursuivi ma conquête de l’univers beauvoirien en lisant l’Invitée (un de mes romans préférés !) et récemment, les Belles Images. J’aime les romans de cet auteur car ils sont une dimension autobiographique reconnaissable – du moins pouvons nous retrouver un peu d’Anne ou d’autres de ses personnages en Simone- et que la relation qu’elle entretenait avec Sartre, ainsi que sa posture d’intellectuelle et de femme de tête, m’ont toujours fascinées, dès les premières lignes des Mémoires. Dans son écriture comme dans la vie elle ne lâche rien, elle avance, inexorablement. Castor de Guerre de Danièle Sallenave (dont je parlerais probablement dans un autre article), a été l’essai qui m’a fait redécouvrir Simone, et l’aimer davantage. Cette femme reste une des figures majeures de mon petit panthéon intérieur.
Et là je pense que je vais devoir finir le second tome… et qu’il ne me reste que peu de roman du Castor à lire…
Pourquoi ai-je lu ce livre, à ce moment là :
Je venais de terminer avec émotion Castor de Guerre, j’avais déjà cherché les Mandarins, ce chef d’œuvre primé de Simone, mais je ne l’avais pas trouvé chez les bouquinistes de ma ville (ou alors uniquement le second tome : qui donc s’amuse à n’acheter que le premier ?!). J’ai donc patienté en lisant les Belles Images et quelques autres romans (dont Incidences de Djian), et j’ai enfin trouvé les deux tomes chez mon bouquiniste préféré ! O Joie !! l’édition et la couverture me plaisait en plus – les folios des années 70, avec sur l’un une image des Deux Magots (café où elle se rendait souvent) et sur l’autre une photo de New-York, ses grattes-ciel et ses bandeaux publicitaires. Couvertures crevassées, pages jaunies, tranche pliée, auteur de vieux : toutes les conditions étaient réunies pour me faire chérir ce livre. Et à la lecture… extase ! L’objet est complet.
Je venais de terminer avec émotion Castor de Guerre, j’avais déjà cherché les Mandarins, ce chef d’œuvre primé de Simone, mais je ne l’avais pas trouvé chez les bouquinistes de ma ville (ou alors uniquement le second tome : qui donc s’amuse à n’acheter que le premier ?!). J’ai donc patienté en lisant les Belles Images et quelques autres romans (dont Incidences de Djian), et j’ai enfin trouvé les deux tomes chez mon bouquiniste préféré ! O Joie !! l’édition et la couverture me plaisait en plus – les folios des années 70, avec sur l’un une image des Deux Magots (café où elle se rendait souvent) et sur l’autre une photo de New-York, ses grattes-ciel et ses bandeaux publicitaires. Couvertures crevassées, pages jaunies, tranche pliée, auteur de vieux : toutes les conditions étaient réunies pour me faire chérir ce livre. Et à la lecture… extase ! L’objet est complet.
Ce livre a une histoire, une âme, un style, des personnages inoubliables, et me laisse des images plein la tête. Tout ce que je recherche dans un roman ! Est-il encore besoin de dire : j’aime !?
Je vais terminer cet article en vous incitant vivement à lire Simone de Beauvoir, son autobiographie mais aussi ses romans. C’est un auteur trop délaissé, à mon sens. Et c’est bien dommage. Son style est simple, efficace, et son univers pas si éloigné de nous. 

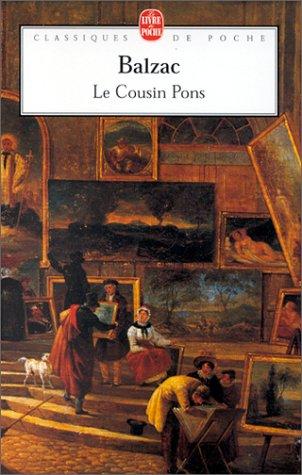 Le Cousin Pons, Balzac
Le Cousin Pons, Balzac Fort comme la mort, Maupassant
Fort comme la mort, Maupassant