 La carte et le territoire, Michel Houellebecq
La carte et le territoire, Michel HouellebecqLes œuvres d’art naissent d’une intuition. C’est ce qu’affirme le premier artiste de cet œuvre, Jed Martin. C’est peut-être, probablement, ce que ressent aussi un Michel Houellebcq devant sa table d’écriture. C’est en tout cas un peu ça, cet appel, que j’ai ressenti aujourd’hui, journée où j’ai lu, d’un trait, La carte et le territoire (non non, je ne suis pas mégalo!). Je devais le lire pour en parler ici. Et c’est ce que je vais m’efforcer de faire, sans spoiler, si possible…
Jed Martin est un artiste dont la cotte monte en flèche. Après avoir débuté dans la photographie d’objets industriels, il lui vient l’idée lumineuse de photographier des cartes Michelin. Et là, c’est la consécration. Il rencontre tout à la fois la notoriété, une femme (magnifique, logique), l’argent, le showbiss, les galeries, le grand Paris –plus ou moins-artistique. Et puis Michel Houellebecq. Il a besoin de lui pour écrire la plaquette de son expo. Bizarre ce type tout de même ; très bizarre… Il adore la charcuterie, et vit reclus en Irlande, sans voir personne. Nous sommes en 2030, quelque chose du genre. Houellebecq vieillit. Jed Martin, lui, est au sommet, mais plane encore… Il ne se rend pas trop compte de ce qui lui arrive. Il crée, et puis voilà. Ils sont un peu semblables tous les deux finalement…
Cet artiste que Houellebecq (le vrai !) met en scène dans son roman, c’est peut-être finalement un peu lui-même. Un artiste qui commence par vouloir voir ce qu’il y a au-delà des choses, au-delà de ce que l’œil voit, ce qui fait l’architecture du territoire français. La carte importe plus que le territoire. Et cet auteur, Houellebcq, qui quand même a eu le prix Goncourt, et bien que nous montre-t-il ? Peut-être ce qui se cache derrière l’image de la France, les routes sous-terraines de ce qui fait rouler les wagons du pays. L’argent, l’alcool, mais surtout les magouilles. La modernité en somme. Et comment faire entrer la modernité dans un roman ? En juxtaposant. Il fait des collages Houellebecq. Des tas de digressions, sur des sujets souvent très hétéroclites. Il paraît même qu’il aurait plagié Wikipédia… Enfin bref, le monde est entré dans le roman. Et puis pas n’importe(s) quel(s) monde(s) : celui de l’art, d’abord, et puis la France profonde, le terroir, avec à côté le showbiss (les deux se conciliant en la personne de Jean-Pierre Pernault, qui nous invite à un réveillon chez lui, ahlàlà c’est sympa la vie d’artiste quand même !), et puis le crime, la mort, enfin…
Ça brille la vie d’artiste, on rencontre des jolies femmes et tout, mais à côté de ça, il y a la vie, la vraie, avec les ruptures, les parents malades (le père de Jed, en l’occurrence), la mort, le sexe (pas trop ici d’ailleurs…)
Un jour, Jed abandonne la photo et les cartes. Il va peindre. Peindre les gens et leurs métiers. Il s’intéresse à l’humain, après s’être intéressé à son milieu de vie, à son territoire. Son travail est davantage celui d’un ethnologue que d’un commentateur politique. N’est-ce pas ce que fait Houellebecq ? Dans ce roman, qu’on (la critique comme la doxa) trouve différent des autres (je ne peux trop me prononcer là-dessus, n’ayant lu pour l’instant que les Particules Elémentaires), l’auteur fait preuve d’humanité. Il est moins cynique, plus empathique. Ce roman est presque tragique. On suit le héros dans une longue déchéance, dont toutefois il ne semble pas souffrir. On pénètre dans les lieux de demain, peut-être aussi d’aujourd’hui, des lieux glauques souvent. La vie moderne, avec eros et thanatos, comme toujours.
Et Houellebecq qui fait mourir Houellebecq ! ça c’est étonnant ! Une troisième partie est entièrement consacrée à relater sa disparition (les fameux italiques, ironiques ?), une partie aux accents policiers d’ailleurs. C’est ce qui m’a frappée dans ce roman : le foisonnement. Logique me direz-vous, c’est un roman. Oui, mais quand même. Là, c’est assez énorme. Des juxtapositions on l’a dit, mais aussi une brève histoire d’amour (sans trop de sexe, ça reste en coulisses pour une fois), des digressions quasi balzaciennes, un héros quasi balzacien mais sans beaucoup d’énergie (Lucien de Rubempré, ou presque) – un héros qui finit par dialoguer avec son chauffe-eau, c’est pas si terrible que ça… , une épopée artistique, et puis une énigme quasi policière. Avec un prologue et un épilogue. Le tout dans une langue irréprochable, tantôt soutenue, phrases longues un peu charnues, tantôt cool et presque prosaïques, à la limite du discours indirect libre. Une langue et un contenu érudit aussi, qui mêlent littérature classique, nostalgies historiques, et célébrités du PAF. Une réflexion sur l’art qui côtoie le vin (de champagne avec ses paillettes, ou rouge, Chardonnais) et le saucisson. La modernité incarnée. Est-ce pour cela qu’il a obtenu le prix Goncourt ? Parce que le monde est entré dans son livre ? peut-être… En tout cas une chose est sûre : on est happé, et on n’en sort pas. Jusqu’à la fin, un peu pathétique quand même. Bref, au Goncourt ils n’ont pas tord : un grand roman !
Mais est-ce que j'ai aimé? Je l'ai lu très vite, ça c'est certain. Après j'ai préféré certains passages à d'autres, et ai été surprise, souvent dans le bon sens. Donc oui, j'ai aimé, pas adoré, mais apprécié, surtout qu'esthétiquement, c'est assez extraordinaire!
Mais est-ce que j'ai aimé? Je l'ai lu très vite, ça c'est certain. Après j'ai préféré certains passages à d'autres, et ai été surprise, souvent dans le bon sens. Donc oui, j'ai aimé, pas adoré, mais apprécié, surtout qu'esthétiquement, c'est assez extraordinaire!


 Un roman français, Frédéric Beigbeder
Un roman français, Frédéric Beigbeder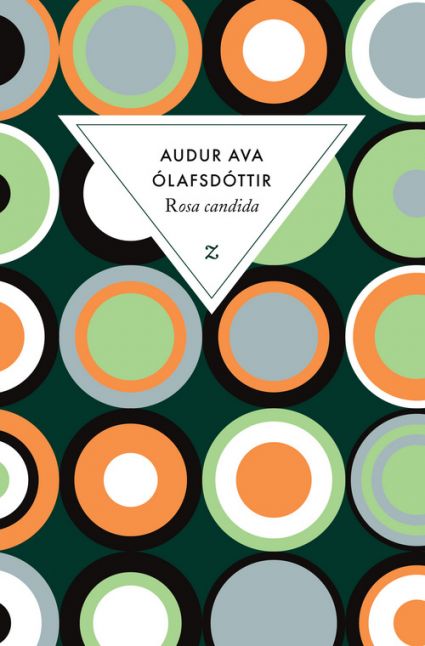 Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir
Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir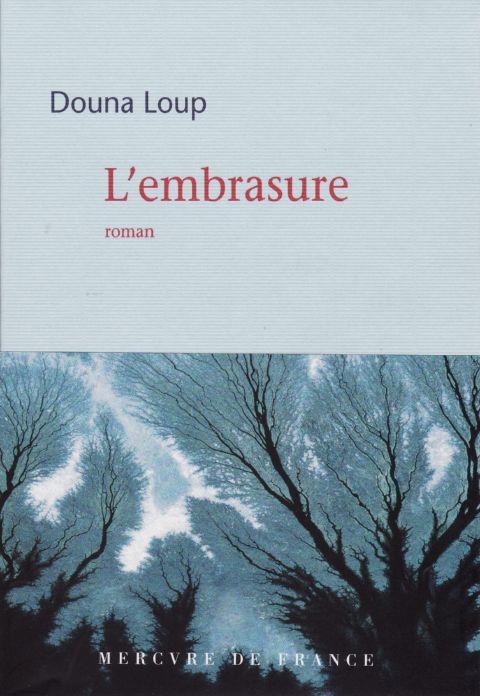 L’embrasure
L’embrasure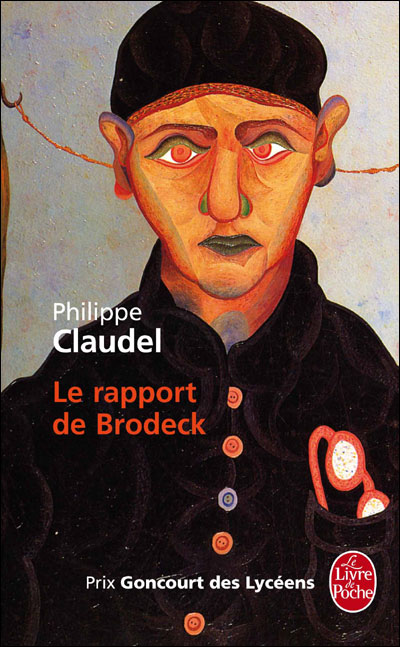 Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel
Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel