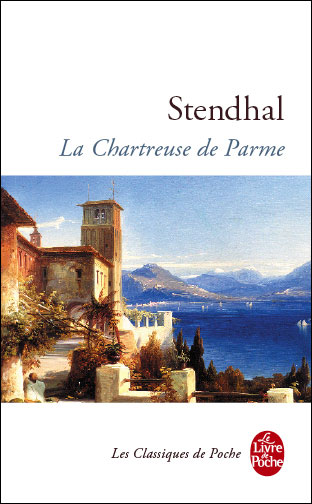 La Chartreuse de Parme, Stendhal
La Chartreuse de Parme, StendhalJe n’avais lu de Stendhal que Le Rouge et le Noir, deux fois. Une fois sans en saisir les subtilités, comme une histoire d’amour, ou des histoires d’amour, avec au milieu un passage un peu long de vie monacale… et puis une seconde fois, plus aguerrie que j’étais, capable d’en saisir certaines subtilités. J’avais également feuilleté son De l’Amour, acquis dans une brocante. Et puis j’avais acheté La Chartreuse. Des années, peut-être quatre ans, voire cinq, qu’elle (le livre, s’entend… mais le Chartreuse, je veux dire l’œuvre, est devenue une entité féminisée, le roman féminin de Stendhal, l’œuvre italienne aux puissantes épices, qui s’oppose au Rouge, le roman masculin, celui de l’ambition, de la passion… !) était dans ma bibliothèque, dans une édition commentée, pas très jolie, trop scolaire, à la couverture trop voyante. Aucun charme italien… Je l’avais commencé tout de même, parce qu’on parle si souvent de cette bataille de Waterloo, fameuse parce que Fabrice, dont on suit le regard, ne voit rien… Etrange d’établir la postérité universitaire d’une œuvre sur un épisode qui ne raconte rien, à part l’incompréhension du héros… Maintenant que je suis arrivée à la moitié du roman, au seuil du second livre, je comprends des choses ; et j’ai pitié de Fabrice. Franchement, Stendhal ne le ménage pas le pauvre, surtout au début. Et c’est là qu’on découvre que La Chartreuse, c’est drôle. Vraiment drôle. Bourré d’ironie, mais une ironie saisissable. Il ne faut juste pas prendre le texte au sérieux. Ou plutôt si, le prendre à la lettre, et voir que vraiment, c’est ironique. En dépassant l’aridité présumée du texte, en étant attentif aux détails qui finalement font tout – fi dates, lieux, considérations politiques, fi, fi ! Faisons comme Gracq, voyageons en stendhalie, avec dans l’idée qu’un roman, c’est de la fiction gratuite, sans visée didactique, sans vérité cachée- juste le plaisir de lire des aventures enrobées dans de beaux mots. (nb : il ne s'agirait tou de même pas d'occulter une lecture possible du roman comme une version de la chute de Napoléon, ou encore une satyre possible de la Cour italienne en 1820... Mais je reste dubitative, et suit Gracq!)
Et quelles aventures ! Gina d’abord, la tante du héros. Une vraie briseuse de cœurs. Et Fabrice Del Dongo alors, un jeune homme de dix-sept ans un peu niais, qui croit avoir lu dans le ciel l’appel de Napoléon – un aigle chassant une souris, probablement…- et s’est enrôlé dans l’armée. S’ensuit Waterloo – je n’y reviens pas…-, épisodes vraiment drôles, conseils tous azimuts, apprentissage sur le tas, bref, une campagne militaire comme on en a jamais vue. D’ailleurs on ne voit pas Napoléon. Normal me direz-vous, puisque Fabrice ne voit rien, et qu’on est en focalisation interne (ahah il fallait bien la placer celle-là !). Mais vraiment, cette fois, j’arrête sur le sujet, promis.
Fabrice, de retour auprès de sa mère et de sa tante devenue veuve, manque de se faire arrêter pour être sorti du pays sans passeport. Il s’exile. Pendant ce temps – Stendhal est le spécialiste des sauts dans le temps, qui déroutent un peu le lecteur, mais qui font son charme, j’y reviendrai- Gina a trouvé en la personne du conte Mosca un parfait amant (il est ministre de la police et des finances à Parme). Elle épouse un vieillard riche pour s’assurer une place à la cour de Parme (d’où son nom resté dans les annales, la Sanseverina – nom du vieillard en fait), où elle est accueillie à bras ouverts, et est rapidement considérée comme l’une de ses plus belles femmes – si ce n’est la plus belle.
Fabrice revient, repart trois ans en formation cléricale, revient à Parme, vit sa vie de jeune homme, rend jaloux Mosca, fait tressaillir le cœur de plus d’une femme, plus que jamais défaillir celui de la Sanseverina (sa tante, certes…). Il évolue, n’est plus le jeune candide du début, quoi que… Il vit de multiples aventures, celles d’un don juan le plus souvent. Pourtant, et c’est là que réside tout l’intérêt du personnage, Fabrice se croit incapable d’amour.
Mais n’est ce pas une chose bien plaisante, se disait-il quelques fois, que je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu’ils appellent de l’amour ? Parmi les liaisons que le hasard m’a données à Novare ou à Naples, ai-je jamais rencontré de femme dont la présence, même dans les premiers jours, fût pour moi préférable à une promenade sur un joli cheval inconnu ? Ce qu’on appelle amour, ajoutait-il, serait-ce donc encore un mensonge ? J’aime, sans doute, comme j’ai bon appétit à six heures ! Serait-ce cette propension quelque peu vulgaire dont ces menteurs auraient fait l’amour d’Othello, l’amour de Tancrède ? ou bien faut-il croire que je suis organisé autrement que les autres hommes ? Mon âme manquerait d’une passion, pourquoi cela ? Ce serait une singulière destinée…
Je vous laisse goûter toute l’ironie que l’on sent pointer de la part du romancier, qui prête sa plume aux paroles du bellâtre. Et tous les clins d’œil qu’il jette au lecteur. On se doute bien qu’un héros qui aurait une telle destinée ne saurait survivre encore 250 pages, les 250 pages qu’il reste du roman et constituent le second livre, et que je vais m’empresser d’aller lire !
S’empresser, c’est bien le mot. Parce que dans la Chartreuse, les épisodes s’enchaînent, se succèdent, se mêlant et se démêlant aussi vite. Toutefois, rien n'est bâclé, tout ce qui était possible semble réalisé, écrit, posé. Des péripéties, de nouveaux protagonistes, des déguisements et des identités diverses pour Fabrice, des hommes amourachés pour la Sanseverina, la jalousie galopante de Mosca… Peu de moment de pose, d’exploration de l’intériorité, de « tempête sous le crâne » (le mot est de Gracq, peut-être même de Stendhal lui-même) comme dans le Rouge et le Noir (je pense par exemple à la scène où Julien se fait un devoir de prendre la main de Madame de Rênal). Parfois des moments de contemplations, mais souvent, très souvent, de l’action. Et malgré tout, j’aime. J’aime parce que c’est puissant, un torrent bouillonnant mais plaisant. Et puis les personnages sont attachants, il tarde de savoir ce qui va leur arriver, quelle nouvelle aventure ils vont vivre. Les épisodes s’enchaînent avec une telle frénésie qu’on se demande si Stendhal n’écrirait pas au grès de ses folies.
Toute empressée que j’étais d’écrire, je n’ai pu attendre la fin. L’empressement de la plume serait contagieuse…
A bientôt pour la suite !


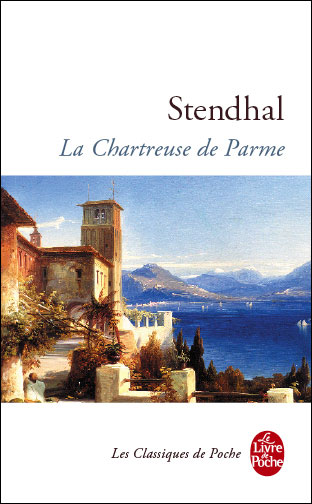 La Chartreuse de Parme
La Chartreuse de Parme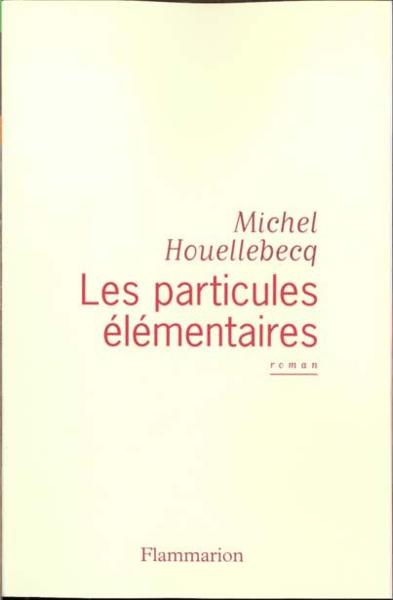 Les particules élémentaires
Les particules élémentaires La machine infernale
La machine infernale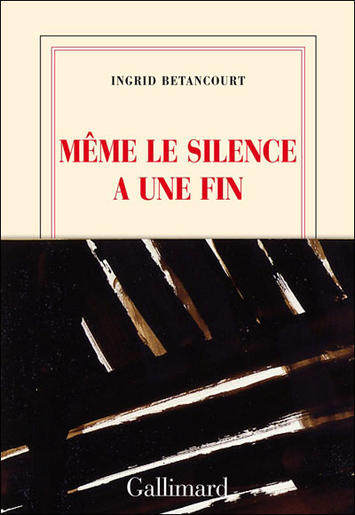 Même le silence a une fin
Même le silence a une fin