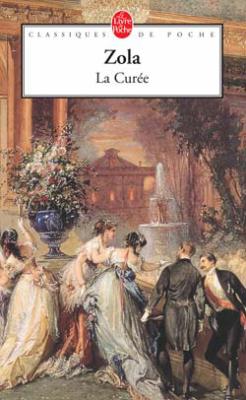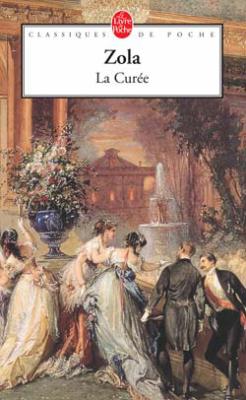
La Curée, Zola
« La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte » ; Phèdre aime donc son beau-fils, et c’est pas éthique. L’inceste est prohibée, refusée, honnie. Un peuple qui la tolère n’est pas digne de ce titre. Une société n’existe que quand l’inceste, lui, n’existe pas. Pourtant, dans le royaume de Thésée, comme dans celui de Saccard, l’inceste sévi, sans que le peuple en soit éradiqué.
Certes Renée n’est pas la mère de Maxime. Elle n’est que la jeune épouse de son père. Mais tout de même, la grande histoire des dieux et des déesses se reproduit à l’échelle humaine du tout Paris. Comme Phèdre tombée amoureuse de son beau-fils, Renée succombe au charme du jeune Maxime, un blondin efféminé et peu viril, mais plein de volupté et d’espièglerie.
Dans le Paris de Napoléon III, alors que tout change et se transforme, que les travaux s’organisent pour donner à la ville un ton de modernité (époque du baron Haussman), Aristide Saccard, venu de Plassant, cherche par tous les moyens à faire fortune (passion du gain hérité de sa mère). A l’origine, Saccard, ce n’est pas son vrai nom. En réalité, c’est un Rougon. Il est le frère d’Eugène, célèbre avoué de la capitale (et héros du roman éponyme, Son excellence Eugène Rougon). Pour se lancer dans la ville dorée sur laquelle pleuvent les louis d’or, ce vieux malin, après la mort de sa première femme, trouve une parade, grâce à sa sœur Léonie, instigatrice hors-pair : épouser la fille d’un riche bourgeois, engrossée à sa sortie du couvent par un homme qu’elle connaissait à peine, Renée. Grâce à la dot de cette dernière, il pourra lancer son trafic et se faire un nom dans la spéculation immobilière.
Grâce à l’argent de son mari, Renée va pouvoir mener un train de vie brillant, frivole, plein de dépenses diverses, de bals, de toilettes, de chichis et de chiffons. Elle s’étourdit au milieu de toutes ces frivolités offertes par la vie parisienne mais en réalité, elle s’ennuie. Elle s’ennuie à mourir dans cette ville où rien de neuf ne s’offre à elle, où elle connaît tout le monde et où tout le monde la connaît. Elle organise des dîners bien sages, des sorties au bois, des causeries à bailler. A trente ans, fleur de l’âge de la femme, elle a l’impression d’avoir tout vu. Cette femme un peu masculine, qui porte un binocle, un binocle d’homme, et a une face de garçon impertinent, ressent quelque chose comme du spleen et de l’engourdissement romantique. Elle regarde les paysages dans une attitude rêveuse et pensive qui n’est pas selon moi sans rappeler un Lamartine. Elle s’ennuie… Et souhaiterait vivre quelque chose de fort, de grand, quelque chose qui lui fasse battre le cœur et lui échauffe les sangs.
Renée, fille d’honnêtes bourgeois, est victime du milieu dans lequel elle évolue et qui lui insuffle le besoin de s’engager dans de vertigineuses dépenses. Toutefois cela ne la désennuie pas ; elle cherche l’aventure. Elle va finalement la trouver dans les bras de Maxime, son beau-fils, un chérubin qui revient du pensionnat à l’âge de treize ans, et dont elle commence par s’occuper comme elle l’aurait fait d’une poupée. Elle va jusqu’à le déguiser en fille et le faire participer aux causeries qu’elle organise dans ses salons (Maxime a bien quelque chose du Chérubin de Beaumarchais que la comtesse déguise en femme pour qu’il se fasse passer pour elle, et qui d’ailleurs est amoureux de celle-ci, une femme mûre). Ce compagnonnage bon enfant continue jusqu’au jour où Renée réalise que ce petit garçon blondinet est devenu un séduisant jeune homme, auquel les jeunes aristocrates ne résistent guère. Dès lors les moments passés tous les deux deviennent des instants de séduction sensuels et gauches, jusqu’à ce que Maxime s’enhardisse à embrasser sa belle-mère. A partir de cet instant, rien ne fut plus pareil entre les deux jeunes gens (plus ou moins jeunes cependant !) : ce ne sont alors plus que cavalcades, rencontres sensuelles et étreintes voluptueuses dans les appartements de Renée, loin de tous soupçons de la part du père Saccard. Lui ne venait voir sa femme que pour régler des questions d’argent. Le thème de la sensualité est fortement présent dans ce roman, avec de nombreuses descriptions florales, petits paradis sauvages reconstitués, de serres moites et odorantes. Il y a d’ailleurs la description d’un lieu qui préfigure peut-être le Paradou de La Faute de l’Abbé Mouret : une espèce de serre ou de véranda installée sur le toit de la maison d’enfance de Renée, où celle-ci et sa sœur Christine allaient jouer et s’enivrer des rayons du soleil. Un lieu exceptionnel.
Dans cette maison morte, dans ce cloître, il y avait un nid chaud et vibrant, un trou de soleil et de gaieté, un coin d’adorable enfance, de grand air, de lumière large. Il fallait monter une foule de petits escaliers, filer le long de dix à douze corridors, redescendre, remonter encore, faire un véritable voyage, et l’on arrivait enfin à une vaste chambre, à une sorte de belvédère bâti sur le toit, derrière l’hôtel, au-dessus du quai de Béthune. Elle était en plein midi. La fenêtre s’ouvrait si grande, que le ciel, avec tous ses rayons, tout son air, tout son bleu, semblait y entrer. Perchée comme un pigeonnier, elle avait de longues caisses de fleurs, une immense volière, et pas un meuble. On avait simplement étalé une natte sur le carreau. C’était « chambre des enfants ».
Ce lieu a prédisposé Renée à la sensualité. Mais c’est avec Maxime, dans les appartements de son hôtel particulier, qu’elle en goûte les plus enivrants plaisirs, mêlant aux suavités florales la perversité du travestissement.
Ils eurent une nuit d’amour fou. Renée était l’homme, la volonté passionnée et agissante. Maxime subissait. Cet être neutre, blond et joli, frappé dès l’enfance dans sa virilité, devenait, aux bras curieux de la jeune femme, une grande fille, avec ses membres épilés, ses maigreurs gracieuses d’éphèbe romain. Il semblait né et grandi pour une perversion de la volupté. […] Et c’était surtout dans la serre que Renée était l’homme. La nuit ardente qu’ils y passèrent fut suivie de plusieurs autres. la serre aimait, brûlait avec eux. Dans l’air alourdi, dans la clarté blanchâtre de la lune, ils voyaient le monde étrange des plantes qui les entouraient se mouvoir confusément, échanger des étreintes. La peau d’ours noir tenait toute l’allée. A leurs pieds, le bassin fumait, plein d’un grouillement, d’un entrelacement épais de racines, tandis que l’étoile rose des Nymphéa s’ouvrait, à fleur d’eau, comme un corsage de vierge, et que les Tornélia laissaient pendre leurs broussailles, pareilles à des chevelures de néréides pâmées.
La nature domestiquée, les plantes grasses, orientales, aux parfums violents et aux couleurs exubérantes sont synonymes de sensualité, de volupté, de plaisirs charnels.
Les appétits ont également une place importante dans ce roman (comme toujours chez Zola). Dans le premier chapitre (incipit in medias res, on entre dans le feu de l’action, et l’origine des personnages ne nous est expliquée que plus tard, dans les chapitres suivants), on assiste à un dîner, mondain et fort policé. Les invités ne parlent qu’argent, bâtiments, spéculations, immobilier, travaux. Mais a la fin du roman, dans l’avant dernier chapitre, après le spectacle de théâtre mettant en scène Narcisse et Echo (Maxime est Narcisse, Renée Echo, bien entendu), les appétits se débrident, les aristocrates deviennent des chiens avides et affamés se jetant sur le buffet, telle une meute à laquelle on vient de donner les abats de la chasse : une curée. (curée vient du mot cor en Ancien Français, qui désigne le cœur. Le cœur et les poumons étaient les parties du cerf que l’on donnait aux chiens à l’issue de la chasse.) Renée est également comme donnée en pâture à son mari et à Maxime, et aux hommes en général. Un peu naïve et sensuelle, elle se laisse guider, souvent, par ses désirs.
Maxime, bien qu’il l’aime profondément, n’est pas passionné, et ne rechigne pas quand son père lui demande d’épouser Louise, une jeune fille de bonne famille, mariage qui sera profitable à ses affaires. L’ambition des hommes dans le roman est l’argent, l’or. Renée, elle, représente la chair. La chair qu’on aime, qu’on désire, ou qu’on dévore. Renée, prénom mixte, rime également avec « curée ». Zola avait d’ailleurs résumé son roman en ce groupe binaire : l’or et la chair.
Zola est dur avec le personnage de Renée. A la fin du roman, celle-ci, esseulée, meurt d’une méningite. Les derniers mots du romancier à son égard concernent ses dettes : La note de Worms (le couturier) se montait à deux-cent-cinquante-sept-mille francs. Pauvre femme… mise en pâture par tous les hommes… peut-être parce qu’elle leur ressemble…
Pour finir, la scène de première rencontre entre Maxime et Renée.
Un domestique venait de l’amener de la gare, et il était dans le grand salon, ravi par l’or de l’ameublement et du plafond, profondément heureux de ce luxe au milieu duquel il allait vivre, lorsque Renée, qui revenait de chez son tailleur, entra comme un coup de vent. Elle jeta son chapeau et le bournous blanc qu’elle avait mis sur ses épaules pour se protéger contre le froid déjà vif. Elle apparut à Maxime, stupéfait d’admiration, dans tout l’éclat de son merveilleux costume. L’enfant la crut déguisée. […] Quand Renée aperçut Maxime : - C’est le petit, n’est-ce pas ? demanda-t-elle au domestique, surprise de le voir aussi grand qu’elle. L’enfant la dévorait du regard. Cette dame si blanche de peau, dont on apercevait la poitrine dans l’entrebâillement d’une chemisette plissée, cette apparition brusque et charmante, avec sa coiffure haute, ses fines mains gantées, ses petites bottes d’homme dont les talons pointus s’enfonçaient dans le tapis, le ravissaient, lui semblaient la bonne fée de cet appartement tiède et doré.
« Ce fut comme une apparition », sans mauvais pastiche. La grâce d’une femme déguisée, un peu masculine, pleine de grâce et voluptueuse ; une apparition de chaire dans un carcan doré. Or et chair.
Un roman que j’ai vraiment aimé, et peut-être même plus que cela. Je crois même que je l’ai préféré à Nana, mon Zola favori. Exceptés les passages concernant la spéculation, c’est une fresque du Paris frivole et dépensier des plus colorée et vivante. Parfois, on aurait cru du Balzac. Bref, une très belle surprise. Toutefois, ce n’est peut-être pas le roman qui illustre le mieux la théorie de Zola, dans la mesure où le personnage principal, Renée, ne subit pas directement l’hérédité, n’étant pas une Rougon ou une Macquart. Elle, elle est une victime du milieu.
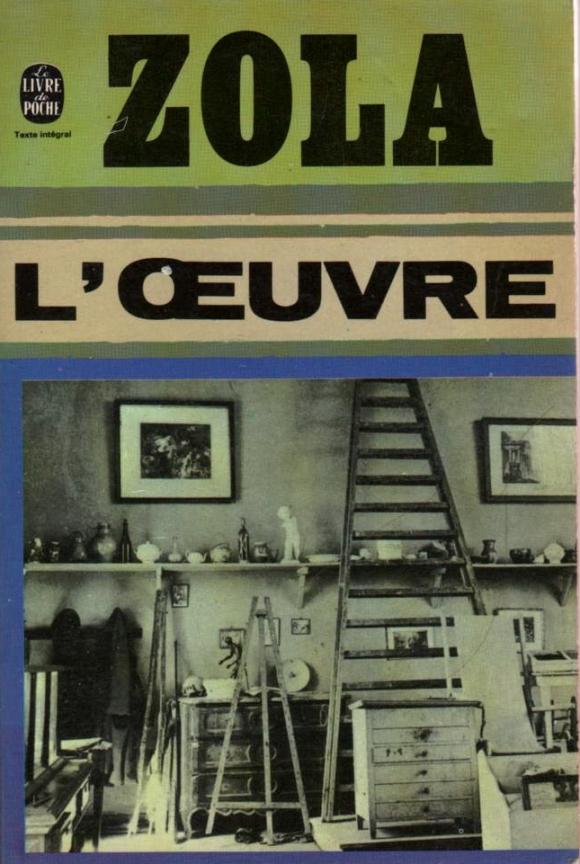 L’Oeuvre, Emile Zola
L’Oeuvre, Emile Zola