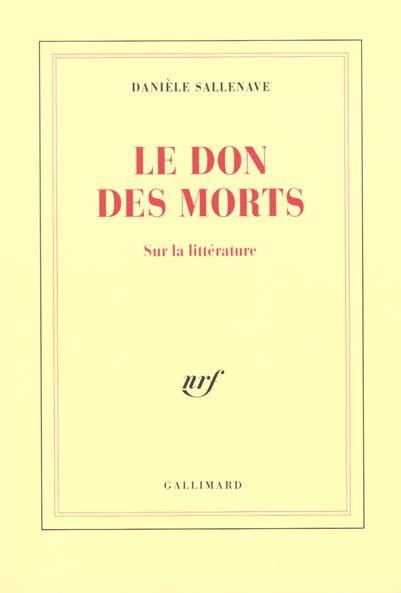 Le Don des Morts, Danièle Sallenave
Le Don des Morts, Danièle SallenaveL’essai de Danièle Sallenave s’ouvre sur la ville ; un panorama désarmant, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Une ville, des livres, des petits faits, un bruissement d’aile, un coucher de soleil. Et puis on comprend : Car les villes et la ville ne font qu’un ; ils imposent au désordre du monde l’ordre d’une lecture possible.
Les villes étaient la forme supérieure de l’existence humaine, car, pour être homme pleinement, il faut naître à la vie de l’esprit ; et la vie de l’esprit ne s’épanouit pleinement que dans les villes.
Dans une sorte d’ouverture d’opéra, une peinture poétique de la ville ancienne et nouvelle, l’auteur pose les jalons de ce monde dans lequel il ne faudrait qu’un livre. Mais un livre pour faire quoi ? C’est ce qu’elle va nous présenter par la suite…
Encore une déroute : la description d’une photo… mais où est la réflexion sur les livres ? Où sont les livres ? Attend, patience, semble dire l’auteur.
Et encore une fois, on comprend. Un monde sans livres. Voilà ce qu’elle nous présente. Une vie ordinaire, télé, Elle et supermarché. Une vie ordinaire, amputée.
Qu’est-ce que la vie ordinaire ? Qu’est-ce qui manque à la vie ordinaire ? L’argent, les honneurs, la belle vie ? Ou encore, la culture, les voyages ? Non, ce n’est pas l’argent (il y a des gens riches qui mènent une vie ordinaire), non ce n’est pas la culture (il y a des gens cultivés qui mènent une vie ordinaire). C’est la pensée, ce sont les livres : la pensée, le rêve, la connaissance du monde, et l’expérience élargie, grâce aux livres, à la littérature, à la poésie, à la fiction. Ce qui définit la vie ordinaire, ce qui fait le malheur de la vie ordinaire, ce qui fait, de la vie ordinaire, une vie mutilée, c’est que les livres y manquent, le savoir qui passe par les livres […] ; la douleur qui passe par les livres, l’expérience, l’émotion, la compréhension du monde qui passent par les livres, mais surtout par le roman et le poème, la fiction littéraire.
Pas de livre, pas de pensée ? Non pas. Car le roman n’élabore pas de lois.
Tout ce monde pense, réfléchit, calcule ; mais pense sans armes ; calcule sans le secours des mots ; réfléchit sans le recours des livres.
Penser, c’est peser. Si l’effet de la littérature est de dévoiler le monde, ce dévoilement lui-même n’a d’autre fin que de nous permettre de juger, afin de nous aider à nous conduire.
Pour la suite, l’auteur parle mieux que moi :
Le but de la fréquentation du livre, le résultat de la fréquentation des livres, et des œuvres de l’esprit inscrites dans les livres, ce ne serait pas de rompre avec la vie ordinaire, ce serait de la transfigurer. Par le livre, on n’échappe pas à la vie ordinaire : on porte celle-ci à un niveau supérieur. Elle s’éclaire, elle est revisitée.
Ce livre, encore une fois, bouleverse, déstabilise. Elle met à bas les préjugés, montre que lire est vital, non pas pour réussir, non pas pour parvenir, mais simplement pour vivre. Pour donner une consistance au monde, le sauver de l’ordinaire, de la routine, des loisirs. Car le livre n’est pas un objet culturel, ni un loisir. C’est plus que cela.
On a donc à la fois tort et raison de dire qu’on s’évade lorsqu’on lit. Car on s’évade alors du monde non pour le quitter, mais pour le rejoindre.
Toute chose racontée était une chose sauvée…[…]
Lire permet d’échapper au mensonge, à la fausseté du monde.
Une vérité existait sans doute dans le monde, il fallait la chercher […]. Cette vérité, il revenait à la littérature de la dévoiler.
Et tout simplement…
Le livre est le lieu de l’arrachement à soi et de l’ouverture au monde. Lire permet l’altérité, ouvre au monde et aux autres. Et lire permet le monde.
Lire un livre, c’est achever de l’écrire, non en lui apportant un complément de sens, ou une interprétation personnelle, mais en lui fournissant le secours de notre monde propre pour qu’il s’incarne.
Si la lecture permet l’incarnation du monde, le personnage permet la carnation de l’homme. Au contact de tous les héros de roman, on peut mieux se comprendre soi-même. On devient autre par la médiation du personnage, mais autre pour devenir soi-même. Grâce à la fiction, chacun porte une tête multiple sur ses épaules.
Cette importance de la lecture est illustrée par un chapitre émouvant sur l’Europe de l’Est, au temps de l’oppression. Pas de loisirs, pas de télé, pas d’ennuie ; de la peur, et puis, surtout, pour survivre, des livres. La crainte est que ce besoin des livres, cette nécessité des livres soit oubliée avec la fusion de l’Europe de l’Est et de l’Europe de l’Ouest...
Et puis la fin ; la fin sur le revers de la médaille du bonheur de lire. La mélancolie. La mélancolie qui naît, à la suite d’un seuil, de la dépréciation de soi liée à notre culpabilité de survivre. C’est nous qui avons trahi les morts en les abandonnant à la mort. Or ici, la seule issue est le pardon. Et où peut-on obtenir ce pardon ? Dans la littérature. Parce que ce tribunal, note Danièle Sallenave, c’est la littérature. Le sentiment de mélancolie se transforme en puissance de création.
Faire redire aux morts rajeunis leurs passions interrompues.
Baudelaire
Baudelaire
Voilà ce que je pouvais dire sur cet essai. J’aurais voulu tout recopier, tout dire. Tout est passionnant, éclairant. Même si la pensée de l’auteur est parfois difficile à suivre parce qu’anti-dogmatique. Elle bouscule la doxa, et met des mots sur ce que tout lecteur ressent : la nécessité des livres dans la vie, pour vivre pleinement.
Un essai passionnant.


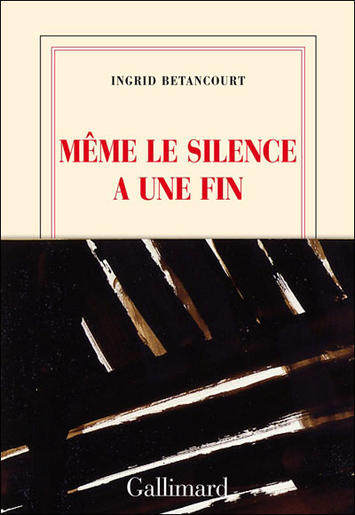 Même le silence a une fin
Même le silence a une fin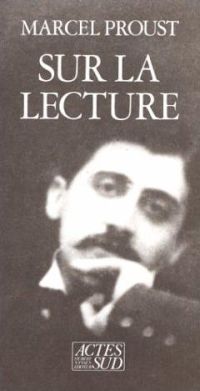 Sur la lecture
Sur la lecture