Encore un roman de Djian au titre comportant le préfixe "in" (lire "UN" dans le titre de l'article). Après ma lecture d'Incidences, qui m'a fait découvrir cet auteur que j'admire, après Impardonnables par lequel j'ai été conquise, voici Impuretés, deuxième titre à la dimension clairement déceptive.
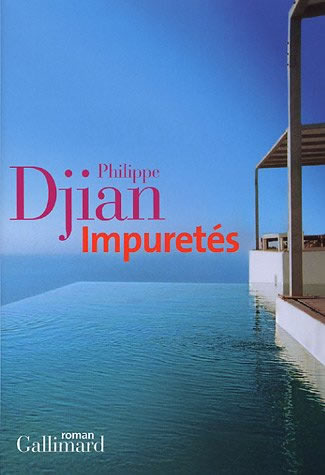 Impuretés, Djian
Impuretés, DjianImpureté, n.f : 1.Etat de ce qui est impur, souillé, altéré, pollué. 2.Ce qui salit, altère quelque chose. 3. Litt.ou vieilli. Acte impur, contraire à la chasteté. 4. Religieux. Souillure attachée à certains actes ou états
... la définition que propose le Petit Larousse Illustré.
Toutes les sortes d’impuretés se retrouvent dans le roman de Djian. Le lac à jamais symbole de la mort de Lisa. Les stigmates de la destruction que cet ouragan a provoqué dans la famille d' Evy, chez ses amis, dans son cœur. Les souillures du sexe dans un monde où tout le monde couche avec tout le monde, à tout âge. Tous ces actes indécents, avilissants, dégradants, contraires à la chasteté. Ajoutons à cela la drogue et l’alcool. Et puis la violence. Violence verbale, parfois physique. Les souffrances qu’on inflige à autrui mais également à soi. L’absence de communication entre Evy et ses parents. Ce deuil qui tarde, et est sans cesse alourdit, entaché, comme l’image de Lisa.
Seul le style semble échapper à la souillure. L’écriture est pure, magistrale. Les phrases sont incisives, tranchantes, profondes, comme d’habitude. Toutefois, elles sont le reflet du monde dans lequel évoluent ces starlettes de cinéma. Du papier glacé moucheté de taches. La beauté de l’art qui côtoie les excès de la drogue, du sexe et de l’alcool. Tout cela sent le souffre, et tout le monde souffre. Le style mime la souillure de la plus pure des façons.
... la définition que propose le Petit Larousse Illustré.
Toutes les sortes d’impuretés se retrouvent dans le roman de Djian. Le lac à jamais symbole de la mort de Lisa. Les stigmates de la destruction que cet ouragan a provoqué dans la famille d' Evy, chez ses amis, dans son cœur. Les souillures du sexe dans un monde où tout le monde couche avec tout le monde, à tout âge. Tous ces actes indécents, avilissants, dégradants, contraires à la chasteté. Ajoutons à cela la drogue et l’alcool. Et puis la violence. Violence verbale, parfois physique. Les souffrances qu’on inflige à autrui mais également à soi. L’absence de communication entre Evy et ses parents. Ce deuil qui tarde, et est sans cesse alourdit, entaché, comme l’image de Lisa.
Seul le style semble échapper à la souillure. L’écriture est pure, magistrale. Les phrases sont incisives, tranchantes, profondes, comme d’habitude. Toutefois, elles sont le reflet du monde dans lequel évoluent ces starlettes de cinéma. Du papier glacé moucheté de taches. La beauté de l’art qui côtoie les excès de la drogue, du sexe et de l’alcool. Tout cela sent le souffre, et tout le monde souffre. Le style mime la souillure de la plus pure des façons.
Quand il n’était pas question de photos, il s’agissait d’autre chose, de n’importe quoi, de tout ce qui leur passait par la tête et de tout ce qui leur tombait sous la main. Parfois, ils versaient une pelletée de verre dans leur pantalon. Ou ils tombaient des arbres. Ou ils se jetaient d’un pont. Ou ils saccageaient des tombes. Il n’y avait aucun frein à leur imagination, aucune limite.
Les enfants sont les premières victimes des affres de leurs parents. Victimes indirectes, puisque mal aimés, mal éduqués, livrés à eux-mêmes. Les élèves de Brillantmont sont tous à fourrer dans le même sac. Sur cette colline où poussent les maisons de milliardaires, dans ce lycée pour gosses de riches, tout paraît briller, reluire, mais si l’on gratte un peu, on découvre que chacun renferme un drame déchaînant des douleurs d’une puissance inimaginable.
André se demandait comment ce garçon parvenait à garder son équilibre mental dans un environnement pareil. Le fruit ne semblait pas encore gâté, mais une espèce de tempête rugissait autour de lui, qui pouvait le frapper et l’emporter à tout moment si l’on n’y prenait pas garde.
Néanmoins, en dépit de ce marasme vers lequel il est entraîné, malgré toutes ces souillures dont son corps et son esprit sont à jamais marqués, Evy va rêver d’amour. A 14 ans, il a tout vécu, tout, même ce qu’on n’imagine pas ; mais pas encore l’amour. Il rêve d'une relation pure... Mais la pureté, dans ce monde, est-elle encore envisageable?
Un roman très dur, le thème de la déchéance dans le luxe étant traité de manière percutante, poignante. Tout ce qui se passe est presque inimaginable. Du très grand Djian, même si la lecture reste difficile, puisque tout est noir, et tout va de mal en pis. On se demande quand est-ce que les souffrances prendront fin...
Bref résumé : Evy a 14 ans ; son père et sa mère sont respectivement écrivain et actrice. Lui est un ancien junkie; elle une belle femme prête à tout. La naissance de deux enfants semble les avoir ramenés à la vie. Et puis survient la mort ; la mort de Lisa. Accident, overdose, suicide ou même le pire, meurtre ? Quoi qu’il en soit, la souffrance est là, gigantesque, titanesque et destructrice. Tout sombre à nouveau, tout se délie. La fratrie, la famille, tout s’est dissout; des impuretés dans un lac. Alors qu’ils auraient tellement besoin de cohésion, la souffrance des uns augmente celle des autres, dans une spirale sans fin…
Reprendre pied dans cette vie semblait parfois vraiment la chose la plus stupide à faire.
Du pur Djian. Un roman noir, cynique à souhait, ironique aussi (rien que la couverture...), ce qui peut prêter à rire, du moins sourire... Mais je n'ai pas souri, impossible. A chaque nouveau drame, mes yeux étaient exorbités. Des excès qui peuvent faire sourire, mais pas moi, pas aujourd'hui.
Des suggestions, des coupures – dans tous les sens du terme-, un texte blessé qui demande la plus grande attention au lecteur, la plus grande acuité. Un narrateur inconnu, qui dit "je", mais n’est pas acteur du drame. Des thèmes chers à l’auteur : le sexe, la folie, la passion (37,2°), l’inceste (Incidences), les blessures de l’enfance. Dur… mais traités avec brio. On est ému, révolté, touché, offusqué. On ne comprend pas pourquoi le sort semble ainsi s’acharner. Très puissant. Une réalité sous les apparences qui fait froid dans le dos, mais des protagonistes dont on a du mal à se séparer.
Et comme souvent, très souvent chez Djian (et c'est beaucoup pour ça que je l'apprécie tant), l'un des personnages est écrivain. Un écrivain dont la carrière décline et se brise en l'occurence. Pour le plaisir, un extrait d'un passage concernant l'écriture romanesque, qu'on sent autobiographique...
Des suggestions, des coupures – dans tous les sens du terme-, un texte blessé qui demande la plus grande attention au lecteur, la plus grande acuité. Un narrateur inconnu, qui dit "je", mais n’est pas acteur du drame. Des thèmes chers à l’auteur : le sexe, la folie, la passion (37,2°), l’inceste (Incidences), les blessures de l’enfance. Dur… mais traités avec brio. On est ému, révolté, touché, offusqué. On ne comprend pas pourquoi le sort semble ainsi s’acharner. Très puissant. Une réalité sous les apparences qui fait froid dans le dos, mais des protagonistes dont on a du mal à se séparer.
Et comme souvent, très souvent chez Djian (et c'est beaucoup pour ça que je l'apprécie tant), l'un des personnages est écrivain. Un écrivain dont la carrière décline et se brise en l'occurence. Pour le plaisir, un extrait d'un passage concernant l'écriture romanesque, qu'on sent autobiographique...
Il y avait tellement de choses à dire sur l’écriture, sur l’attention constante qu’il fallait porter au rythme, à la sonorité des mots, à toute cette cuisine qui se révélait un vrai travail de forçat mais constituait également la source du seul plaisir total qu’on trouvait à écrire. Il y avait tellement de trucs à raconter sur la difficulté à élaborer une simple phrase qui tienne debout et qui soit reconnaissable entre toutes et qui rende compte et qui traduise et qui accompagne et qui creuse et qui respire.
Et Djian parle d'Impuretés... http://philippedjian.free.fr/critiques/impure/gall.htm
Et Djian parle d'Impuretés... http://philippedjian.free.fr/critiques/impure/gall.htm


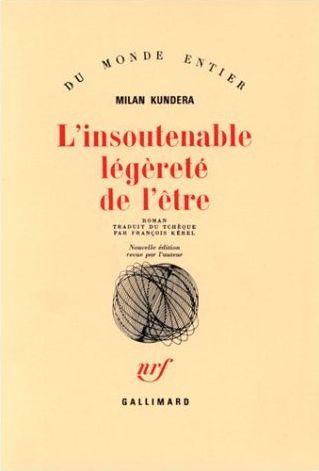 L’insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera
L’insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera Fort comme la mort, Maupassant
Fort comme la mort, Maupassant Les Mots, Sartre
Les Mots, Sartre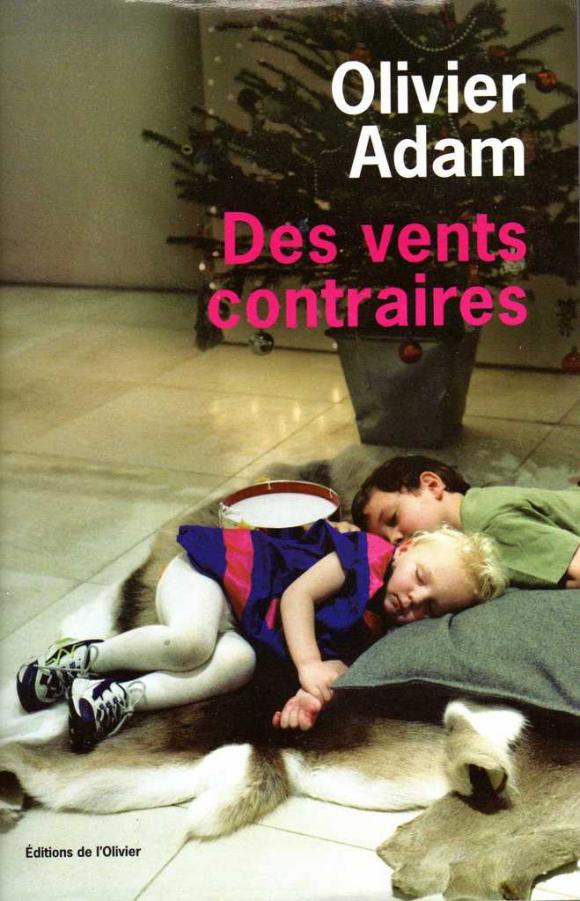 Des vents contraires
Des vents contraires