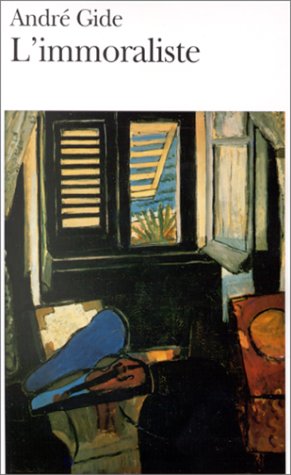 L’immoraliste, André Gide
L’immoraliste, André Gide
D'emblée je l'annonce : ce billet va être teinté de petites phrases, destinées à ceux qui veulent approfondir les choses. Pour le reste, j'ai essayé de faire en sorte que mon ton n'en pâtisse pas...!
Gide l’annonce dès la préface : il ne prend pas parti pour ou contre son héros. Il ne s’agit pas pour lui de faire l’apologie de quoi que ce fut, encore moins acte d’accusation. Il se contente d’offrir au lecteur un texte qui, il l’espère, avance des idées très pressantes et d’intérêt très général ; si ça n’était pas le cas, la faute en serait à l’auteur. Le problème qu’il soulève dans ce récit (Gide y tient, ce n’est pas un roman, mais un récit ! Tout comme Isabelle et La Porte-Etroite, dont l’Immoraliste pourrait être le pendant opposé, quoi que cela demande réflexion…), problème qui n’est est pas véritablement un puisqu’en art il n’y a pas de problème dont l’œuvre d’art ne soit la suffisante solution, est celui de l’individualisme et de la singularité de l’être humain se positionnant par rapport aux autres hommes. Pour mieux comprendre cela, cela va de soi, résumé :
L’ensemble du texte est constitué du récit que le narrateur, Michel, fait à ses amis qu’il n’a pas vu depuis trois ans. Dans la nuit du désert, l’azur disparu, il leur conte l’histoire de sa vie depuis son mariage… (nb : l’ensemble de ce récit est en fait rapporté dans une lettre qu’un des amis de Michel écrit à son frère, le Président du Conseil).
Michel est orphelin de mère (ahahah grand problématique du Roman en général, cela nous met la puce à l’oreille : attention, Gide réfléchit sur le genre roman, d’ailleurs en perte de vitesse à l’époque où il publie l’Immoraliste, en 1902, suite à l’émergence du naturalisme et de la sociologie). Puritain, élevé par son père dans le culte protestant et la passion de l’Histoire, il mène une vie sans heurts jusqu’ à ses vingt-cinq ans. Alors que son père lui aussi s’apprête à passer dans l’autre monde, il épouse, pour lui rendre sa fin plus heureuse, une jeune fille qu’il n’aime ni ne désire : Marceline. Au cours de leur voyage de noces en Orient (ahah grand motif romantique que le voyage en Orient ! cf Nerval, Chateaubriand,etc…), Michel tombe malade. La tuberculose. Cette maladie qui tache les mouchoirs, et détruit l’être… Marceline, qui semble aimer son époux en dépit du fait que celui-ci ne le lui rende pas, promet de le soigner. Elle s’occupe de lui, le cajole, le nourrit, et surtout, prie. Michel, quant à lui, se promet de guérir sans l’aide de Dieu. Et il guérit, peu à peu ! Cette guérison lui donne un goût pour la vie que jamais auparavant il n’avait eu. Il se sent vivant. La compagnie des jeunes garçons est comme pour lui un élixir de vie. Il semble qu’à leurs côtés, il renaisse au monde. Par ailleurs, il se prend d’affection pour l’un d’eux, qu’il surprend en train de voler une paire de ciseaux. A partir de ce moment, Michel affirme son inclinaison pour les êtres marginaux et, comme lui, immoraux. Il prend peu à peu de la distance par rapport à son ancienne vie. Loin de désirer renouer avec le passé –les ruines, qu’il aimait tant, ne l’intéressent plus- il se tourne avec avidité vers le présent, les populations locales, les jardins (locus amoenus) et les beaux garçons (homosexualité et pédophilie pointent le bout de leur nez…ou bien est-ce une volonté de renouer avec la pastorale et les églogues virgiliennes…). (NB : tout l’inverse Chateaubriand, qui ne s’intéressait pas aux populations locales, préférant écouter son cœur et jouir de la mélancolie que la contemplation des ruines éveillaient en lui). Il se rase, se baigne dans une fontaine : un véritable renouveau, un nouveau baptême, impie celui-là. Enfin, las de cette vie orientale, il retourne avec sa femme dans leur propriété de Normandie. Là-bas, il se prend d’affection pour un jeune homme de dix-sept ans. Aux côtés de ces garçons, de plus en plus vieux, son « nouvel être » grandit. D’enfant, son nouveau « moi » devient adolescent, puis adulte. Lui, dont la santé était si fragile, en vient à ne presque plus dormir, passant ses nuits à courir dans les rues avec un ami marginal et cynique, alors que sa femme, la robuste Marceline, est en train de mourir de la tuberculose. Il s’attache à prendre soin d’elle, mais on peut se demander s’il ne souhaiterait pas sa mort…
Son goût pour les marginaux, pour les individus sans foi ni loi, s’exacerbe :
J’en venais à ne goûter plus en autrui que les manifestations les plus sauvages, à déplorer qu’une contrainte quelconque les réprimât. Pour un peu je n’eusse vu dans l’honnêteté que restrictions, conventions ou peur. Il m’aurait plu de la chérir comme une difficulté rare ; nos mœurs en avaient fait la forme mutuelle et banale d’un contrat. En Suisse elle fait partie du confort.
Ceci m’amène à me poser une question : ne peut-on, comme Michel, penser que toute cette morale, ces règles, ces mœurs, ne sont qu’hypocrisie ? L’immoralisme ne serait-il pas ici gage de sincérité ? Ceci permet de voir combien Gide ne prend parti ni pour l’un ni pour l’autre. Ces questions que son texte soulève sont ce qui font de lui un grand texte. L’écrivain n’aura pas échoué dans sa tache !
Par ailleurs, une autre chose m’a frappée : bien que le titre semble programmatif (thématique dirons-nous…) la morale ne semble pas totalement absente de ce récit (d’abord parce qu’on peut tirer des leçons de ce texte, du moins des questions, car en aucun cas il ne s’agit d’un récit à vertu didactique ! je n’ai cherché de rien prouver, mais de bien peindre et d’éclairer ma peinture.) Mais il s’agirait plutôt pour moi d’une morale poétique, une manière de voir la vie, des phrases qui parlent à l’âme…comme celle-ci :
Mais je crois qu’il est un point de l’amour, unique, et que l’âme plus tard, ah ! cherche en vain à dépasser ; que l’effort qu’elle fait pour ressusciter son bonheur, l’use ; que rien n’empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. Hélas ! Je me souviens de cette nuit…
Gide prend ici le contre-pied de l’idéal romantique : ce ne sont plus les ruines qui font naître en lui la mélancolie, ce ne sont pas les vieille pierres antiques d’un temps révolu, mais les souvenirs de sa propre vie, ce passé qu’il cherche dans le présent. Gide se positionne ainsi dans une réflexion sur l’homme, le bonheur, la vie.
Les derniers mots de Michel sont déchirants. Alors que sa femme est morte, qu’il est libéré de toute contrainte, libre de poursuivre cette renaissance suite à la maladie – du sang de ses poumons est né un nouvel être- il ne sait plus que faire :
Ce qui m’effraie c’est, je l’avoue, que je suis encore très jeune. Il me semble parfois que ma vraie vie n’a pas encore commencé. Arrachez-moi d’ici à présent, et donnez-moi des raisons d’être. Moi je ne sais plus en trouver. Je me suis délivré, c’est possible ; mais qu’importe. Je souffre de cette liberté sans emploi.
Ici, un article très éclairantsur ce récit qui, je dois dire, est assez prenant, et que j’ai lu d’une traite !
PS : Qu’on me pardonne ce billet un peu trop académique à mon goût, mais j’ai de bonnes raisons de l’avoir rédigé ainsi.
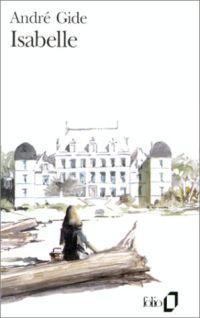


 La porte étroite
La porte étroite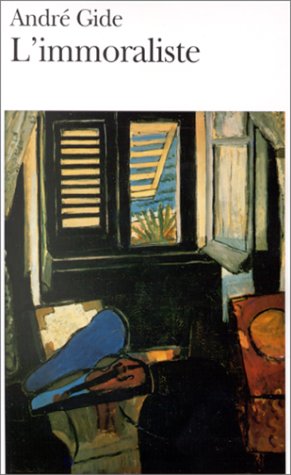 L’immoraliste, André Gide
L’immoraliste, André Gide Si le grain ne meurt, André Gide
Si le grain ne meurt, André Gide Les caves du Vatican, André Gide
Les caves du Vatican, André Gide