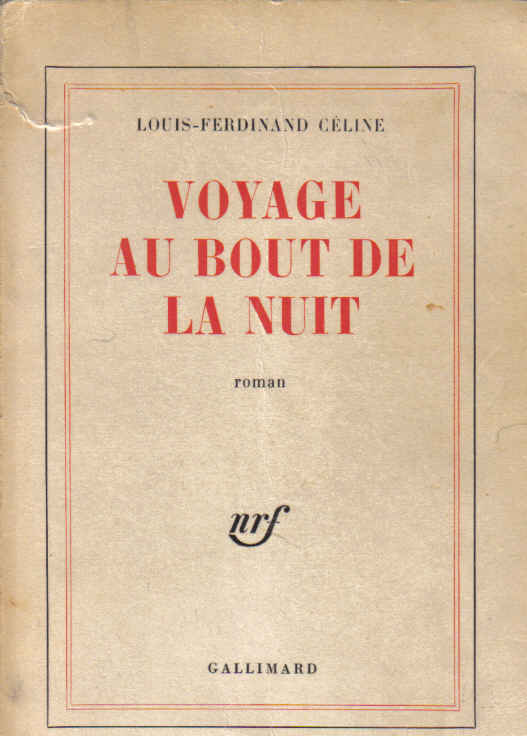 Voyage au bout de la nuit, Céline
Voyage au bout de la nuit, CélineMoi aussi j’y suis arrivée, au bout de la nuit.
La guerre, la traversée des Océans vers les Tropiques, la chaleur, la fièvre, les moustiques. Et puis New-York, les puces d’Elis Island, l’enfer du pipi et du caca, les hôtels, les bordels, le retour en France. Tout ça d’un coup, sans qu’on sache pourquoi. Des coups de tête, des pertes de conscience. Une page blanche et on est ailleurs. Et puis en France ça commence à devenir vraiment pesant. Avant aussi c’était la nuit, mais là on s’enfonce dans le tunnel. Un type malade, Bardamu, qui devient médecin ; on aura tout vu. Surtout qu’il laisse ses patients mourir la plupart du temps. Et puis après avoir été fou lui-même (la guerre ça vous passe dessus, soit sur le corps, soit sur le ciboulot…) il finit dans un asile pour fous.
La guerre, la traversée des Océans vers les Tropiques, la chaleur, la fièvre, les moustiques. Et puis New-York, les puces d’Elis Island, l’enfer du pipi et du caca, les hôtels, les bordels, le retour en France. Tout ça d’un coup, sans qu’on sache pourquoi. Des coups de tête, des pertes de conscience. Une page blanche et on est ailleurs. Et puis en France ça commence à devenir vraiment pesant. Avant aussi c’était la nuit, mais là on s’enfonce dans le tunnel. Un type malade, Bardamu, qui devient médecin ; on aura tout vu. Surtout qu’il laisse ses patients mourir la plupart du temps. Et puis après avoir été fou lui-même (la guerre ça vous passe dessus, soit sur le corps, soit sur le ciboulot…) il finit dans un asile pour fous.
Un voyage dans la nuit, et pas la plus belle.
Un voyage de miteux, dans une langue de miteux. Cette langue qui sent le graillon et la crasse, et qui percute. A chaque page on peut trouver un aphorisme ; et pourtant, c’est pas voulu. C’est juste le fameux langage populaire et oralisé dont on fait tant état à propos de Céline.
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté.
J’avais une âme débraillée comme une braguette.
Voilà un micro échantillon. Le reste est pareil. Sublime de dégueu. Du bas ventre rabelaisien en veux-tu, en voilà ! Et puis du lapidaire avec ça, des phrases qui vous restent dans l’oreille, avec leurs images salaces. Pas toujours salaces ; assez vraies aussi. Ça a débuté comme ça.
Un long voyage pouilleux au milieu des déchets de l’humanité. Pas seulement organiques les déchets, mais aussi intellectuels. De la gerbe d’idées. Un monde pourri, putride, injuste et atroce. Jusqu’au Robinson qui tue la vieille Henrouille, en s’y prenant à deux fois le garçon. Il a presque perdu la vue, mais pas le nord. Et le pauvre Bébert, le petit garçon qu’on envoie se balader au cimetière, et qui en revient avec la coqueluche… Pour sûr qu’il voulait le garder, le cimetière.
Un adepte de la reprise du sujet en fin de phrase, le Céline. C’est ça sans doute qui donne son rythme si reconnaissable à son écriture.
Un long voyage. Et pourtant un petit article. On a tellement glosé sur Céline, qu’il me semble n’avoir rien à en dire. Je l’ai écouté parler à la radio. Il parle un peu comme il écrit. Etonnant. Il a dit qu’il n’était pas contre les Sémites, mais juste contre le fait qu’ils soient cause de la guerre. A voir. Je trouve quand même que lui refuser la commémoration, c’est dur. Parce que personne n’a jamais écrit comme lui ; et Proust l’a bien dit : le moi de l’écrivain et le moi de l’homme ne sont pas confondus.
Pourtant c’est sombre le voyage ; il devait avoir l’âme bien sombre le Louis-Ferdinand.


 Une vie, Maupassant
Une vie, Maupassant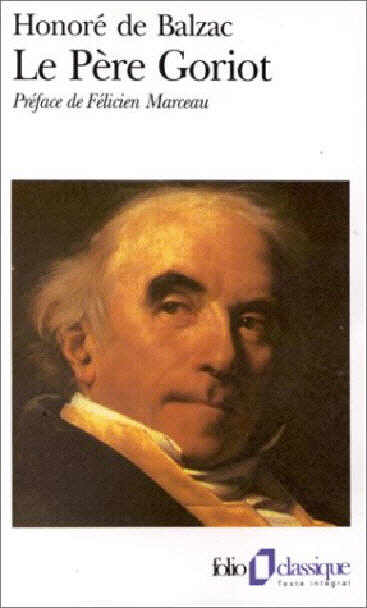 Le Père Goriot
Le Père Goriot