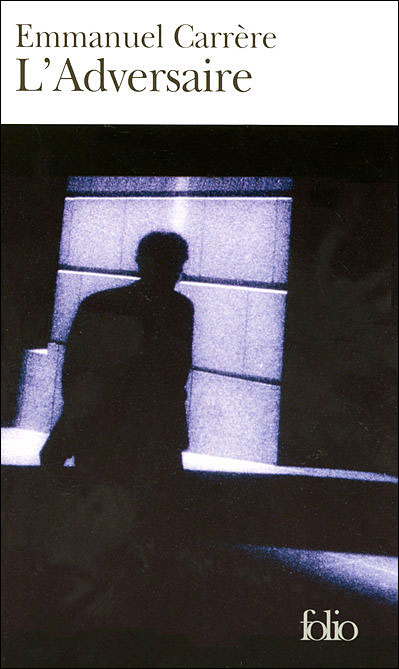 L’Adversaire, Emmanuel Carrère
L’Adversaire, Emmanuel CarrèreLe Monde dans les Livres
Dimanche 1er mai 2011 à 23:15
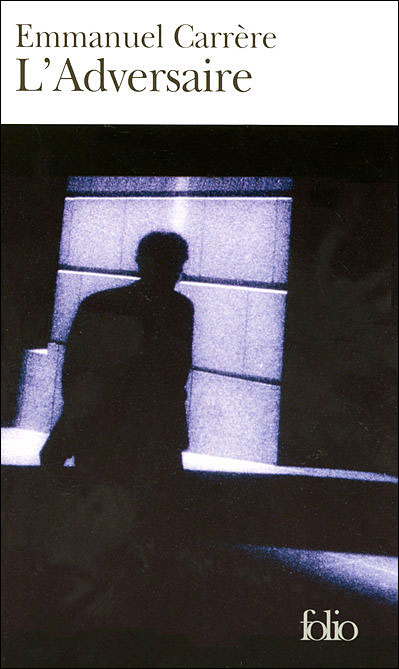 L’Adversaire, Emmanuel Carrère
L’Adversaire, Emmanuel CarrèreSamedi 7 mai 2011 à 12:35
Jeudi 19 mai 2011 à 14:38

L'ultra négation, la double négation; l'exclusion totale. Dès le titre on entre dans le roman, dans les phrases, dans un rythme. Un rythme scandé ici, binaire, équilibré ; le rythme de l’échec. Ce ne sera pas elle, ce ne sera pas lui ; ce ne sera ni l’amour, ni la haine. Ce ne sera ni l’un, ni l’autre ; juste l’indifférence.
A travers une trame narrative originale et inédite ce me semble (je n’ai jamais rien lu de semblable auparavant en tout cas), Camille Laurens nous parle de la déliquessence de l’amour. De la manière dont un homme et une femme qui s’aiment un temps peuvent se haïr puis s’ignorer plus tard. C’est très pessimiste ; presque philosophique. Une longue plainte élégiaque de la rupture et de l’abandon.
Glauque ; triste ; presque insupportable par moments. En filigrane de ce récit, Adolphe de Bienjamin Constant. Cet homme qui croit aimer et qui, dès lors qu’il possède l’objet de son désir, se rend compte qu’il ne l’aime pas. Pauvre Ellénore. Et pauvre Hélène…
Voilà donc l’originalité de ce livre que j’ai lu par bribes, par à coups, prise par la vie et les études. Ce n’est pas un livre qui prend, c’est un livre qu’on goûte, qui dégoûte, qui émeut. L’écriture en est d’ailleurs assez agréable, un peu poétique ; enfin ça parle d’amour, mais en négatif. Bref, l’originalité réelle de ce livre, c’est donc Hélène, et le choix narratif. Hélène est en fait l’héroïne d’un film ; un film sur l’histoire d’amour de Camille et Arnaud. Et les mots qu’on a sous les yeux, ce sont les mails que l’auteur a envoyés à un réalisateur, pour élaborer le film en question. Dès lors fiction et expérience se mêlent, liées par des commentaires, les réflexions, les chagrins et les souvenirs de Camille concernant cette délicate et douloureuse histoire d’amour. Uniquement de la fiction en somme, puisque de toute façon, dès lors qu’on décrit, on déforme. Et puis Camille Laurens, c’est l’autofiction qu’elle pratique, en connaissance de cause, puisque dans tous les cas, dès lors qu’on écrit, on écrit un peu sur soi. Ici elle joue le jeu de la fiction à fond, lui faisant investir l’espace cinématographique. Les descriptions de scènes et plans séquences sont intéressants, et ouvrent un horizon nouveau à la littérature. C’est beau, vivant bien que très figé, on voit et on y croit.
Toutefois c’est un peu brouillon tout cela, un peu déroutant, un peu long, un peu agaçant. J’ai plus d’une fois cru que j’allais poser le livre là, d’autant que j’ai lu plusieurs critiques négatives à son propos. Mais j’ai finalement continué, j’ai lu jusqu’au bout, happée je crois par la langue, les réflexions et les références dont ce livre fourmille. Camile Laurens, c’est de la littérature en abîme et puissance dix, et moi j’aime.
Vendredi 20 mai 2011 à 13:57
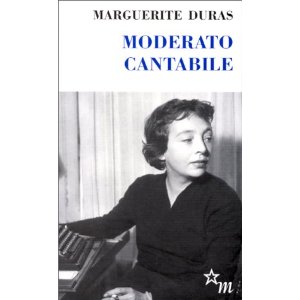
Modéré et chantant. Le petit garçon joue sa sonatine au piano, doucement. Il est récalcitrant mais il joue. Sa mère, Anne Debaresdes, l’écoute en souriant. La professeur n’est pas contente, elle râle, elle pousse, elle dispute l’enfant dont la mère sourit, heureuse. Cet enfant, c’est son trésor. Et tout à coup, alors qu'il ne peut répondre quand on lui demande ce que signifie moderato cantabile, un cri retentit dans la nuit.
Dans le café en bas de l’immeuble, une femme vient d’être tuée ; crime passionnel. Son mari se couche à ses côtés, geint, fini enfermé. Puis on n’entend plus rien. Anne, elle, a été émue par cet évènement insolite. Chaque jour, pendant une semaine, elle revient dans ce café où tout s’est déroulé. Sans relâche elle interroge un homme, un homme qu’elle séduit sans le vouloir, un homme qu’elle désire probablement sans le dire, autant qu’elle désire ce vin qu’elle boit, sans cesse, verre après verre, dans une gorgée presque éternelle. Son enfant chaque fois l’accompagne, il joue dehors pendant qu’elle boit dedans, mais elle n’est pas alcoolique, non, elle est simplement passionnée, passionnée de l’amour et de la passion même.
Avec l’homme du café elle aimerait connaître cet amour pour lequel on meurt, cet amour qui a conduit l’homme à tuer sa femme, on ne sait trop pourquoi. Mais tout s’arrête subitement, et on ne sait rien.
Une tranche de vie, réglée par la mort. C’est du Duras. Déroutant, pesant, mais épatant. Le style est sublime, pas un mot de trop, chaque virgule à sa place, des associations presque poétiques parfois, c’est beau et pesant comme un velours, c’est doux et brillant aussi, c’est sublime.
Un très court roman qui charme, modéré et chantant, un peu grave pourtant. L'amour est impossible alors Anne, nouvelle Emma, sorte de Léopold Blum de cette ville portuaire dans laquelle se déroule l'action, se promène ,boit du vin, reçoit et vit. Sensible et triste, heureuse et enivrée.
Vendredi 27 mai 2011 à 0:06
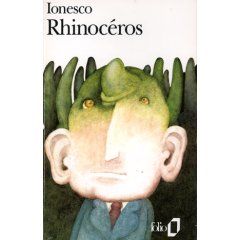
Des hommes, des femmes, un café, un petit chat (écrasé le petit chat…) et des rhinocéros. Un ou deux, on ne sait pas trop, à deux cornes ou une, on n’a pas bien vu. La logique n’est pas le fort des personnages de la pièce de toute façon. C’est absurde, tout cela, et pas seulement le registre. Absurde, comique, et tragique d’ailleurs. Tout un panel de colorations.
Dans cette pièce en trois actes et cinq tableaux, tout est mêlé : la mascarade de la ménagerie et de la métamorphose, les personnages bornés, savants ou ridicules (les deux allant souvent de paire), le destin tragique et la réflexion sur l’homme. Dans la pièce, si vous ne la connaissiez pas déjà, il s’avère que tous les habitants de la ville se transforment en rhinocéros…étrange… angoissant… D’ailleurs toute la pièce est conçue comme une tragédie. Le premier tableau a lieu en extérieur, sur la terrasse d’un café. Le second dans un bureau, lieu du savoir. Et enfin le dernier, dans la chambre de Jean, Jean le propre sur lui, Jean le bien-pensant, le propret, bien rangé, averti et compassé. Les lieux se réduisent, comme les esprits. Celui de Jean est réduit à rien ; d’ailleurs il devient un rhinocéros. A contrario Béranger, son homologue crachou et pouilleux, se transforme peu à peu en homme raisonnable, voulant lutter pour sauver ses semblables de l’animalité et de la perte d’identité.
Une pièce dont j’entendais souvent parler, que je n’avais pas encore lue, et qui ne m’a pas déçue, dans le sens où je n’ai jamais été une inconditionnelle de ce genre de théâtre.
Ceci étant, le mélange des genres et des registres est des plus intéressants, et mené de main de maître !

