 Antigone(s), Anouilh, Sophocle
Antigone(s), Anouilh, Sophocle
Depuis deux jours, je me suis lancée dans la lecture d’Antigone.
Je ne parlerais ici non pas d’une, mais de deux pièces : celle d’Anouilh (que j’ai relue avec délectation), et celle de Sophocle, pour tenter, en bonne étudiante sérieuse, une comparaison des deux. Mais je me suis rapidement arrêtée, car ce travail me semblait enlever tout son charme à la pièce d’Anouilh, à la lecture de laquelle j’ai été le plus sensible. Je ne veux pas dire que celle de Sophocle m’ait déplu ; je l’ai lu après celle d’Anouilh, et j’ai pu ainsi établir ce qui avait pu constituer pour lui le point de départ de son œuvre. Juste un petit résumé avant de poursuivre, histoire de situer les choses, et de ne pas trop transiger à la règle de ce bloc : donner envie de lire, en connaissance de cause (et que je m’efforce de respecter, même si parfois le résumé se noie un peu parmi mes commentaires…) :
Résumé (parce qu'il faut que ceux qui ne l'ont pas lue lisent cette pièce merveilleuse!) : Antigone, c’est la tragédie du conflit qui oppose la conscience humaine au devoir d’Etat. Polynice, fils d’Oedipe, prince de Thèbes déchu, a tué son frère Etéocle lors d’un combat au cours duquel il a lui aussi trouvé la mort. Alors que le premier a été enterré comme il se doit, bénéficiant des rites funéraires d’usage, le corps de Polynice a été condamné à rester sans sépulture, en proie aux chiens et aux aigles, et son âme à errer dans le royaume des Morts. Antigone, sa sœur, ne peut tolérer une telle injustice de la part de son oncle Créon. Bravant l’interdit qui condamne quiconque s’opposant à la loi à être lapidé, la jeune fille s’empresse d’aller rendre les derniers hommages au corps du défunt. Elle est surprise, lors d’une récidive, par les gardes chargés de la surveillance du corps, puis condamnée à mort par Créon.
Cependant, chez Anouilh, Antigone c’est plus que ça. C’est comme s’il avait pris la tragédie et lui avait donné une nouvelle dimension. C’est, en quelque sorte, pour moi, l’univers de Sophocle en 3D. Je m’explique : avec Sophocle, tout est dans l’économie, tout est fait pour que le spectateur soit informé des rouages de l’intrigue (les monologues, le Chœur, le Coryphée et le Messager) pour que la tragédie poursuive son avancée inéluctable. Ainsi Créon expose au peuple Thébain, dans une longue tirade, sa décision concernant Polynice. De même, le Chœur et le Coryphée présentent longuement au spectateur la situation, et tirent des leçons des réactions des personnages avec lesquels le Coryphée dialogue parfois. Tout ceci a quelque chose de très solennel, de très sérieux, de très tragique (il faut imaginer que certaines paroles étaient chantées, et constituaient le « mélodrame », le drame chanté… Bref, rien de bien gai là-dedans…). Et que fait Antigone pendant que tout ceci se passe sur scène ? Où est-elle, que fait-elle quand elle ne joue pas son rôle ? C’est justement cela qu’Anouilh nous montre ou nous suggère : Antigone, jeune fille sombre et frêle, amoureuse de la nature, amoureuse tout court, l’âme rêveuse et poétique. Antigone alors qu’elle est partie recouvrir de terre le corps de son frère avec une petite pelle, aux premières lueurs de l’aube ; Antigone qui a même perdu son appétit d’oiseau quand sa Nounou lui beurre des tartines ; Antigone qui ne veut pas que l’on gronde sa chienne Douce ; Antigone qui souffre de ne pas être belle comme sa sœur Ismène, mais qu’Hémon a choisie, quand même. C’est cette dimension qu’Anouilh offre à notre regard, ce caractère humain caché derrière la force tragique de l’héroïne. Cette puissance de volonté, il la met également en scène, dans ce long dialogue avec Créon, au terme duquel, finalement, rien n’a évolué, tout est resté pareil, le pire, annoncé par le Prologue, n’attendant que le bon moment pour se produire. Car le Destin continue sa marche inéluctable. Même si le choix de ne pas enterrer Polynice est arbitraire, même si ce frère soulard qu’elle n’aimait pas méritait de finir ainsi, Antigone suit la voie toute tracée de son destin ; elle sait qu’elle va mourir. C’est là qu’elle est « elle-même », Antigone. Avant, avec sa Nounou, avec Ismène, avec Hémon, elle était la petite maigre assise dans un coin, qui ne dit rien, et qui pense.
Elle est puissante Antigone, elle ne dit pas oui, elle ose dire non ; elle ne veut pas comprendre, elle en a assez de comprendre, elle veut suivre sa voie. Elle se comporte comme une folle, mais refuse de se taire. Son destin la pousse, inéluctablement. Elle sait qu’elle mourra, qu’elle ne sera jamais heureuse, mais elle aurait aimé vivre. Alors elle crie : elle crie qu’elle ne se taira pas, qu’on n’a qu’à lui dire comme s’y prendre pour être heureuse, heureuse alors qu’elle a laissé le corps de son frère pourrir comme une charogne, son âme errer parmi les Morts, alors qu’elle n’a pas accompli son devoir… Elle veut continuer à dire non, obstinée, enragée. Le petit corps frêle, la tignasse mal peignée, la jeune fille sombre et maigre devient furieuse. Mais c’est avec des fils multicolores qu’elle se donne la mort ; avec du rouge aux lèvres qu’elle accueille Hémon pour la dernière fois. Elle aime voir le monde de l’aube, ce monde sans couleurs ; mais elle aurait aimé vivre, elle aurait aimé continuer à voir les lueurs du jour. C’est parce qu’elle est Antigone qu’elle est condamnée à voir tout en noir, tout de la couleur du tragique. Elle doit tenir son rôle, elle doit regarder droit devant elle et s’acheminer, gravement, vers son destin.
Tout est réglé, tous sont, dès le début, condamnés. Mais en lisant Anouilh, je n’ai pu m’empêcher de penser que, derrière l’héroïne, il y avait une enfant, et qu’elle aussi, elle aurait aimé vivre.
Je viens de lire un article dans le Magazine Littéraire, sur Antigone, justement. Et l'auteur a raison, d'une manière éclatante, évidente : ce qui distingu l'Antigone antique de celle de 1942, c'est l'affirmation de sa totale liberté. Elle n'est ni prisonnière de la loi, encore moins de la religion; toutefois il ets vrai qu'elle semble prisonnière de son destin d'héroïne. Mais c'est parce qu'on sait que c'est une réécriture. Si on lit la pièce comme une oeuvre neuve et profondément présente, on réalise qu'Antigone, c'est la liberté toute nue.


 La machine infernale
La machine infernale Hernani, Victor Hugo
Hernani, Victor Hugo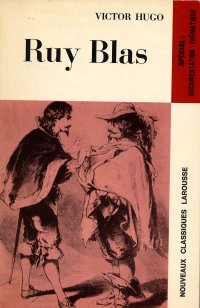 Ruy Blas
Ruy Blas La guerre de Troie n’aura pas lieu
La guerre de Troie n’aura pas lieu