 L’âge d’homme, Michel Leiris
L’âge d’homme, Michel LeirisNe vous attendez pas à lire une autobiographie ordinaire. Pas ou peu de continuité, pas de synchronie, pas de rétrospection organisée. C’est le portrait fragmenté d’un homme blessé et tragique que vous allez découvrir. Un homme sans complaisance, qui dès la première ligne évoque la mort, et brosse un portrait de lui des moins lyrique et des plus âpres. Un homme qui, à de nombreuses reprises, a cherché à se suicider. Un jour, suite à une tentative, il a eu sous les yeux le tableau de Cranach, « Lucrèce et Judith ». Dès lors, il a eu envie d’écrire ce livre, et de liquider ainsi, en les formulant, un certain nombre de choses dont le poids [l’]oppressait.
L’écriture comme une cure ? Peut-être, probablement même. En tout cas dans ces pages, Leiris éclate son portrait, fragmentant artistiquement le livre en divers chapitres aux titres évoquateurs, poétiques parfois, mythiques et tragiques. Les femmes sont les figures centrales de l’œuvre (la femme castratrice !) – et le livre est comme organisé autour de deux figures centrales, Lucrèce et Judith, qui à elles deux incarneraient la femme idéale. Une hybride mêlant Lucrèce et Judith, cela donnerait quoi ? D’un côté une victime vertueuse et expiatoire, de l’autre une patriotique prostitution (Lucrèce, femme de Tarquin Collatin, violée par Sextus Tarquin, s’est donné la mort après avoir révélé l’outrage subi. Judith, une juive, veuve, est appelée par Dieu pour défendre la ville de Béthulie, assiégée par l’armée d’Holopherne, général de Nabuchodonosor. Pour ce faire, elle séduit ce dernier, et au matin, lui tranche la tête.) Au final une femme un peu monstrueuse, antithétique, une beauté hiératique (de statue), une pureté souillée et comme ravagée, grêlée, à la manière de ces statues des parcs sur lesquelles le temps laisse des traces…
Du tragique, du mythique, du sanglant. Voici trois des thèmes les plus prégnants de ce livre. A maints reprises, Michel Leiris nous évoque ces blessures, coupures, lésions, inflammations et divers autres bobos qui ont de rouge ponctué son enfance. Des problèmes d’amygdales, de sexe, de hontes diverses. Ça n’est pas joli joli, et, j’ose le dire, pas toujours très agréables à lire. Non pas que ce soit gore, non non, mais tout de même, au bout d’un moment, toutes ces histoires de coupures et de têtes tranchées (même si dans ce cas cela reste fantasmagorique et d’une forte charge symbolique), ça devient pénible.
Il a aussi été beaucoup au théâtre et à l’opéra ce jeune homme, et il nous retrace cahin-caha, au grès de ses souvenirs, quelles sont les origines de ces figures macrostructurantes, qui ont eu, et ont encore, une telle influence sur sa vie. Toutefois, comme dans toute autobiographie, notre auteur se trouve confronté à sa mémoire, cette abstraction faillible et incertaine, qui nous trompe alors même qu’on a le sentiment de la contrôler…
J’arrive à le (l’évènement relaté) reconstituer ici d’après mes souvenirs, y joignant l’observation de ce que je suis devenu depuis lors et comparant entre eux les éléments anciens ou récents que me fournit ma mémoire. Une telle façon de procéder est peut-être hasardeuse, car qui me dit que je ne donne pas à ces souvenirs un sens qu’ils n’ont eu, les chargeant après coup d’une valeur émotive dont furent dépourvus les évènements réels auxquels ils se réfèrent, bref, ressuscitant ce passé d’une manière tendancieuse ?
En cherchant ainsi à se confesser, ou du moins à exposer au public ses tares les plus basses, ses blessures les plus vilaines, il y a moyen d’être absous : mettre en scène, artistiquement, dans une œuvre d’art donc, sa mise à mort, pour limiter les dégâts. La littérature est alors comme une tauromachie, dans laquelle l’auteur s’expose à la corne en dévoilant ses failles (sinon, la littérature ne serait que grâces vaines de ballerines, c’est du moins ce qu’il expose dans De la littérature comme une tauromachie, préface de l’ouvrage). La corne acérée du taureau, par la menace matérielle qu'elle incarne, confère une réalité humaine à l'art. Mais le torero, exposé au danger, parvient à mettre à mort la dangereuse bête en faisant œuvre de toute sa dextérité. Il en est ainsi de l’auteur d’autobiographie, qui se risque à dévoiler des pans de sa vie, des pans sanglants, salis, honteux. Toutefois, au cours de cette composition, si l’auteur a envisagé un plan au préalable, il n’est pas toujours aisé de le suivre. Ainsi, Michel Leiris dit…
A mesure que j’écris, le plan que je m’étais tracé m’échappe et l’on dirait que plus je regarde en moi-même, plus tout ce que je vois devient confus, les thèmes que j’avais cru primitivement distinguer se révélant inconsistants et arbitraires, comme si ce classement n’était en fin de compte qu’une sorte de guide-âne abstrait, voire un simple procédé de composition esthétique.
La littérature transfigure, poétise, déforme le réel. Donc forcément, cet être fragmenté qu’il décrit (un peu à la manière surréaliste), c’est lui sans l’être, c’est l’image réfractée que lui renvoie le miroir de sa mémoire, brisé de place en place. Pourtant, dans la préface il revendique la plus grande sincérité de cette confession, la recherche de la plus grande véracité...
Malgré les coupures, les blessures, le sang et la honte, il y a aussi des belles choses dans ce livre, de jolis passages. Par exemple, une réflexion sur la poésie et la femme des plus mythiques, puisque quasi orphique…(Orphée étant le mythe fondateur de la poésie, et Eurydice, femme perdue, symbole de l’absence qui suscite la plainte du poète, enfin bref… !)
[…] l’idée qu’une muse est nécessairement une morte, une inaccessible ou une absente, que l’édifice poétique […]ne saurait reposer que sur ce qu’on n’a pas, et qu’il ne peut, tout compte fait, s’agir d’écrire que pour combler un vide ou tout au moins situer, par rapport à la partie la plus lucide de nous-même, le lieu où bée cet incommensurable abîme.
Ou encore cette phrase, écrite dans un journal, et que j’ai trouvé particulièrement belle…
Je porte dans mes doigts le fard dont je couvre ma vie.
Qui dit mieux ? En tout cas, celui-là semble prendre sa vie en main… ! Quoi qu’au fond cela pose question, dans la mesure où il apparaît comme un être fragile, tourmenté et complexe. Toutefois, s’il n’était pas ainsi, en quoi résiderait l’intérêt d’un tel livre ? Et des six autres tentatives d’autobiographie de Michel Leiris ! (même si l’âge d’homme est la plus complète.) D’ailleurs, d’âge d’homme il n’en est question qu’à la fin, très succinctement. Les 50 dernières pages ayant été mes préférées.
Donc, pour tout dire, un livre que je suis contente d’avoir relu, dont je me souvenais étonnement (puisque cette fois encore, ce que j’ai retenu, ce sont toutes ces histoires de coupures et de femmes…), mais les 50 dernières pages sont restées une bonne surprise. Finalement je ne sais pas si je dois conseiller ou non cette autobiographie… A vous de voir !


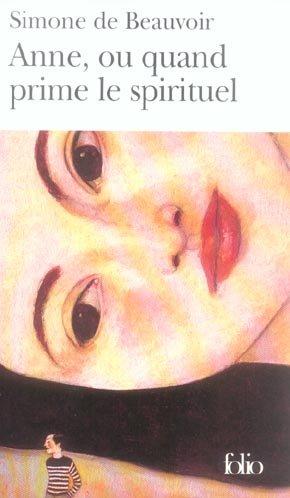 Anne, ou quand prime le spirituel, Simone de Beauvoir
Anne, ou quand prime le spirituel, Simone de Beauvoir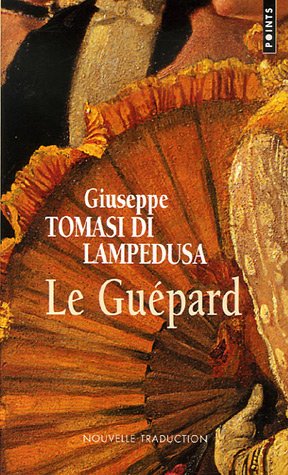 Le Guépard, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa
Le Guépard, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa
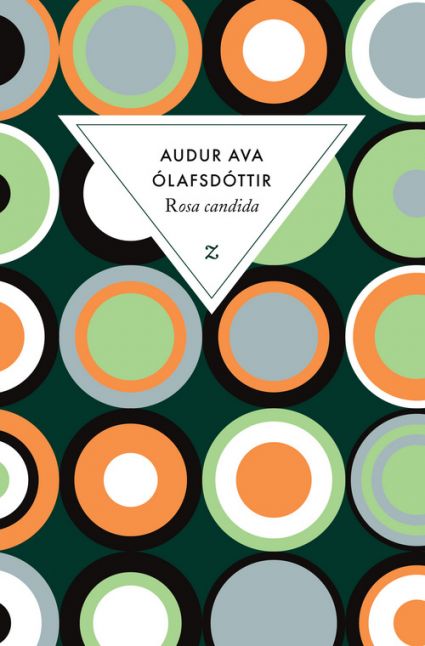 Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir
Rosa Candida, Audur Ava Olafsdottir