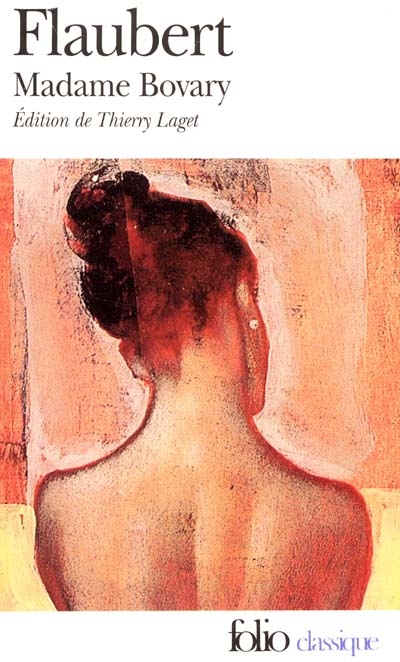 Madame Bovary, par Vous savez bien qui...!
Madame Bovary, par Vous savez bien qui...!Voilà un des grands tourments que je peux rencontrer en publiant sur ce blog : parler des grandes œuvres. Tout a déjà été dit ; alors soit on se tait, soit on essaie d’être un peu original. Ou du moins on fait ce qu’on croit être original parce qu’on n'a pas assez de culture pour savoir que cela existe déjà. Bref, je ne savais pas comment commencer, mais finalement j’ai choisi de vous faire part d’un extrait de critique de Baudelaire, tout simplement intitulée « Madame Bovary, par Gustave Flaubert ». Le poète donne la parole au romancier, et je trouve qu’il y confère un côté incisif et direct assez étonnant. Peut-être est-ce réellement Flaubert qui a parlé ? En tout cas, voici ce que, selon Baudelaire, il aurait pu dire :
« Quel est le moyen le plus sûr de remuer toutes ces vieilles âmes ? Elles ignorent en réalité ce qu’elles aimeraient ; elles n’ont un goût positif que du grand ; la passion, naïve, ardente, l’abandon poétique les fait rougir et les blesse. – Soyons donc vulgaire dans le choix du sujet, puisque le choix d’un sujet trop grand est une impertinence pour le lecteur du XIXème siècle. Et aussi prenons bien garde à nous abandonner et à parler pour notre compte propre. Nous serons de glace en racontant des passions et des aventures où le commun du monde met ses chaleurs ; nous serrons, comme dit l’école, objectif et impersonnel.
« Et aussi, comme nos oreilles ont été harassées dans ces derniers temps par des bavardages d’école puérils, comme nous avons entendu parler d’un certain procédé littéraire appelé réalisme, -injure dégoûtante jetée à la face de tous les analystes, mot vague et élastique qui signifie pour le vulgaire, non pas une méthode nouvelle de création, mais une description minutieuse des accessoires – nous profiterons de la confusion des esprits et de l’ignorance universelle. Nous étendrons un style nerveux, pittoresque, subtil, exact, sur un canevas banal. Nous enfermerons les sentiments les plus chauds et les plus bouillants dans l’aventure la plus triviale. Les paroles les plus solennelles, les plus décisives, s’échapperont des bouches les plus sottes.
« Quel est le terrain de sottise, le milieu le plus stupide, le plus productif en absurdités, le plus abondant en imbéciles intolérants ?
« La province.
« Quels y sont les acteurs les plus insupportables ?
« Les petites gens qui s’agitent dans de petites fonctions dont l’exercice fausse leurs idées.
« Quelle est la donnée la plus usée, la plus prostituée, l’orgue de Barbarie le plus éreinté ?
« L’Adultère
« Je n’ai pas besoin, s’est dit le poète, que mon héroïne soit une héroïne. Pourvu qu’elle soit suffisamment jolie, qu’elle ait des nerfs, de l’ambition, une aspiration irréfrénable vers un monde supérieur, elle sera intéressante. Le tour de force, d’ailleurs, sera plus noble, et notre pécheresse aura au moins ce mérite,- comparativement fort rare,- de se distinguer des fastueuses bavardes de l’époque qui nous a précédés.
« Je n’ai pas besoin de me préoccuper du style, de l’arrangement pittoresque, de la description des milieux ; je possède toutes ces qualités à une puissance surabondante ; je marcherai appuyé sur l’analyse et la logique, et je prouverai ainsi que tous les sujets sont indifféremment bons ou mauvais, selon la manière dont ils sont traités, et que les plus vulgaires pourront devenir les meilleurs. »
« Quel est le terrain de sottise, le milieu le plus stupide, le plus productif en absurdités, le plus abondant en imbéciles intolérants ?
« La province.
« Quels y sont les acteurs les plus insupportables ?
« Les petites gens qui s’agitent dans de petites fonctions dont l’exercice fausse leurs idées.
« Quelle est la donnée la plus usée, la plus prostituée, l’orgue de Barbarie le plus éreinté ?
« L’Adultère
« Je n’ai pas besoin, s’est dit le poète, que mon héroïne soit une héroïne. Pourvu qu’elle soit suffisamment jolie, qu’elle ait des nerfs, de l’ambition, une aspiration irréfrénable vers un monde supérieur, elle sera intéressante. Le tour de force, d’ailleurs, sera plus noble, et notre pécheresse aura au moins ce mérite,- comparativement fort rare,- de se distinguer des fastueuses bavardes de l’époque qui nous a précédés.
« Je n’ai pas besoin de me préoccuper du style, de l’arrangement pittoresque, de la description des milieux ; je possède toutes ces qualités à une puissance surabondante ; je marcherai appuyé sur l’analyse et la logique, et je prouverai ainsi que tous les sujets sont indifféremment bons ou mauvais, selon la manière dont ils sont traités, et que les plus vulgaires pourront devenir les meilleurs. »
Dès lors, Madame Bovary, - une gageure, une vraie gageure, un pari, comme toutes les œuvres d’art,- était créée.
Ainsi Madame Bovary se rapproche de ce roman sur rien qui serait l’aboutissement de la nouvelle modernité, de cet univers bourgeois dans lequel tout le monde se ressemble, qui ne propose plus les dissemblances, les singularités, qui font les « couleurs tranchées » que Balzac estime nécessaires pour le roman. Tout est plat, comme la conversation de Charbovari, tout n’est qu’ennui, comme la vie d’Emma.
Sans elle, finalement, le roman ne serait rien, il n’existerait pas, puisqu’on s’y ennuierait. Avec ses rêveries, issus de ces livres plus ou moins bons qu’elle lit – on peut penser aux keepsakes, en gros les Arlequins de l’époque- elle se constitue son capharnaüm d’images, de romances, lesquelles en définitives lui seront fatales – après avoir volé, comme on le sait, l’arsenic dans le capharnaüm de ce cher bourgeois d’Homais.
Parce que si on y réfléchissait, si on posait un regard neuf sur ce roman, qu’est ce qu’on pourrait en dire ? Et bien que c’est l’histoire d’une femme, qui épouse un médecin pleutre et incompétent, qui mène avec lui une vie des plus ennuyeuse à la campagne, et qui pour passer le temps lit des romans. Elle lit et un jour, elle rencontre un homme. Elle manque de tromper son mari, n’en fait rien, puis en trouve un autre. Voilà l’Adultère. Mais en attendant, avec ces romances qu’elles se crées, elle vit le roman de sa vie…
Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ces imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans le type d’amoureuse qu’elle avait tant envié.
Elle trompe son époux, finit par s’ennuyer avec ses amants, et par devenir une véritable séductrice. Ce qu’elle a appris dans les livres, elle le met à l’épreuve sur le terrain de l’expérience, et devient presque une experte de l’amour. Sauf que, de la même manière que son ancêtre masculin, Don Quichotte, elle est trop romanesque. Confondant vie et roman, elle lasse ses amants, et s’en lasse de même. En bonne bourgeoise finalement, elle dilapide sa fortune en babioles, contracte des dettes i remboursables, et se tue…
Une vie qu’elle veut trépidante, mais qui en définitive est des plus banales. Malgré ses idéaux auxquelles elle tente de ressembler, ces femmes vivant de grandes passions, toujours exaltées par l’amour, elle n’en reste pas moins une bourgeoise de province. C’est du moins ainsi que la voit Charles et les autres habitants de Yonville. Cette image de la femme cousant est récurrente, et réapparaît de manière un peu floutée, spectrale, dans les premières parties du roman. Ensuite Emma, cette femme un peu masculine – un fin duvet ourle sa lèvre supérieure, elle porte des talons, et surtout, surtout, c’est elle qui tend la cravache en queue (nerf...) de bœuf à Charles ! ne me demandez pas qui porte la culotte… m’a fait plutôt penser à une balle de ping-pong, virevoltant – je pense à la scène de la calèche, des plus érotiques !-, allant d’un amant à un autre, lesquels, sans s’en rendre compte, se la renvoient en quelques services réalisés avec plus ou moins de grandeur et de maestria. Là où Rodolphe est la figure du goujat collectionneur par excellence, Léon m’a semblé être le romantique un peu fleur bleu –compagnon idéal pour Emma au début semble-t-il, et pourtant… Et puis à la fin, tout s’immobilise. On ne joue plus ; c’est tragique, elle meurt. Elle est immobile, hideuse. Elle se vide de toute sa substance romanesque, de même que toute cette encre dont elle s’est gavée s’échappe d’elle et la laisse morte. Peut-être le moment où elle vit un épisode éminemment romanesque. Parce qu’il ne me semble n’y avoir rien de banal dans le récit de cette mort, des plus épiques, dans lequel les évènements s’enchaînent de manière assez angoissante… mais pourtant, o combien ironique ! (C’est Flaubert tout de même !) Si quelqu’un s’amuse ici, c’est bien le romancier. Pourtant je pense qu’il était un peu tragique pour lui de faire mourir son héroïne…
Pendant ce temps, pendant que Flaubert se débarrasse de son héroïne, que devient celui dont l’attitude était des plus insignifiantes, autrement dit des plus anti-romanesque ? Et bien Charles se charge d’attributs qui font finalement de lui un héros, ou presque. Il devient romantique, nostalgique, prend soin de lui, s’occupe de sa fille, et meurt de la plus pathétique des manières – au sens noble du terme, s’entend. Certes il n’a jamais été un bon médecin, et cela va de mal en pi, puisqu’il reste impuissant face à sa femme agonisante. Mais contrairement à Homais, qui semble le grand vainqueur de ce roman –alors que c’est l’archétype du bourgeois !- Charles Bovary, ce pleutre sans cervelle, au ventre plus proéminent que l’esprit, s’attache la sympathie du lecteur…
Retournement de valeurs, jeu avec les conventions romanesques, bref, un grand et puissant roman, on ne saurait assez le dire !
J’espère avoir réussi à faire quelque chose qui semble un tant soit peu original à certains, et puis sinon tant pis, au moins j’aurais écris, et surtout, relu Madame Bovary !


 Lambeaux
Lambeaux La carte et le territoire
La carte et le territoire Un roman français, Frédéric Beigbeder
Un roman français, Frédéric Beigbeder