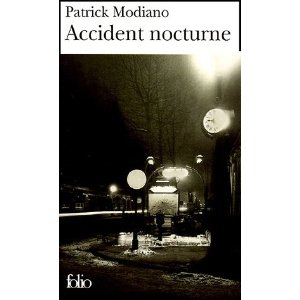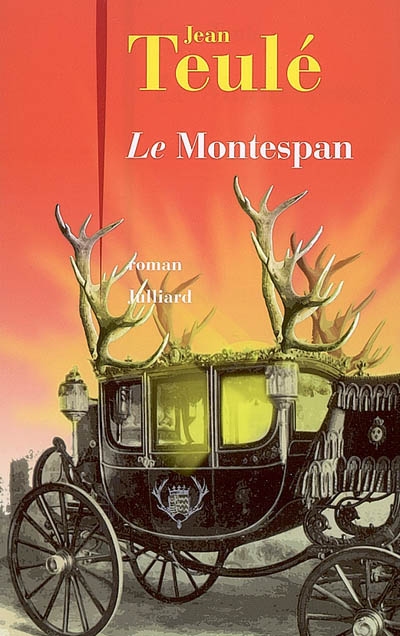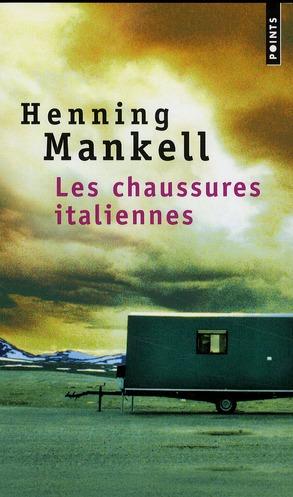Un livre comme un parcours ; un petit livre pour un grand deuil ; un court roman pour écrire la douleur, l’incompréhension, la vie avec la mort.
Philippe est mort, il a vécu deux heures. Deux heures hors du ventre de sa mère. Deux heures pendant lesquelles elle l’a à peine vu, où elle a à peine pu être mère. Elle a surtout été la mère d’un enfant mort.
Il y a une chose infiniment plus douloureuse que de ne pas serrer dans ses bras un homme qu’on désire : c’est de bercer dans ses bras un bébé mort. Le corps ne comble rien ; le corps manque. Faire un livre, faire l’amour : effort vain d’abolir l’intervalle. Ecrire : mettre des mots dans un trou, colmater. Les mots ne comblent rien. Les mots manquent.
Ecrire pour essayer de figer tout ça. Figer ce souvenir de l’enfant mort. Ou bien écrire pour essayer de le laisser vivre, encore et à jamais.
Souffrir. Comprendre. Vivre. Ecrire. Quatre étapes du roman, quatre étapes de l’auteur vers une sorte de résilience de la douleur, de la perte, de la béance. En moins de cent pages, elle nous raconte son cauchemar, ce cauchemar du jour où Philippe, ce bébé gigantesque, magnifique, brillant, a été foudroyé. Elle nous raconte, dans ce petit roman, le jour où Philippe est né, et celui où Philippe est mort. Forcément c’est court, parce que ces jours, ce sont les mêmes. Si le roman est une tranche de vie, là c’est une miette. Une miette de vie. Un prénom, quelques photos et là, un livre. Un livre avec son titre, ses mots qui tentent de dire la souffrance, la béance.
Camille Laurens rend compte par ce livre de la douleur d’une mère trop tôt abandonnée, d’une mère que son enfant n’a jamais pu appeler ainsi, d’une mère dont la vie de mère n’a un jour duré que deux heures. Cette mère c’est elle, et tout au long des pages, on souffre avec elle.
Pourtant ça n’est pas un livre qui fait pleurer ; en tout cas moi je n’ai pas pleuré, mais j’ai été émue. Emue de la retenue que dégagent ces pages (paradoxal je sais), qui ne font pas étalage de souffrance, mais donnent chair à cette volonté de reconstruction qui se retrace par le parcours de la souffrance, de la compréhension, de la vie après et, pour elle, de l’écriture.
Pas de pathos hyperbolique, juste le cheminement d’un être foudroyé par la pire tragédie qui puisse être : donner la vie, et la perdre ; en un seul jour. Camille Laurens, de manière réfléchie et posée, nous livre son cœur et son esprit, ses sentiments et ses recherches. Ses recherches pour expliquer la mort de Philippe. Le dossier médical, les témoignages, tout. Il lui faut comprendre. Et nous, lecteurs, participons à cette compréhension salvatrice qui permet ensuite de vivre ; du moins d’essayer de vivre. Elle, c’est l’écriture qui la sauve, et lui avec.