 Qui a tué Palomino Molero ? Mario Vargas Liosa
Qui a tué Palomino Molero ? Mario Vargas LiosaQui a tué Palomino Molero ? C’est la question que tout le monde se pose ; surtout Lituma, personnage central sinon principal, à travers des yeux duquel on voit, à travers les paroles rapportées duquel on comprend, imperceptiblement, dans un glissement entre l’omniscience et le point de vue interne, (maestria espagnole du prix nobel !), ce qui se passe…
- Bordel de merde de vérole de cul ! balbutia Lituma en sentant qu’il allait vomir. Dans quel état ils t’ont mis, petit.
Le gars était à la fois pendu et embroché sur le vieux caroubier, dans une position si absurde qu’il ressemblait davantage à un épouvantail ou à un pantin de carnaval démantibulé qu’à un cadavre. Avant ou après l’avoir tué on l’avait réduit en charpie, avec un acharnement sans bornes : il avait le nez et la bouche tailladés, des caillots de sang séché, des ecchymoses et des plaies, des brûlures de cigarette sur tout le corps et, comme si ça n’était pas assez, Lituma comprit aussi qu’on avait aussi tenté de le châtrer, parce que ses testicules pendaient jusqu’à mi-jambe.
Une entrée in medias res, théâtrale presque, sur une scène digne du boulevard du crime, granguignolesque. Hypotypose sanglante d’un corps dévasté. Le jeune homme, le soldat, l’amant surtout. Puisque peu à peu on apprend que le jeune homme était amoureux. De qui ? De la fille du colonel, forcément, un gradé. Il allait lui chanter la sérénade sous ses fenêtres. Il avait une belle voix, à ce qu’il paraît. Il ne reste que sa guitare.
Qui a tué Palomino Molero, alors ? Le titre ferait presque partie intégrante de l’incipit. Et c’est la question qui obsède tout le monde, lecteur comme personnages. Mais le narrateur ne nous livre pas tout…
Lituma et son chef, le lieutenant Silva, vont donc mener l’enquête sur ce meurtre à la barbarie sans pareil. Cela va leur donner l’occasion de rencontrer un homme qui tous les soirs se saoule et finit nu sur le comptoir, des tenancières de bars plus ou moins appétissantes, mais surtout Alicia Mindreau, la jeune fille un peu étrange dont Palomino était épris. Le Sherlock espagnol interroge toutes ces personnes avec un tac étonnant, manipulateur qu’il est, pendant que Lituma l’observe, à la Watson, avec ses questions qui lui brûlent les lèvres. Cette histoire de meurtre, ils en font presque une affaire personnelle.
Sur cette toile de fond plutôt sombre se détachent les aventures burlesques du lieutenant, si sérieux en service, mais en coulisses épris de la propriétaire du troquet, Dona Adriana, une Vénus bien en chaire, voluptueuse mais pas du tout amoureuse. Pourquoi Dona Adriana mettait-elle le lieutenant Sylva dans un tel était d’excitation ? C’est ce que se demande Lituma. L’intrigue amoureuse et comique se joint à l’enquête policière et tragique. Un mélange des genres, des tons et des voix des plus agréable. On n’est pas dans un roman policier, ni dans une fresque à la Balzac. Peut-être dans une sottie, comme a pu en faire Gide, avec la brièveté et le mélange propres à la satire (pot-pourri en latin).
Pourquoi a-t-on tué Palomino Molero ? Plus que « qui », c’est la raison d’un tel meurtre qui interroge et qui, quand on la connaît, révulse. Le qui sadique est lié au pourquoi objet de satire. Je ne vous dirai pas qui a tué Palomino Molero. Mais en tout cas, sa mort n’est pas belle, on l’a vu ; elle n’est pas juste non plus. Parce qu’on est puissant, on-t-on le droit de tuer ?
Et puis ça n'est pas tout! Pas seulement un roman policier, pas seulement une satire du pouvoir et des puissants, pas uniquement un pot-pourri tragique et comique, mais aussi un roman sur l’amour, parce que Palomino et la jeune fille, ce sont un peu Roméo et Juliette, made in Espagne. Lisez plutôt…
- Je vais vous dire une chose, dit le gendarme en battant des paupières. Ce n’est pas cela qui m’a le plus impressionné. Mais, savez-vous quoi ? Je sais maintenant pourquoi le petit gars s’est enrôlé comme volontaire à la base de Talara. Pour être près de la jeune fille qu’il aimait. Est-ce que vous ne trouvez pas extraordinaire qu’on puisse faire une chose comme ça ? Qu’un garçon, exempté de service militaire, vienne et s’engage par amour, pour être à côté de sa petite femme chérie ?
- Et pourquoi en es-tu tellement étonné ? rit le lieutenant Silva.
- C’est hors du commun, insista le gendarme. Quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours.
[…]
- Alors tu ne sais pas ce que c’est que l’amour, l’entendit-il se moquer. Moi je me ferais simple soldat et troufion, curé ou éboueur, tiens, je boufferais même de la merde s’il le fallait, Lituma, pour être à côté de la grassouillette.
Un roman qui donne envie de pousser plus loin la découverte du Nobel 2010!
Un roman qui donne envie de pousser plus loin la découverte du Nobel 2010!


 Si le grain ne meurt, André Gide
Si le grain ne meurt, André Gide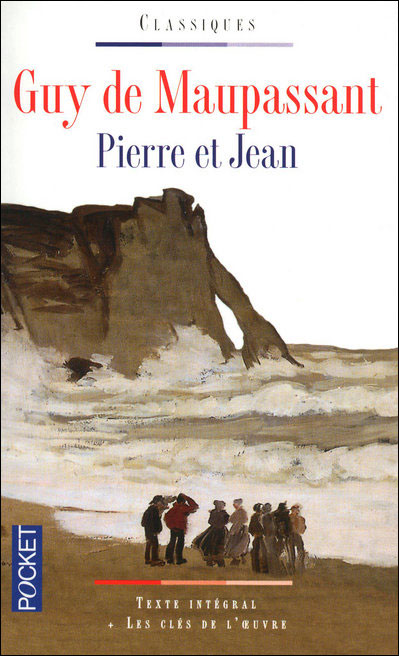 Pierre et Jean, Maupassant
Pierre et Jean, Maupassant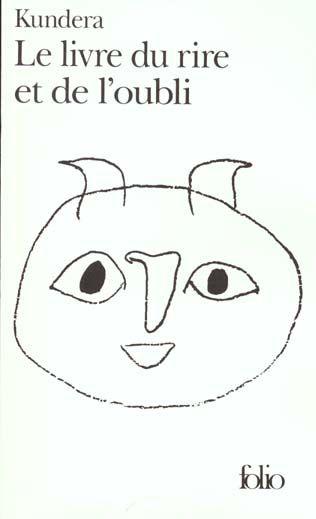 Le livre du rire et de l’oubli, Milan Kundera
Le livre du rire et de l’oubli, Milan Kundera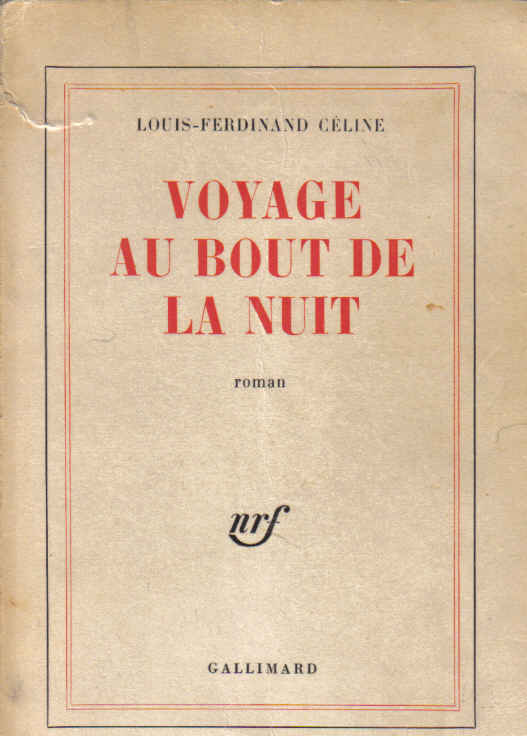 Voyage au bout de la nuit, Céline
Voyage au bout de la nuit, Céline