 La douleur, Marguerite Duras
La douleur, Marguerite DurasDes feuillets dans un cahier ; un journal ; des mots, quelques dates. Elle ne sait trop d’où cela vient, quand est-ce qu’elle a pu l'écrire. Des mots au milieu de la douleur, qui sont passés inaperçus. Des mots qui sans doute, ont permis de continuer à avancer malgré le poids accablant de la douleur.
La douleur… cette manière qu’a le titre de distinguer cet état de souffrance physique et morale est étonnante, déroutante, écrasante et presque éprouvante (j’allais dire douloureuse…). Le titre nous fait peine, peut-être même peur. On sait que ça va être dur ; qu’un auteur, qu’on suppose être Marguerite Duras, va nous parler de sa douleur. C’eut put être un essai ; ce n’en est pas un. Elle nous dit que c’est un journal ; je ne la crois pas. Pour moi, c’est une autofiction. Elle romance ce qu’elle a vécu, encore une fois. Rien que le titre, généralisant, sent le mentir-vrai, la fausse monnaie, la fiction. Pourtant il y a Robert L. Robert Antelme. Il est allé dans les camps ; il en est revenu. Il a souffert. La douleur physique et morale, là-bas ; mais aussi la douleur physique du rétablissement. Il y a Duras aussi qui a fait de la résistance. Dans ce livre elle se compromet, d’accord ; elle a résisté, c’est vrai. Elle est intervenue dans la vie publique et elle le dit ; elle écrit ce qui d’ordinaire reste de l’ordre de l’intime, du caché. Elle expose sa douleur avec impudeur.
La douleur… cette manière qu’a le titre de distinguer cet état de souffrance physique et morale est étonnante, déroutante, écrasante et presque éprouvante (j’allais dire douloureuse…). Le titre nous fait peine, peut-être même peur. On sait que ça va être dur ; qu’un auteur, qu’on suppose être Marguerite Duras, va nous parler de sa douleur. C’eut put être un essai ; ce n’en est pas un. Elle nous dit que c’est un journal ; je ne la crois pas. Pour moi, c’est une autofiction. Elle romance ce qu’elle a vécu, encore une fois. Rien que le titre, généralisant, sent le mentir-vrai, la fausse monnaie, la fiction. Pourtant il y a Robert L. Robert Antelme. Il est allé dans les camps ; il en est revenu. Il a souffert. La douleur physique et morale, là-bas ; mais aussi la douleur physique du rétablissement. Il y a Duras aussi qui a fait de la résistance. Dans ce livre elle se compromet, d’accord ; elle a résisté, c’est vrai. Elle est intervenue dans la vie publique et elle le dit ; elle écrit ce qui d’ordinaire reste de l’ordre de l’intime, du caché. Elle expose sa douleur avec impudeur.
Mais bon sang, de quelle douleur parle-t-elle alors, si ça n’est pas de celle de son mari fait prisonnier ? Elle parle de la douleur de l’attente, l’attente fébrile, l’attente auprès du téléphone, dans les bureaux, auprès des rescapés. L’attente d’une lettre, d’une voix, d’un nom prononcé. Il doit revenir mais elle ne le voit pas, n’en entend pas parler, ne comprend pas. Elle porte cette attente d’un être qu’elle voit mort, parfois, par flashs, cette attente qui l’accable, la vampirise, la laisse au bord de la folie. On se demande quand est-ce qu’elle a pu écrire ce journal. Elle aussi se le demande, dans la préface (ou bien la déclaration d’intention, qui se veut pacte de sincérité, mais l'incertitude, l’oubli hyperbolique sèment le doute, avec force…)
J’ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de Neauphle-le-Château.
Je n’ai aucun souvenir de l’avoir écrit.
Je sais que je l’ai fait, que c’est moi qui l’ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, je revois l’endroit, la gare d’Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce Journal. […] Ce qui est évident, c’est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l’avoir écrit pendant l’attente de Robert L.
Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m’épouvante quand je la relis. […] La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » ne conviendrait pas. […] Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m’a fait honte.
Duras, dans ces pages, nous raconte les jours de la libération, quand les corps épuisés, vides et flottants sont ramenés dans la capitale. Cette douleur qu’elle lit sur les visages, elle la ressent aussi au fond d’elle-même. La douleur de l'attente mais aussi de la honte; la honte d'attendre un opposant politique. Peut-être qu’en décrivant sa douleur elle parle de celle des autres. En rendant compte de son histoire personnelle, sans toutefois s’appesantir –d’ailleurs, de cette douleur, elle en parle peu, très peu ; elle se laisse deviner, insidieuse, entre les mots, dans les blancs pourquoi pas, quand elle empêche d’écrire… bref en racontant l’attente, en rapportant les évènements, les menus faits, de cette écriture lapidaire qui dissèque, précise, laissant mots et phrases à vif, derrière lesquels tremblent la douleur, elle nous dit quelque chose de l’être humain. Derrière cette vérité prétendue, par la préface, par la précision des lieux et des dates, Duras veut peut-être nous faire croire à la Vérité. Cependant on sait qu’avec elle, et surtout en littérature, la vérité est impossible, surtout quand on parle de soi. Elle retrouve ici des traces laissées en elle par le passé, que le temps, sa mémoire, l’imaginaire et les mots ont transformé. Et de ces multiples éléments, véridiques ou mensongers, peu importe, émerge alors une vérité qui dépasse la description d’une histoire individuelle pour atteindre à l’universel.
Pour elle, l’histoire de nos vies, l’histoire de sa vie, n’existe pas. Le roman de sa vie, de nos vies, existe, oui, mais pas l’histoire. C’est dans la reprise des temps par l’imaginaire que le souffle est rendu à la vie.
On peut la croire quand elle dit qu’elle a retrouvé ces lignes, qu’elle n’y a pas touché, que la littérature n’y a rien ajouté; mais on peut aussi, je pense, ne pas la croire. Moi je ne la crois pas. D’autant qu’écrire, rien qu’écrire, ce comme elle le dit, a postériori et pas sur le vif, c’est transformer. Par l’imaginaire, le souvenir, le mensonge et le style. Des mots justes qui, je pense, s’approchent de la vérité sans jamais l’atteindre.
Et puis finalement, quelle importance ? Que l’histoire coïncide avec les données objectives, que l’on puisse accoler le passé historique et son fac-simile, quelle importance ? Qu’est ce qui importe vraiment, sinon les sensations, les émotions, les sentiments qui saturent le livre, qui le saturent autant que les corps qui reviennent sont vides de vie ? On s’en fiche que ce soit vrai ou pas ; ce qui compte, c’est le livre, ses mots et les images, souvent terribles, qu’il nous laisse. Terrible mais aussi follement émouvantes, flirtant avec l’espoir et l’abandon.
Un très beau témoignage, roman, épanchement, ce que vous voulez… Surtout la première partie ; celle qui raconte l’attente. La seconde lui est antérieure, chronologiquement. Encore un détour qui met la puce à l’oreille… Ou pas… De toute façon…
J'ai oublié de dire que ce texte contient la description quasie organique du retour à la vie d'un déporté. Un témoignage(on pourrait encore discuter ce terme!) étonnant, rare et poignant.



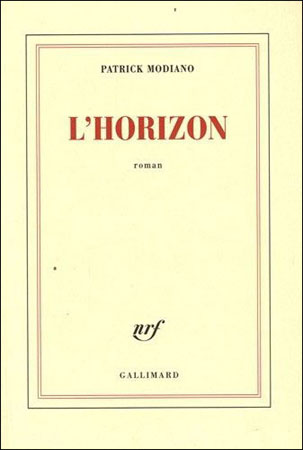 L’Horizon, Modiano
L’Horizon, Modiano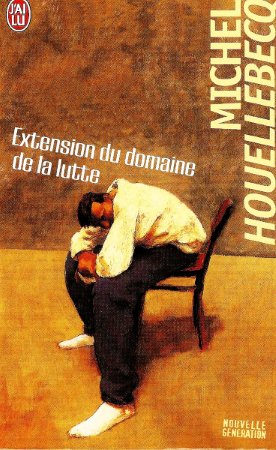 Extension du domaine de la lutte
Extension du domaine de la lutte La guerre de Troie n’aura pas lieu
La guerre de Troie n’aura pas lieu