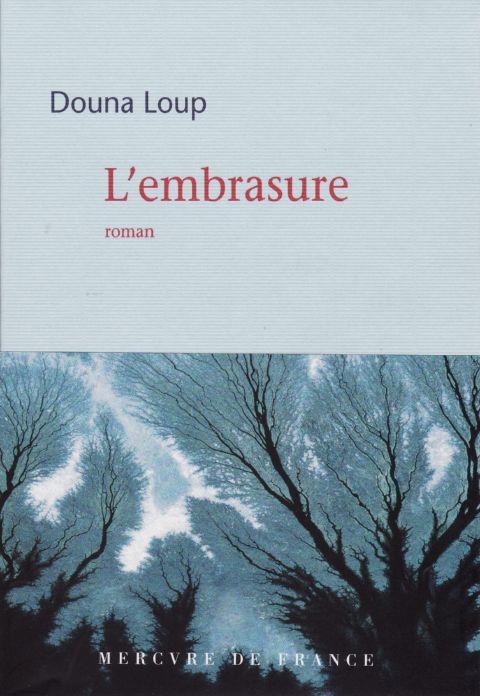 L’embrasure, Douna Loup
L’embrasure, Douna LoupJe ne devais pas lire ce roman. Et puis finalement j’ai lu la première page, j’ai continué, et finalement j’ai dépassé les cinquante premières pages, et puis, au bout d’un moment, un court moment, c’était la fin.
La fin du livre mais le début de quelque chose. La fin de l’ambiance feutrée et poétique de l’intériorité célibataire. La progression sensuelle de l’approche de la bête, qu’on ne cherche pas à tuer, sous le couvert des arbres, mais à apprivoiser.
Et surtout, ce roman, c’est selon moi le roman de la Femme. Certes le narrateur est un homme ; vingt-cinq ans, orphelin, chasseur et travaillant en usine pour pouvoir retrouver sa forêt le week-end. Son grand-père l’y a initié, et ce Lou des bois (facile je sais… !) il le retrouve souvent, pour parler de lui, de la chasse, de ses parents. Il vit seul, sort peu, et n’a qu’une femme dans sa vie : la forêt.
Comme toutes les femmes, elle est tentatrice et castratrice. Elle porte en elle Eros, mais son double Thanatos n’est jamais bien loin. Alors un jour, en pleine partie de chasse, le narrateur tombe sur un mort…
Ce mort le hante, un peu. Il est perturbé. Il prend des vacances et sort dans les bars. Dans l’un d’eux il rencontre Eva, ou Zora, on ne sait pas, en tout cas elle, elle ne veut plus être Zora. Il la rencontre, l’emmène chez lui ; elle, elle le menace d’une arme. Il ne comprend pas pourquoi elle fait ça… Finalement il reste avec elle. Finalement ils restent ensemble ; malgré ce qu’il s’était toujours promis ; malgré le fait que toujours il avait dit qu’il ne se chargerait pas d’une femme…
Avec elle je peux vivre dans un seul espace sans me sentir à l’étroit, je peux apprécier ce qu’elle me donne de présence et lui dire aussi la solitude dont j’ai besoin sans qu’elle s’écroule, parce qu’elle est forte. Forte en elle-même. Je ne me sens pas dans la dépendance ni les minauderies des femmes qui se prétendent amoureuses. Eva sera ma femme sœur qui me comprend, me révèle, sans chercher à m’enfermer. Entre nous, il n’y aura que le meilleur.
Elle est tout, Eva : la Diane chasseresse, la femme paysage, la femme citadine, la femme fatale, la femme idéale et même la femme-sœur. Derrière elle il y a toutes les femmes, elle est de tous les mythes et surtout de tous les poèmes.
La femme sœur de Baudelaire, quand le poète l’invite au Voyage… (même si là c’est elle qui l’invite, et qu’il n’est pas poète, juste chasseur, mais la poésie, elle est partout, saturant le texte de ses collages inattendus...)
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble
…la femme idéale du Rêve Familier, de Verlaine
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue et que j’aime et qui m’aime
Et qui n’est chaque fois ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, qui m’aime et me comprend
Car elle me comprend, et mon cœur transparent,
Pour elle seule, hélas, cesse d’être un problème
Pour elle seule ……….
Une femme dont il ne sait trop ce qu’il va faire, avec qui il ne sait trop que faire, et que peu à peu il va apprendre à aimer. Une femme dans l’embrasure, qui lui apparaît comme unique et comme indispensable. Une femme-embrasure, qui n’attendait que lui, qui n’attendait que ça, que de s’installer là, avec lui, tranquillement…
Parce que c’est ça une embrasure, dans le bâtiment : une fente dans la largeur du mur, faite dès la construction, en attente d’une porte ou d’une fenêtre. Eva a été cette porte, ou plutôt cette fenêtre.
En plus de cela, il y a plein de métaphores comme je les aime dans ce roman, on peut construire des réseaux, des liens, des ponts… Il y a la solitude, l’idéal, la mort, la forêt, la femme, j’en passe… Il y en a sûrement plein d’autres que je n’ai pas vues. Bref, un roman qui souffle la poésie, un texte magnifique, que je relirai avec plaisir, presque comme un recueil.
Je crois que l’auteur est suisse. Je ne sais pas si elle a lu Baudelaire. Je pense. En tout cas, je l’ai vu souvent, entre les mots. Et même, le narrateur, c’est peut-être un peu un poète.


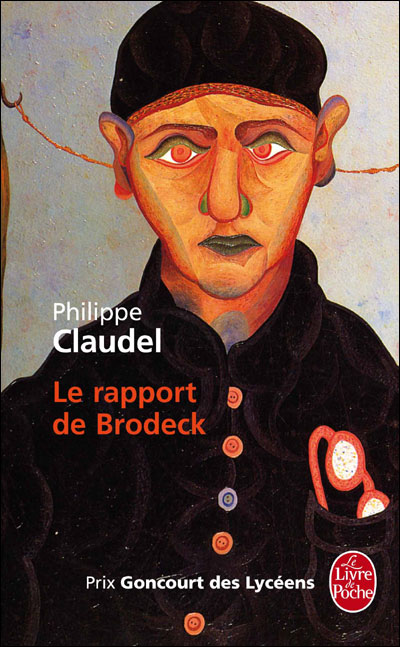 Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel
Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel Hernani, Victor Hugo
Hernani, Victor Hugo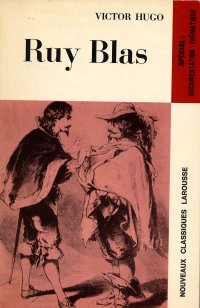 Ruy Blas
Ruy Blas Le livre de ma mère, Albert Cohen
Le livre de ma mère, Albert Cohen