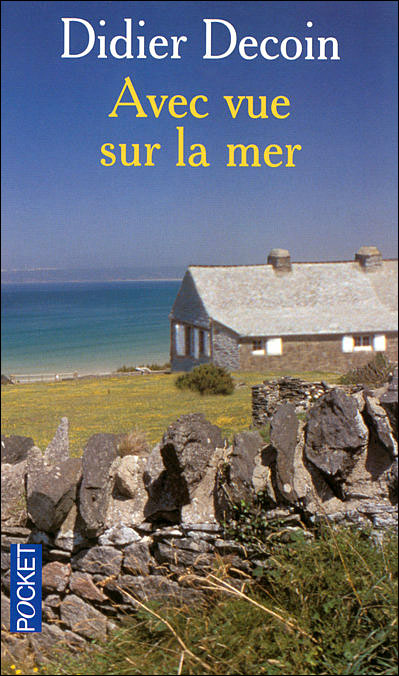 Avec vue sur la mer, Didier Decoin
Avec vue sur la mer, Didier DecoinOn dit souvent que les livres et leurs histoires sont faits pour s’évader, pour aller à la rencontre de paysages et de personnages inconnus. Lire c’est se dépayser ; lire c’est décoller ; lire c’est rencontrer. Mais avec ce roman là, lire, c’était renouer. Renouer avec une région que j’aime, des noms dont les sonorités m’évoquent des paysages et des sensations, des odeurs de varech, le bruissement des vagues, les épines des mûriers, les petits chemins et les galets des plages. Les roches à pic, le phare de Goury… Toute la Hague est concentrée dans ce livre. Avec ce roman, l’auteur célèbre ce coin trop souvent ignoré, entre la France et l’Angleterre, pourtant bien français, loin de tout et pourtant si proche de la terre et de ses racines ; et proche, surtout, de la mer.
Toutefois, on est loin de l’ode dithyrambique. C’est avec beaucoup d’humour et de dérision que Didier Decoin raconte son coup de foudre enfantin pour cette région où la mer si merveilleuse peut prendre l’apparence d’une "marmite de vomi en ébullition" ou d’un "ogre affamé". Des années plus tard, malgré l'usine (de retraitement des déchets nucléaires) qui a poussé là bas, il n’a qu’une idée en tête : y retourner. Mais l’acquisition de la maison de ses rêves ne sera pas une mince affaire. Avec sa femme, ils écument le coin et les agents immobiliers, mais tout ce qu’on leur propose, ce sont des granges insalubres ou des habitations un peu sordides qui sont dépourvues de l’essentiel : cette fameuse « vue sur la mer ». Car contre toute attente, dans la Hague, les maisons à vendre se font plus rares que tout le reste. De cette région dont le nom signifie « enclos », les hommes ne partent guère… Toutefois un jour, un peu comme par magie – mais tout n’est-il pas un peu fantastique dans la Hague, région aux multiples légendes et aux paysages surréalistes- ils découvrent, dans le hameau La Roche, la maison idéale et … à vendre.
Reste ensuite à la bichonner, cette maison qui devient comme une amante que l’on se doit de combler. Ici réside le charme de l’écriture de Didier Decoin : donner une âme aux choses inertes. Sous sa plume, la maison prend des allures de grand corps auquel il faut redonner une santé avant de le parer. Chaque pièce, chaque parcelle de terrain à son importance ; tout comme l’environnement. La maison de la Hague est un microcosme à l’équilibre vaillant, résistant aux tempêtes les plus violentes, mais qui nécessite tous les égards. Un havre de paix, ça se cultive.
Cette maison qui sent la figue, dont le jardin est une reproduction en miniature du paysage de la Hague – avec ces murets de pierre caractéristiques-, qui est traversée par les lumières des phares et bercée par les vents, est certainement le lieu idéal pour travailler et s’inspirer. Les paysages ont quelque chose de magique dans leurs contrastes, le ciel prend des éclats de palette et de peinture à l’huile, la mer côtoie la terre en une harmonie digne des plus grands tableaux. On ne peut que se sentir artiste dans ce lieu où les herbes de la lande, les fleurs des bruyères, et les bleus du ciel et de la mer se marient si bien, où le vent qui souffle nous traverse, où les pierres dissimulent une histoire. Tout semble parler à l’âme, à qui tend l’oreille, à qui ouvre les yeux.
Plus que l’autobiographie en creux d’un écrivain, plus que le récit d’une recherche et d’une rencontre amoureuse entre une maison et ses habitants, ce roman, lu d’une traite, est pour moi le roman de la reconnaissance.
Je ne sais si je le conseillerais à ceux qui ne connaissent pas la Hague. Allez-y d’abord ; lisez ensuite. Ou inversement peut-être…
Quoi qu’il en soit, en passant au hameau La Roche, je penserai à ce livre, à cet auteur. A cet Académicien aussi, que j’imaginais déjà en train de lire ces piles de livre, ces futurs Goncourt, dans une chaise longue, sous un palmier. Grâce à ce livre, je vois les piles, la véranda, la pièce de travail avec vue sur la mer, la petite palmeraie et les figuiers de la façade. Et peut-être qu’un jour, mes yeux, vraiment, verront. Alors, une autre image se superposant à celles que j’ai déjà formées, le tableau de la petite maison de la Hague sera terminé. Mais un paysage de la Hague peut-il être achevé ? Il me semble bien plutôt que, tels les séries impressionnistes, ils sont des instants fugaces que l’on saisit sans jamais les revoir… et sûrement que jamais, moi non plus, je ne pourrai terminer le tableau!
Quoi qu’il en soit, en passant au hameau La Roche, je penserai à ce livre, à cet auteur. A cet Académicien aussi, que j’imaginais déjà en train de lire ces piles de livre, ces futurs Goncourt, dans une chaise longue, sous un palmier. Grâce à ce livre, je vois les piles, la véranda, la pièce de travail avec vue sur la mer, la petite palmeraie et les figuiers de la façade. Et peut-être qu’un jour, mes yeux, vraiment, verront. Alors, une autre image se superposant à celles que j’ai déjà formées, le tableau de la petite maison de la Hague sera terminé. Mais un paysage de la Hague peut-il être achevé ? Il me semble bien plutôt que, tels les séries impressionnistes, ils sont des instants fugaces que l’on saisit sans jamais les revoir… et sûrement que jamais, moi non plus, je ne pourrai terminer le tableau!


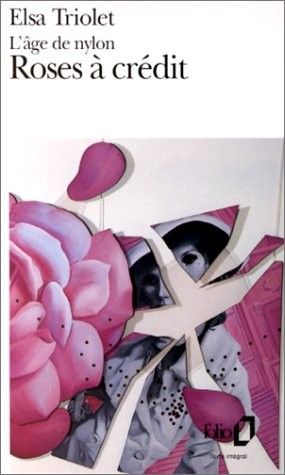 Roses à crédit, Elsa Triolet
Roses à crédit, Elsa Triolet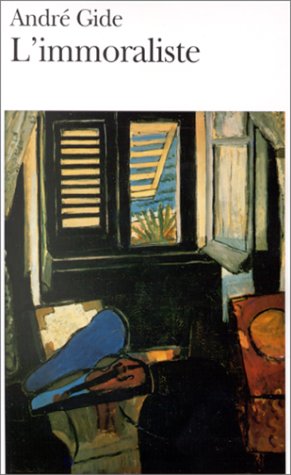 L’immoraliste, André Gide
L’immoraliste, André Gide L'année de l'éveil
L'année de l'éveil Lambeaux
Lambeaux