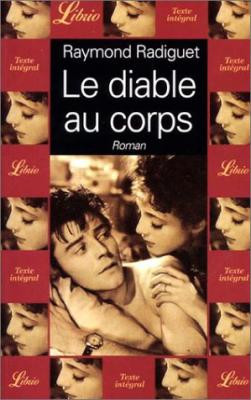
" Ce petit roman d’amour n’est pas une confession, et surtout au moment où il semble davantage en être une. C’est un travers trop humain de ne croire qu’à la sincérité de celui qui s’accuse ; or, le roman exigeant un relief qui se trouve rarement dans la vie, il est naturel que ce soit justement une fausse autobiographie qui semble la plus vraie " (Les Nouvelles littéraires, 10 mars 1923).
Ceci n’est pas l’histoire de Raymond Radiguet; lui-même le dit. Et pourtant…
Ce jeune garçon qui s’éprend d’une jeune femme, Marthe, laquelle vient de se marier et a 3 ans de plus que lui, pourrait bien être la sienne. Raymond Radiguet n’a vécu que 20 ans. Vingt ans c’est peu, mais ça laisse le temps de vivre, et surtout de vivre une histoire d’amour. Même une véritable passion.
Ce court roman nous décrit toutes les dimensions de cette passion qui occupe les deux jeunes gens au point de leur faire oublier le reste, ou presque. Le narrateur est donc un jeune lycéen brillant, qui étudie peu mais réussit bien, curieux de tout et de la vie en particulier. Un jour on lui présente une jeune fille, fiancée à un soldat, et qui peint des aquarelles médiocres. N’empêche qu’il s’en éprend.
Quelques temps plus tard il la croise lors d’une promenade en ville, il passe la journée avec elle, choisit les meubles de sa future chambre à coucher, bref, s’immisce dans sa vie. Puis plus de nouvelles. Enfin, un jour, elle l’invite chez elle et là…
Rien que de bien ordinaire. Mais le tout est raconté avec beaucoup de finesse, et l’analyse du sentiment amoureux y est bien rendue.
Bien que mon amour me parût avoir atteint sa forme définitive, il était à l’état d’ébauche. Il faiblissait au moindre obstacle.
Donc, les folies que cette nuit-là firent nos âmes, nous fatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unes semblaient nous reposer des autres ; en réalité, elles nous achevaient. Les coqs, plus nombreux, chantaient. Ils avaient chanté toute la nuit. Je m’aperçus de ce mensonge poétique : les coqs chantent au lever du soleil. Ce n’était pas extraordinaire. Mon âme ignorait l’insomnie. Mais Marthe le remarqua aussi, avec tant de surprise, que ce ne pouvait être que la première fois. elle ne put comprendre la force avec laquelle je la serrai contre moi, car sa surprise me donnait la preuve qu’elle n’avait pas encore passé une nuit blanche avec Jacques.
Un beau passage mettant à l’honneur la figure du cop à l’âne (l’âne étant Jacques), où pourtant tout est logique, tout s’enchaîne et s’explique ; ce serait presque du flux de conscience. La passion et les aventures amoureuses à l’état brut. Il nous raconte tout, sans détails pourtant, synthétique quand il le faut, poète quand il le veut. Il nous raconte tout de cette grande passion d’un an, perturbée uniquement par les permissions de Jacques, ses lettres, et les parents de la jeune épouse. Le père du narrateur, étrangement, ne cherche pas tant que cela à le détourner de cet amour. Une empathie d’ancien épris ? Quoi qu’il en soit peu de choses, et finalement peu de gens, viennent compromettre cette passion qui s’abreuve de promenades et de journées passées au lit. Jusqu’au jour où Marthe tombe enceinte et où tout s’accélère…
Un court roman que j’ai beaucoup aimé (et dont pourtant je parle mal...). Pour un si jeune auteur, le style est vraiment agréable, la réflexion juste, le rendu fort proche du vrai. On s’y croirait ! Autant dire que je le conseille vivement. Ce bouquin a été adapté en film, mais je ne l’ai jamais vu encore. J’y penserai maintenant.
Une dernière petite chose : le titre provoque certaines attentes de lecture dont l’intensité s’avère être finalement atténuée. Certes avoir le diable au corps renvoie bien à l’enfance et à la jeunesse de ce narrateur qui connaît à 17 ans ce que certains hommes ne connaissent pas au cours de toute une vie. Cependant, pour un gamin, il n’est pas fou furieux, et gère la situation avec un certain pragmatisme, de manière assez posée et réfléchie. C’est surtout lors de leurs étreintes et dans le plus fort de sa passion qu’on peut dire que le jeune homme avait véritablement le diable au corps. A moins que cette manière assez mûre de prendre les choses ne soit due à ce style qui rend compte d’une introspection raisonnée et lucide. Parfois, souvent même, il avoue sa fougue et les relâches de sa jeunesse…



