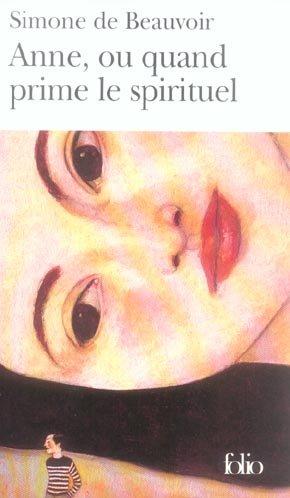 Anne, ou quand prime le spirituel, Simone de Beauvoir
Anne, ou quand prime le spirituel, Simone de BeauvoirLe premier roman de Simone de Beauvoir. Non pas le premier a avoir été publié, parce qu’il a été refusé à l’origine par les éditeurs. Mais le premier à avoir été écrit. Je ne sais même pas si on peut parler de roman, puisque la forme de ce livre est assez originale. En cinq « nouvelles », l’auteur nous brosse le portrait de cinq femmes aux destins croisés, mais dont le point de départ est le même : la naissance dans une famille bourgeoise ou petite-bourgeoise, dans laquelle « prime le spirituel ». Autrement dit, une famille catholique bien pensante. Il y a Marcelle, la désenchantée, Chantal, qui cherche à s’installer, à profiter du bonheur que peut lui donner la vie – un peu niaisement des fois, j’ai trouvé…-, Anne, qui est victime de cette primauté du spirituel, ou encore Lisa, amoureuse, et enfin Marguerite, elle aussi déçue par la dévotion, même si elle fut de nature profane.
Autant de profils de femmes dont on peut, comme souvent chez Simone de Beauvoir, essayer de trouver les correspondances réelles. Ainsi Chantal c’est un peu Simone des débuts, jeune enseignante passionnée, adulée de certaines, et cherchant à l’être. Mais enfin, ce genre de lecture reste un peu abusif. Pas la peine de faire du Sainte-Beuve (la vie de l’auteur éclaire l’œuvre et blablabla). Cependant une chose est sûre : Anne, c’est Zaza, alias Elisabeth et vice-versa, l’amie d’enfance de l’auteur, morte d’on ne sait quoi, même si c’est probablement d’un excès de spiritualité. Je n’en dirai pas plus.
Du moins pas sur ce point ! Parce que sinon, j’ai un certain nombre de choses à évoquer à propos de ce livre, dont des déceptions. Je me suis ennuyée au début. J’ai trouvé les héroïnes des deux premières « nouvelles » trop bien pensantes, rangées, à la limite de la niaiserie et du ridicule. Donner sa vie pour les autres en prétendant ne rien attendre en retour (alors qu’en vérité ça n’est qu’hypocrisie…), trouver que le ciel est toujours bleu, que tout le monde est beau et gentil… Ahlàlà… Et puis vlan. Leur vie finit plus mal qu’elle n’a commencé. Elles se rendent compte qu’il y a quelque chose de pourri là-dessous… There is something rotten… ! Et c’est là qu’on se rend compte que la prose de Simone de Beauvoir, qui retranscrit les pensées de ses personnages selon divers modes, du monologue intérieur au journal intime, et concluant sur la première personne du singulier pour Marguerite (elle, je l’aime bien !), bref, que cette prose est en fait profondément ironique. Le discours indirect libre, délicat à discerner parfois, en témoigne. Toutefois, même sachant cela, je n’ai pu m’empêcher de m’ennuyer en débutant ma lecture. Quoi qu’ennuyer n’est peut-être pas le mot juste… Au contraire, je crois que j’ai été très stimulée, puisque je n’avais qu’une envie, leur donner un coup de pied aux fesses à ces jeunes filles bien pensantes, bien mises et bien dévouées. Et puis il y a eu la nouvelle centrale, Anne (d’où est extrait le titre de cette deuxième édition), et son énigme finale. Pourquoi, alors qu’elle aime Pascal, Anne meurt-elle ? Probablement parce que, quand prime le spirituel, c'est la folie et la mort qu'on rencontre...
Et à la fin, la bonne surprise : Marguerite. Une « nouvelle » à la première personne, sans trop de bons sentiments. Une jeune fille qui exploite sa liberté, alors que les autres font sans cesse preuve de mauvaise foi (je pense par exemple à Chantal qui se dit ouverte et à l’écoute, et qui s’avère incapable de venir en aide à une de ses « petites protégées » alors que cette dernière se trouve dans le plus grand embarras, gggrrr ! Tout ça pour finir bien rangée, mariée à un homme de bonne situation…). Marguerite avait pourtant tout pour être l’archétype de la jeune fille rangée étant jeune : dévote, bonne élève, cultivée, dévouée. Et puis tout à coup, tout se dégrade. Pourtant, elle ne perd pas totalement ses préjugés. Enfin, si elle déplace le centre de sa dévotion, si son nouveau matériau spirituel devient son paumé de poète d’ex beau-frère (ça semble compliqué, mais c’est là que c’est intéressant !) c’est pour se rendre compte que là aussi, tous pourris !
Toutes ces histoires finissent plutôt mal, ou de manière plate, affligeante. C’est la vie de toutes ces femmes excessivement « spirituelles » qui est affligeante en définitive. Elles se bercent d’illusions, engourdies qu’elles sont dans les préjugés de leur classe, n’usant qu’avec peine de leur liberté, au prix d’une rupture avec leur famille.
Tout au long de ma lecture j’ai eu envie de leur crier d’arrêter de se voiler la face, de reconnaître la boue dans laquelle elles vivent, de leur montrer qu’elles ne marchent pas sur le joli sentier de cailloux blancs qu’elles imaginent, mais en plein dans la flaque.
Je ne sais pas trop où en était Simone de Beauvoir dans sa réflexion à ce moment là. En tout cas, je pense (et surtout j’espère !) que ce livre est bien bourré d’ironie. J’apprécie trop cet auteur pour croire que mon ennui serait issu d’une certaine médiocrité. Non, en y réfléchissant, et en re-parcourant la préface de Danièle Sallenave, je suis convaincue : c’est une satire de ces criminels bourgeois bien pensant, ces « belles-âmes », menteuses, ridiculement dévotes et se vautrant dans la mauvaise foi. Bref, un récit qui m’a fait dresser les cheveux sur la tête, sauter des lignes et tressaillir, de dégoût ou d’admiration. Parce que tout de même, j’aime la manière dont Simone de Beauvoir met en scène ses idées, et défend ce qui lui fait, à elle aussi, dresser les cheveux sur la tête.


 La douleur, Marguerite Duras
La douleur, Marguerite Duras
 Les caves du Vatican, André Gide
Les caves du Vatican, André Gide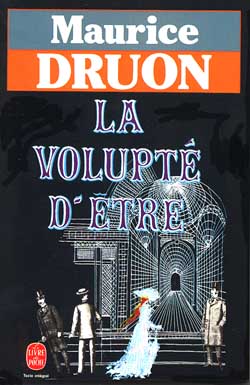 La volupté d’être, Maurice Druon
La volupté d’être, Maurice Druon