 Le désert de l’amour, François Mauriac
Le désert de l’amour, François MauriacLe Monde dans les Livres
Vendredi 22 avril 2011 à 23:37
 Le désert de l’amour, François Mauriac
Le désert de l’amour, François MauriacSamedi 30 avril 2011 à 10:43
 Les noces barbares, Yann Queffélec
Les noces barbares, Yann QueffélecVendredi 20 mai 2011 à 13:57
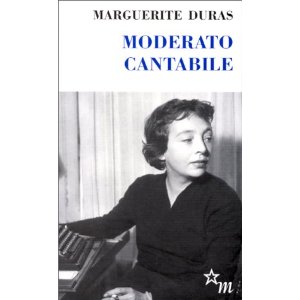
Modéré et chantant. Le petit garçon joue sa sonatine au piano, doucement. Il est récalcitrant mais il joue. Sa mère, Anne Debaresdes, l’écoute en souriant. La professeur n’est pas contente, elle râle, elle pousse, elle dispute l’enfant dont la mère sourit, heureuse. Cet enfant, c’est son trésor. Et tout à coup, alors qu'il ne peut répondre quand on lui demande ce que signifie moderato cantabile, un cri retentit dans la nuit.
Dans le café en bas de l’immeuble, une femme vient d’être tuée ; crime passionnel. Son mari se couche à ses côtés, geint, fini enfermé. Puis on n’entend plus rien. Anne, elle, a été émue par cet évènement insolite. Chaque jour, pendant une semaine, elle revient dans ce café où tout s’est déroulé. Sans relâche elle interroge un homme, un homme qu’elle séduit sans le vouloir, un homme qu’elle désire probablement sans le dire, autant qu’elle désire ce vin qu’elle boit, sans cesse, verre après verre, dans une gorgée presque éternelle. Son enfant chaque fois l’accompagne, il joue dehors pendant qu’elle boit dedans, mais elle n’est pas alcoolique, non, elle est simplement passionnée, passionnée de l’amour et de la passion même.
Avec l’homme du café elle aimerait connaître cet amour pour lequel on meurt, cet amour qui a conduit l’homme à tuer sa femme, on ne sait trop pourquoi. Mais tout s’arrête subitement, et on ne sait rien.
Une tranche de vie, réglée par la mort. C’est du Duras. Déroutant, pesant, mais épatant. Le style est sublime, pas un mot de trop, chaque virgule à sa place, des associations presque poétiques parfois, c’est beau et pesant comme un velours, c’est doux et brillant aussi, c’est sublime.
Un très court roman qui charme, modéré et chantant, un peu grave pourtant. L'amour est impossible alors Anne, nouvelle Emma, sorte de Léopold Blum de cette ville portuaire dans laquelle se déroule l'action, se promène ,boit du vin, reçoit et vit. Sensible et triste, heureuse et enivrée.
Jeudi 9 juin 2011 à 14:51
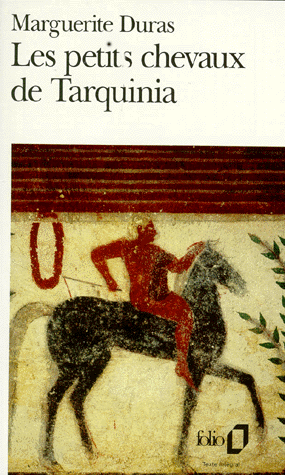
C’est beau… Voilà ce que je me suis dit en refermant ce livre. Un livre choral si je puis dire, un livre musical, un livre où on entend la mer et où tout se répète. Mais on ne s’en lasse pas. C’est beau et chaud comme l’atmosphère. La mer, la montagne, la baignade, la promenade ; en Italie. Ce sont les vacances et pourtant c’est triste. Pas pesant, mais triste. Une tristesse majestueuse, un peu racinienne.
On attend depuis le début quelque chose qui ne vient pas : quels mots Ludi a eu contre Sara pour qu’elle soit triste, ainsi ? Mais ne vous y méprenez pas : Ludi est son ami ; c’est Jacques son mari. Avec lui elle a eu cet enfant qu’elle aime tant et qui est là, silencieux mais présent, attachant, aimé, doré et chaud, ruisselant d’eau ou de sueur, ne réclament presque rien, juste de vivre dans cette chaleur, entouré de ces adultes. Un enfant comme chez Duras je crois, puisqu’il y a presque le même dans Moderato Cantabile. Un enfant calme qui joue, et qui n’est jamais bien loin de là où est sa maman. Toutefois Sara, comme la jeune femme de Moderato Cantabile, n’est pas seulement une mère ; elle est surtout une femme. Une femme dont s’éprend celui qu’on appelle l’homme, tout simplement, celui qui a un bateau, celui qui est libre et viril, sans attaches. Il a envie d’elle, et elle aussi, un peu. Pourtant leur passion n’aboutit pas, comme souvent chez Duras. Celui qu’elle adule, Sara, c’est son enfant.
Elle est un peu fatale Sara, un peu séductrice ; ce ne peut donc pas être elle la figure maritale de la vierge dans le livre. Pourtant il y en a une. Celle qui endosse le voile, c’est la vieille femme qui campe depuis trois jours dans la montagne ; les trois jours des quatre chapitres du roman. Elle reste dans la montagne, attendant de signer la déclaration de décès de son fils, mort en opération de déminage. La guerre, fatale même à rebours. Elle a ramassé les morceaux de son fils, les a mis dans une boîte à savon. Avec son mari, ils attendent dans la montagne. Le groupe des amis de Sara vient leur rendre visite. Ils sont accompagnés de douaniers aussi, dont l’un est l’amoureux de la bonne.
On se croirait presque dans du Ionesco. Il y a une bonne, deux couples, un enfant, un homme, et une femme dont on parle peu. Pourtant rien d’absurde, juste des silences, des paroles, et la vie.
Le thème de l’enfance est récurrent dans le roman, puisque les hommes en ont souvent le comportement. L’enfant de Sara est même plus sage et plus facile à vivre qu’eux. Et il y a des doubles : la bonne semble incarner la face sensuelle et aigre-rebelle de Sara. Les deux femmes se querellent souvent, mais jamais Sara ne peut se résoudre à la renvoyer. Elles sont liées l’une à l’autre par quelque chose qui dépasse l’entendement : l’amour indéfectible qu’elles vouent, l’une à la passion, l’autre à son enfant. A un moment donné elles semblent intervertir leurs envies, mais ce n’est que de courte durée. Sara se lasse vite de la passion que lui voue l’homme (un certain Jean, comme on l’apprend tardivement). Ce dernier est d’ailleurs lui aussi une sorte de double sensuel de Jacques. Il incarne ce que celui-ci n’offre pas à Sara : la passion amoureuse dont elle aurait besoin, parfois.
Dans ce roman il y a beaucoup de silences, beaucoup de calme, beaucoup de rêve. On agit peu, on rêve d’ailleurs, et pourtant on reste là où l’on est. On rêve aux petits chevaux de Tarquinia. Peut-être va-t-on aller les voir, en Amérique... On y pense en tout cas, c'est déjà ça.
L’atmosphère est chaude, mais pas suffocante. Le roman respire le quotidien ; le quotidien de l’amour, du rêve, de la vie telle qu’elle est quand on n’a rien à faire. Agréable mais lassante. On sent la lassitude derrière chaque page. Pourtant, sa lecture n’en est pas déprimante. J’aime le style de Duras je crois ; avec ses silences, ses lentes mouvances, son calme brillant. Beaucoup de dialogues, mais rien de trop. Des descriptions en forme de rêveries…
Alors elle les vit de dos tous les deux. L’un, elle le connaissait pour toujours. L’autre, non, elle ne le connaîtrait jamais davantage. L’autre était un homme qu’elle ne connaîtrait jamais davantage. L’autre devenait un homme qu’elle ne connaîtrait jamais. On ne peut pas faire toutes les vies ensemble, dit Ludi. Ces connaissances n’étaient pas compatibles. L’enfant, à côté d’elle, criait de plaisir. Seuls, le sillage d’un bateau et les premières vagues des embouchures intéressent les enfants. L’homme vira autour de la digue, très largement, puis subitement, à toute vitesse, il s’en alla vers la haute mer. Jacques, debout, n’eut pas l’air de s’étonner. La plage d’éloigna et avec elle, la masse verdoyante des champs de maïs au bord de la mer. Les choses en étaient restées au même point, en somme, avec cette différence que leur silence était maintenant violé.
Un style sublime, dans la retenue, la reprise, la recherche de la juste pensée, celle qui suit le déroulement logique de l’esprit, la correction, la répétition, la belle répétition… Et le réel qui s’impose, un réel un peu sublime, joli et contrasté, avec la mer et la campagne, les champs et l’onde marine. Et enfin, le silence…
Lundi 13 juin 2011 à 14:46

La mort du père, celle de la mère, le cousin Claude et l’admiration qu’il suscite, insondable et au bord du conscient. Voilà tout ce qui se passe dans ce roman à la première personne de Julien Green. Non, ça n’est pas une autobiographie, puisque le personnage qui dit «je » s’appelle Denis. Mais tout de même, je pense qu’on en est proche, dans le sens où, toujours, à travers l’écriture, transparaît la vision du monde et un peu de la vie d’un auteur.
C’est d’ailleurs ce qu’il dit a posteriori dans la préface (écrite à posteriori, mais située au début du livre et appelée préface...). Après tous les excès de la chair, les douleurs de la volupté, des plaisirs et des sens, Julien Green ressent le besoin de retrouver la sérénité et le calme ; pour cela, il se tourne vers son enfance. Mais au lieu de décrire son enfance au départ d’une promenade sur le pont de Paris, il invente l’enfance de Denis et de son cousin. Une enfance passionnée qui s’avère être le rêve littéraire d’une passion refoulée. Le tout sous couvert de la fiction.
J’avais besoin de souffrir en remplaçant ce qui fut par ce qui aurait put être et m’inventait une adolescence où Mark était présent avec moi. […] Quand le récit parut, quelques personnes crièrent à l’autobiographie. Je haussai les épaules. A part deux ou trois pages sur notre maison de campagne, presque rien dans cette histoire ne correspondait aux faits réels de ma jeunesse, mais comme tant de romanciers j’étais aveugle. Je faisais un tour de passe-passe dont j’étais le premier spectateur abusé. S’il n’y avait pas d’hallucination dans ce que l’écrivain nous raconte quand il peut inventer, il ne resterait plus beaucoup de poésie dans la littérature. Du plus profond de ses rêves surgit parfois le visage extasié de l’enfant torturé d’amour.
La réalité se trouve donc au-delà de la conscience, et parfois même au-delà du rêve. C’est d’ailleurs cette question du rêve qui est à plusieurs reprises soulevée dans le roman.
C'est une bizarrerie de mon esprit de ne croire à une chose que si je l'ai rêvée. Par croire, je n'entends pas seulement posséder une certitude, mais la retenir en soi de telle sorte que l'être s'en trouve modifié. Aussi, quelque insignifiante qu'elle soit, cette certitude vient toujours se mêler à mes pensées, mais il faut qu'elle pénètre en moi par la porte énéidienne qui livre passage aux songes véritables.
Les choses, les évènements, les êtres, ne prennent véritablement place dans nos vies qu’après avoir franchi la barrière de notre esprit et de nos rêves. On sent l’influence psychanalytique du XXème siècle derrière tout cela. Mais je ne peux m’empêcher d’y croire. Voilà un livre où j’ai découvert ce que longtemps je pressentais. Les mots sont écrits, l’expérience est rendue intelligible par la littérature. Seuls les mots d’un auteur auraient pu parvenir à rendre compte d’un tel phénomène. Comme dans les Pensées de Pascal (dont un extrait est cité en dédicace du livre), on peut aller jusqu’à penser que les moments de veille de nos vies sont pourraient être en quelque sorte un autre sommeil dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir.
Sinon ce court roman est surtout une introspection sur la morosité de la vie, des relations, de la solitude, le tout coloré d’une passion qu’on se refuse à voir. Encore une fois il est question d’homosexualité. Je ne sais pas ce qui fait que souvent, les écrivains préfèrent les hommes… peut-être le plaisir de la différence, et la passion de la souffrance (redondance… !)

