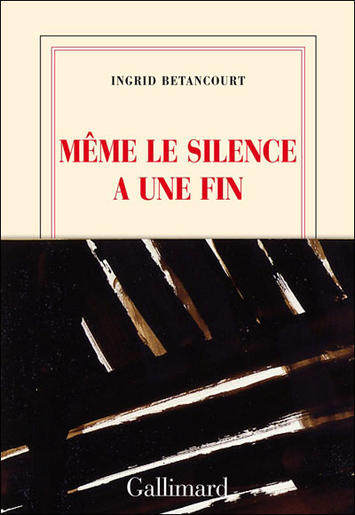 Même le silence a une fin, Ingrid Betancourt
Même le silence a une fin, Ingrid BetancourtMe voici arrivée au bout des sept cent pages du livre-témoignage d’Ingrid Betancourt. Me voici arrivée à la fin d’un long périple. Non pas que le livre soit long à lire ; non pas que sa lecture soit laborieuse. Si l’on est heureux d’en finir, c’est parce qu’on sait que pour elle, le calvaire est terminé. Totalement terminé. Enfermé dans ces lignes, dans ces pages douces au toucher, mais qui décrivent la plus grande souffrance. Celle d’être séparée des siens, celle d’être enfermée, celle de ne pas être libre. En privant les otages de la liberté, les FARC les privent de leur dignité, et par extension, de leur humanité. Sans volonté, sans s’accrocher, ils perdraient toute identité. C’est ce qui m’a frappée dans ce livre : tout ce qu’Ingrid Betancourt raconte, ce sont ces marches au bord du précipice, alors qu’elle et ses compagnons manquent de perdre ce qu’ils sont, et ces tremplins vivifiants vers une humanité sauvegardée. Rien de « trash », rien qui ne mette le lecteur en position de voyeur. Juste le récit du parcours d’une femme dans une jungle hostile où tout était fait pour qu’elle perde son identité, son humanité, sa dignité. Le passage le plus dur, le plus terrible, le plus humiliant, est comme rejeté au début. Vomi. Honni. Mais comme toutes les autres horreurs qu’on devine, entre les lignes, Ingrid Betancourt utilise la litote pour mieux les dire. Les grandes émotions sont inexprimables, et elle montre, en ne les effleurant qu’à peine de sa plume, qu’ils sont réels, et doivent être restitués dans toute leur violence. Dans ce cas, l’écriture est de trop ; cette écriture salvatrice mais qui pourtant stylise le réel, le transforme. Ecrire cette souffrance était impossible. Cela aurait été la trahir. Peut-être que j’extrapole, peut-être n’a-t-elle pas pensé à cela… Mais c’est ce l’impression que me donne son texte.
Un texte qui s’ouvre, in medias res, sur une fuite. Une tentative d’évasion. On ne comprend pas tout. On est entraîné dans cette course effreinée vers la liberté. Une liberté dont on ne saisit pas non plus tout de suite le prix. Mais un chapitre qu’on comprend ensuite, comme étant plus que nécessaire. Un chapitre qui a permis de commencer à écrire, dans une langue offrant la mise à distance. Ecrire suppose de poser des mots le réel ; de se le remémorer avant de le mettre en mots. L’espagnol était la langue des émotions ; le français a été celle de la maîtrise. Transformer le réel en espagnol eut probablement été une trahison trop grande…
Attention toutefois, je ne dis pas que ce qu’elle écrit est fallacieux, mensonger ! Pas du tout ! Je dis simplement que quand on écrit, fatalement, on sélectionne, on transforme, on grossit ou on omet. D’autant plus quand il s’agit de raconter plus de six ans de captivité. Et ce qui est captivant, frappant, c’est que, comme je l’ai dit, ce ne sont pas tous ces détails sordides que l’auteur raconte, tous ces détails qui ont du ponctuer cette vite dans la jungle, entourée de geôliers plus mesquins les uns que les autres le plus souvent, des hommes en plus, enfin bref… ce n’est pas cela qu’elle raconte le plus. Malgré les petites bêtes piquantes, malgré les blessures, malgré la saleté et le manque de nourriture, ce qu’on retient de ce livre, ce sont tous ces moments d’humanité, tous ces tremplins salvateurs qui lui ont permis de survivre. Tout ce qui touchait à la liberté, si infime soit-elle, tout ce qui avait trait à l’amitié, à la culture, tous ces stratagèmes pour tromper le désoeuvrement, bref, tous ces effrots surhumains pour, justement, rester humain dans un environnement qui n’avait nullement, lui, visage humain.
La jungle, ou la prison naturelle. Au milieu de cette jungle, un campement. Nomade le campement. Forcément, il ne faut pas se faire attraper par l’armée colombienne. Et dans ce campement, des baraquements, et souvent, trop souvent, des chaînes. Si l’on continue à ouvrir les poupées russes, ce qu’on trouve, c’est une humanité enchaînée, enchaînée à des hommes qui ont droit de vie ou de mort sur elle, enchaînée à des instincts de survie, mais parfois, aussi, enchaînée plus que tout à l’espoir. Parce que la plus petite poupée, celle qui est enfermée dans tout ça, c’est le cœur, le cœur capable d’aimer, de compatir, cherchant à ne jamais flancher. La dignité, le désir de liberté, voilà ce qui le meut. Moteur de toute vie, il est ce qui a permis à Ingrid Betancourt et ses compagnons de survivre. Malgré la pluie, malgré les nuits d’insomnie, malgré les mauvais traitements. Et ce sont les moments où ce cœur était à l’unisson des instants d’humanité que l’esprit a, semble-t-il, le mieux gardés en mémoire.
La vie en captivité est une vie terrible, mais une vie quand même. Il y a les compagnons qui se succèdent, la politesse faisant place à la jalousie, la jalousie à l’exaspération, l’exaspération à la réclusion. Parmi ces compagnons, il peut y avoir des amis. Lucho et Marc, la famille qui fut la sienne dans la jungle. Et puis les gardes, les sergents, les guerrilleros, les guerrillera, les FARC qui s’occupaient d’eux, les gardaient, indifférents, mais parfois se confiant, améliorant le quotidien, riant, et même, pour certains, ayant soif d’apprendre. Ils vivent aussi leur vie, une vie étrange, dans la jungle. Mais c’est leur vie ; une vie quand même. Ingrid s’attache à évoquer ces hommes, ces femmes, qui eux aussi rêvaient de liberté, s’étant enchaînés de leur plein gré à la vie militaire pour échapper à la rudesse de la vie civile. On cherche tous une vie meilleure. Certains se contentent de la jungle, alors que pour d’autres, l’espoir est ailleurs. Autant de destins croisés, autant d’hommes et de femmes emprisonnés.
La spiritualité et les mots ont aidé Ingrid Betancourt à survire dans la jungle. Encore une fois, les mots lui ont permis de se tourner toute entière vers sa nouvelle vie.
Est-ce la peine de vous dire que j’ai beaucoup aimé ce livre ? Admirablement écrit – quand on sait que la langue maternelle de l’auteur n’est pas le français-, dans une volonté de justesse et de précision, sans chercher à faire dans le sordide commercial, c’est une œuvre qui émeut et fait réfléchir à la fois. On ne s’apitoie pas sur le sort des otages, mais on vibre avec eux de cette volonté qui ne les lâche pas et les conduit, chaotiquement mais inexorablement, vers la liberté.
Je ne pouvais ni ne voulais résumer ces sept cent pages. Ingrid le fait, de toute manière, mieux que moi. Le plus intéressant étant, ce me semble, de réfléchir sur le combat d’une femme, qui lutte alors qu’autour d’elle, tout est silence.


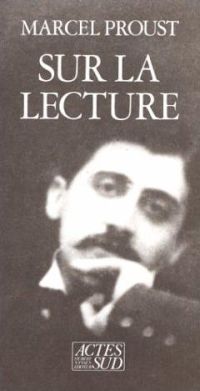 Sur la lecture
Sur la lecture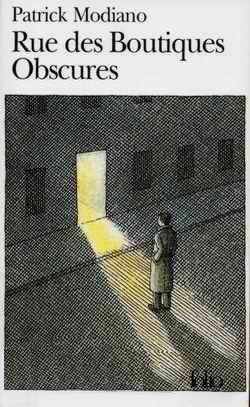 Rue des Boutiques Obscures, Patrick Modiano
Rue des Boutiques Obscures, Patrick Modiano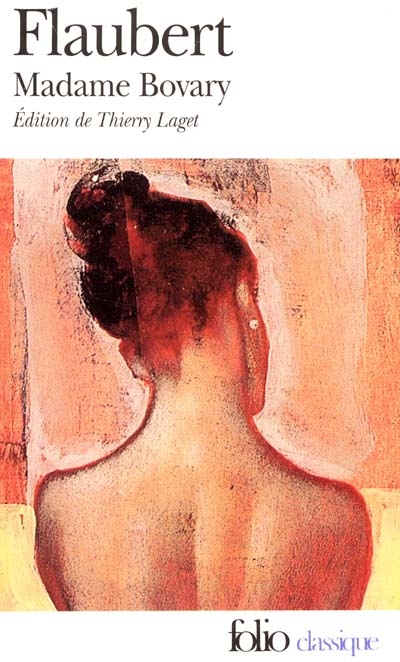 Madame Bovary
Madame Bovary Lambeaux
Lambeaux