 La porte étroite, André Gide
La porte étroite, André Gide"Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent ; mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la Vie, et il en est peu qui les trouvent."
C’est autour de ce verset de l’Evangile selon Saint-Luc que se cristallise notre histoire. Non pas qu’il revienne hanter le texte, tel un leitmotiv lancinant ; mais il s’est comme gravé à jamais dans l’âme des personnages, et son sens se distille doucement dans leurs jeunes esprits…
La vie de Jérôme (prénom biblique lui aussi…) est inscrite sous le signe du deuil et de la perte. Ce livre, dont il revendique la prétention de sincérité non-littéraire, est pour lui l’occasion de revenir sur ses souvenirs et ses souffrances. Il perd son père à douze ans, sa mère à dix-huit. Et son grand amour, c’est trop tôt et pour toujours qu’il s’arrache volontairement à lui…
Il lui semble l’avoir toujours aimée ; n’avoir aimé qu’elle, n’avoir connu qu’elle. Alissa. Elle, c’est uniquement pour lui qu’elle s’apprête et se fait belle. Pour ce cousin plus jeune qu’elle qui lui récite des vers de Baudelaire et de Shakespear dans le jardin de la maison de vacances normande de Fongueusemare. Et Juliette, la sœur aînée, qui écoute, dans l’ombre.
Depuis toujours, Jérôme pense se fiancer à Alissa. Mais sans cesse, cette dernière diffère sa réponse, évasivement. Pourtant elle aime ce cher cousin avec qui elle partage ses rêves de vertu et ses pieuses aspirations. Mais Juliette, la Junie de l’histoire, convoitée par de nombreux garçons, est peut-être ici plus proche de Néron… Que dis, j’aime, j’idolâtre…mais qui ?! C’est ce que le lecteur ne tardera pas à découvrir. C’est alors que l’histoire se complique. Pourquoi Alissa se refuse-t-elle ainsi à Jérôme, alors que la passion la dévore ?
Tu n’étais pas plus tôt sorti […] que cela m’a paru impossible, intolérable. Sais-tu que je suis ressortie ! je voulais te parler encore, te dire enfin tout ce que je ne t’avais point dit ; déjà je courais chez les Plantier…il était tard ; je n’ai pas eu le temps, pas osé… Je suis rentrée, désespérée, t’écrire… que je ne voulais plus t’écrire…une lettre d’adieu…
La typographie même du passage traduit ce déchirement qui détruit le cœur de la jeune fille ; elle aime mais se refuse. Et la question que je me suis posée est : mais pourquoi ? Juliette a trouvé un mari et même, semble-t-il, le bonheur. Le père d’Alissa, dont elle devait prendre soin, est mort. Qu’est ce qui la retient de se donner à celui avec lequel elle ne fait qu’un ? A celui avec lequel elle partage tout ? A celui auquel elle pense à chaque instant, jusque dans les pages des livres qu’elle aime et qu’il aime aussi ? Serait-ce cette aspiration divine, cette puissance mystique, cette porte étroite dans laquelle on ne peut passer à deux ? Cette porte étroite du sacrifice qui mène aux vertus ? Peut-être n’est-ce même pas un sacrifice, mais une fuite. Fuir par la porte étroite ce bonheur qui jamais ne sera complet. Ce bonheur matériel qu’elle honnit tant.
« Que peut préférer l’âme au bonheur ? » m’écriai-je impétueusement. Elle murmura : « La sainteté », si bas que, ce mot, je le devinais plutôt que je ne pus l’entendre.
Alissa devient de plus en plus pieuse. A Fongueusemare (mare de fange ?), elle semble s’enliser dans la religion ; et Jérôme sens alors qu’il la perd. Mais la tragédie du triptyque amoureux, entre Jérôme, Alissa et Dieu (ou une autre ?) trouve ici son paroxysme : jamais le jeune homme ne cessera de l’aimer.
-« Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ? »
- Oui, Juliette.
- « Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?... »
- Oui, Juliette.
- « Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?... »
Ce roman –récit dans le langage de Gide - est poignant dans sa simplicité. On pourrait reprocher à l’auteur de revisiter le poncif du triangle amoureux à la Britannicus, et redonne vie à une Princesse de Clèves bigote. Mais son style sobre, aux accents classiques, s’accorde tout à fait avec ce sujet, et le sublime.
En plus d’un beau style, ce récit autorise le lecteur (du moins celui que j’ai été !) à émettre plusieurs hypothèses quant au renoncement d’Alissa (ce qui est selon moi la qualité première d’un bon roman : celui qui laisse la place au lecteur et à son imagination). En outre, la profondeur psychologique de ces deux êtres qui ne font qu’un est d’une netteté confondante. Bien qu’Alissa joue un double jeu, on sent, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses gestes, tout l’amour qu’elle a pour Jérôme…mais aussi tout celui qu’elle semble avoir pour Dieu.
Le récit est homodiégétique (narrateur à la première personne, ici Jérôme) mais il se compose également d’un certain nombre de lettres, commentées ou non, le plus souvent fragmentaires, qui apportent un éclairage nouveau sur les agissements d’Alissa. Un roman complet, où l’intrigue se dévoile peu à peu, dans une mise à nu qui sentirait presque le mysticisme. Gide nous embarque dans son récit ; à nous d’être attentif aux indices et d’interpréter en conséquence, devançant parfois le texte lui-même.
Un très beau texte, encore, plus fouillé qu’Isabelle (intrigue et surtout personnages), mais dans la même veine. Un style sobre au service du thème du récit – la vertu et la spiritualité-, lequel d’ailleurs entre en opposition directe avec L’Immoraliste, autre récit de Gide que je possède et que je lirai avec d’autant plus d’intérêt. Une médaille n’est-elle pas faite pour avoir deux faces ?


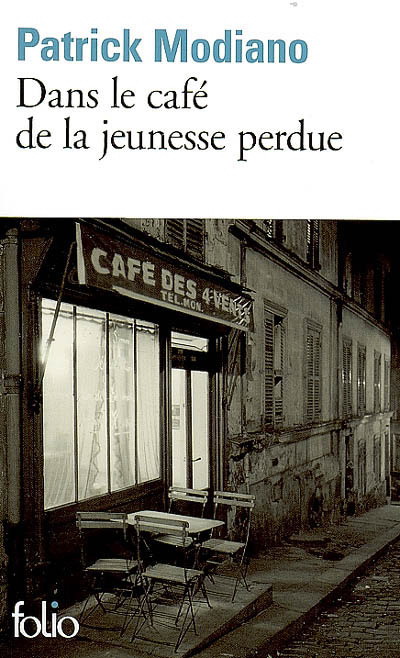 A la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue.
A la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue.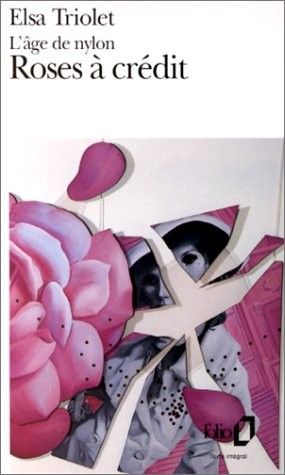 Roses à crédit, Elsa Triolet
Roses à crédit, Elsa Triolet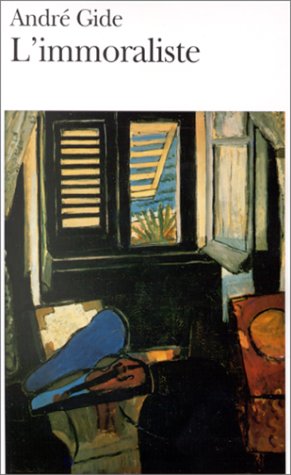 L’immoraliste, André Gide
L’immoraliste, André Gide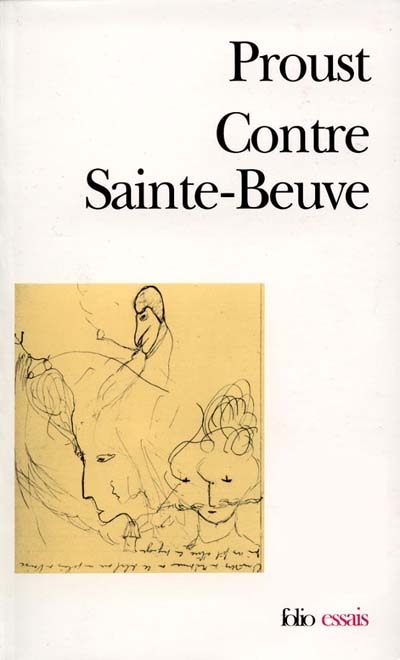 Contre Sainte-Beuve, Marcel Proust
Contre Sainte-Beuve, Marcel Proust