Un blog est avant tout un lieu de partage; j'ai donc trouvé sympathique l'idée de pousser le concept jusqu'au bout, en publiant ici un article qu'une de mes amies a écrit suite à une de ses lectures, et qu'elle m'a proposé de poster.
Comme dirai Rimbaud, "je est un autre" mais ceci n'est pas de moi!
Cela ne fera qu'enrichir ce blog, faire découvrir des auteurs et leurs romans, tout en partageant l'espace d'expression avec d'autres amoureux des livres.
Maintenant trêve de blabla, et bonne lecture!
Victoria et les Staveney
D. Lessing.
Une mûre parmi des framboises, la couverture dit déjà tout de l’œuvre. Victoria est cette petite fille noire de la banlieue de Londres à qui la chance ne sourit pas : sans père, une mère gravement malade qui décède au bout de quelques années, années durant lesquelles Victoria joua l’infirmière. Lieu commun, topos de la littérature me direz-vous ? Certes, mais c’est en renouvelant ces derniers que la littérature avance. Le décès maternel ne survient pas dès le début, mais l’incipit doit son lancement à un séjour hospitalier de la mère. Victoria, petite fille noire, attend dans la cour que l’on vienne la chercher. On l’a oubliée ? Oui, mais aussi, sombre soir d’hiver, on ne l’a pas vue, seul le petit garçon qui pleurait dans la cour a été sauvé de l’abandon. Elle est « la petite fille invisible », pour paraphraser H.G. Wells. Puis Edward Staveney, tout penaud, revient la chercher. Victoria est emmenée dans une grande maison pleine de couleurs, de lumière et de chaleur, une maison qui ne se limite pas à la cuisine et qui contraste tant avec l’appartement minuscule dans lequel elle vit avec sa mère. Toute sa vie, elle gardera un souvenir ému et prégnant de cette unique nuit dans la chambre de Thomas Staveney (le petit garçon qui pleurait), du temps passé dans les bras d’Edward qui la réconfortait. Toute sa vie, elle rêvera d’avoir « une chambre à soi », chose d’autant plus difficile qu’à la mort de sa mère, Victoria doit aller vivre chez Bessie et sa famille. Plus tard, cette fille brillante et remarquablement bien faite de sa personne recroise Thomas, devient sa petite copine estivale – lui qui est attiré par les jeunes filles noires et le zouk – et tombe en ceinte de Mary. La grossesse n’est pas révélée ; ce n’est que six ans plus tard que Thomas apprend sa paternité. Enfin une petite fille, elle est ravissante, si chou ! Tout le monde l’adopte et les Staveney lui offrent la vie dont Victoria avait toujours rêvée, mais Dickson, son frère né d’un autre père et enfant terrible, est laissé pour compte. Finalement, Mary achève ce que Victoria avait commencé.
Her advice : Victoria et les Staveney n’est bien sûr pas LE grand roman du siècle, mais il a tout pour plaire. Bien des grands thèmes sont présents, sans pour autant qu’ils ne soient exposés en de simples stéréotypes. Les différences sociales entre familles blanches et familles noires, la difficulté de s’en sortir dans la société lorsqu’on n’a pas accès aux meilleures écoles, la désillusion au moment où l’on revoit quelques années après ce qui nous avait tant émerveillé durant notre enfance, la difficile conciliation de deux mondes si opposés et la recherche d’une identité, l’absence du père, l’enfance insouciante et l’enfance sacrifiée... Mais surtout, tout le roman tend vers la réunion de deux univers réellement inconciliables. Victoria et Mary sont deux électrons libres ballotés entre deux pôles – ce vers quoi elles aspirent et la réalité sociale –, entre une famille américaine blanche de la classe moyenne, non raciste et assez aisée pour envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles, et son symétrique : la famille noire, engluée dans son « social background » et dont toutes les chances des enfants, aussi intelligents soient-ils, sont annihilées par l’impossibilité d’accéder à une école autre que celle du quartier où la criminalité ne cesse de faire des ravages. La vision est réaliste, pessimiste même : une union de ces deux familles est impossible, seuls des ponts (incarnés par Victoria et Mary) peuvent être établis. Tout un jeu de couleurs se déploie alors au fil du roman : noire Victoria, blanche la famille Staveney, caramel Mary, mais noir chocolat Dickson (le second enfant de Victoria dont les Staveney ne veulent pas entendre parler). Blessée du rejet de Dickson, Victoria est aussi prise dans un paradoxe : elle sait que les Staveney sont la meilleure chose qui puisse arriver à Mary, mais il faut prendre garde à ne pas tomber dans l’excès inverse, prendre garde à ce qu’ils ne lui prennent pas sa fille. Une solution est trouvée à la toute fin ; à vous de lire…


 La sensation de l’ennui naît en moi, […], de l’impression d’absurdité d’une réalité insuffisante, c’est à dire incapable de me persuader de sa propre existence effective. Il peut m’arriver par exemple de regarder un verre avec une certaine attention. Tant que je me dis que ce verre est un récipient de cristal ou de métal fabriqué pour contenir un liquide et le porter aux lèvres sans qu’il se répande, c'est-à-dire tant que je suis en mesure de me représenter ce verre avec conviction, il me semblera avoir avec lui un rapport quelconque, suffisant pour me faire croire à son existence et, par extension, à la mienne également. Mais faites que le verre se décompose et perde sa consistance de la façon que j’imagine, ou bien qu’il se présente à mes yeux comme quelque chose d’étranger, avec lequel je n’ai aucun rapport, en un mot s’il m’apparaît un objet absurde, alors de cette absurdité jaillira l’ennui, lequel est en fin de compte le fait de l’incommunicabilité et de l’incapacité d’en sortir.
La sensation de l’ennui naît en moi, […], de l’impression d’absurdité d’une réalité insuffisante, c’est à dire incapable de me persuader de sa propre existence effective. Il peut m’arriver par exemple de regarder un verre avec une certaine attention. Tant que je me dis que ce verre est un récipient de cristal ou de métal fabriqué pour contenir un liquide et le porter aux lèvres sans qu’il se répande, c'est-à-dire tant que je suis en mesure de me représenter ce verre avec conviction, il me semblera avoir avec lui un rapport quelconque, suffisant pour me faire croire à son existence et, par extension, à la mienne également. Mais faites que le verre se décompose et perde sa consistance de la façon que j’imagine, ou bien qu’il se présente à mes yeux comme quelque chose d’étranger, avec lequel je n’ai aucun rapport, en un mot s’il m’apparaît un objet absurde, alors de cette absurdité jaillira l’ennui, lequel est en fin de compte le fait de l’incommunicabilité et de l’incapacité d’en sortir. 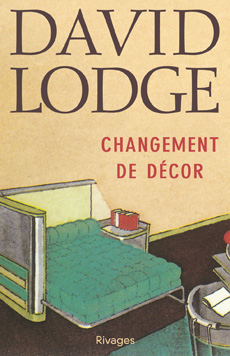 Changement de décor
Changement de décor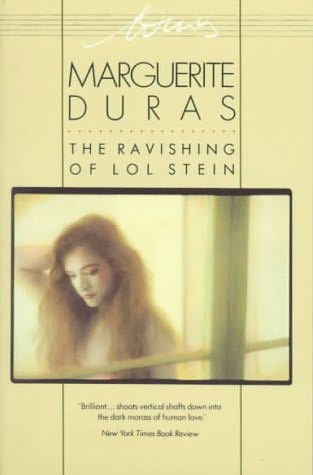 Le ravissement de Lol V. Stein, Marguerite Duras
Le ravissement de Lol V. Stein, Marguerite Duras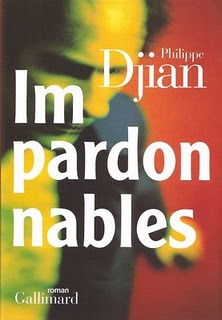 Impardonnables
Impardonnables