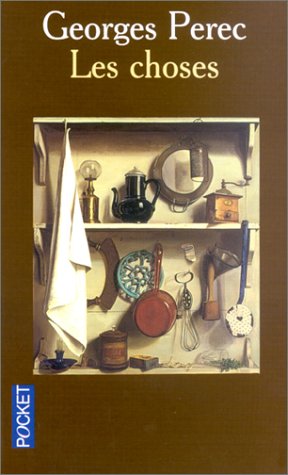 Les Choses, Georges Perec
Les Choses, Georges PerecCe n’est pas encore du Nouveau Roman, mais l’on n’en est pas loin. Personnages nommés mais jamais décrits, des silhouettes dont on nous répertorie les actes, les achats, les habitudes, et les envies. Sur le rythme d’un imparfait itératif, la vie sans saveur de ces petits-bourgeois se déroule, vaine…
Avec ce premier petit roman – petit en taille, grand par le talent, puisqu’il obtient le prix Renaudot en 1965-, Georges Perec fait œuvre d’exception. Non pas parce qu’il se fait sociologue d’une société de consommation des années 60 qu’il condamnerait – ce qu’on a trop souvent cru, et ce pourquoi on le fait lire parfois- mais parce qu’il nous livre une œuvre narrative aux modes déplacés, où le signe et les choses font loi.
Le roman s’ouvre sur un œil. Un œil géant qui voit et décortique tout ce qui fait –ou plutôt ferait- l’appartement rêvé des deux héros. Un incipit au conditionnel. Angoissant. Un texte qui décrit quelque chose qui n’existe pas ; un simple souhait ; un rêve. Un roman qui débute sur de l’irréel. On se demande où l’on va. Et puis on rencontre les personnages dont on a partagé le rêve. Dire qu’on les rencontre est un grand mot. On fait plutôt connaissance avec un jeune couple qui aurait aimé être riche. Car là est tout le malheur de Jérôme et Sylvie. Là est toute la question du roman.
Dans le monde moderne, le monde des technologies, le monde du luxe et du robot ménager, tout pourrait être plus facile. On pourrait être plus heureux, plus beau, plus parfait. Mais pour cela, une chose est nécessaire : l’argent. Et de l’argent, tout le monde n’en a pas. Notre jeune couple, par exemple, n’en a pas assez pour mener la vie de bobos dont ils rêvent. Toutefois, leur jeunesse est bohême : ils achètent leurs vêtements au marché aux puces, organisent de petits dîners entre amis, riz et anchois au menu, bonne franquette et alcool à gogo, lisent les journaux de gauche, lèchent les vitrines jusqu’à épuisement, rêvent devant les boutiques d’antiquaires. La personne s’efface sous les désirs, comme le personnage laisse place à la description, pire, à l’énumération, presque à la liste…
Au milieu de toutes ces choses, de tous ces objets, Jérôme et Sylvie courent après le bonheur. Mais pour être heureux selon eux en 1960, pour mener le style de vie dont ils rêvent – une vie de grasse mat’ et de flânerie éternelle, devant des vitrines toujours changeantes- il faut de l’argent. Or qui dit argent, dit travail. Mais qui dit travail, dit peu de temps libre. Impasse. Que faire ? Partir ? Pourquoi pas… ils commencent à se scléroser dans cet appartement exigu, encombré. Alors ils partent. Quelques pages sont alors au passé-simple. Le temps de l’accompli, du ponctuel, de l’acte unique. Mais vite, très vite, la routine les rattrape. Loin de chez eux, ils ne sont même plus eux-mêmes. Ils ne cherchent même plus à acheter toutes ces belles faïences, toutes ces choses qu’ils voient, qui brillent. Ils continuent à rêver, mais leur rêve s’embue.
Mais ils étouffaient sous l’amoncellement des détails. Les images s’estompaient, se brouillaient ; ils n’en pouvaient retenir que quelques bribes, floues et confuses, fragilisés, obsédantes et bêtes, appauvries. Non plus un mouvement d’ensemble, mais des tableaux isolés, non plus une unité sereine, mais une fragmentation crispée, comme si ces images n’avaient jamais été que des reflets très lointains, démesurément obscurcis, des scintillations allusives, illusoires, qui s’évanouissent à peine nées, des poussières : la dérisoire projection de leurs désirs les plus gauches, , un impalpable poudroiement de leurs maigres splendeurs, des lambeaux de rêves qu’ils ne pourraient jamais saisir.
Et puis ce style ! Un style envoûtant, berçant, aux longues périodes mélodiques ; autant dire que les énumérations passent toutes seules. Un empire du signe, une volonté de saisie du réel au plus près de ce qu’il est, mais toujours poétique – certains disent clinique, personnellement je trouve que c’est plutôt poétique…- teinté d’une certaine distance ironique de l’auteur. Ironique ou pathétique finalement, parce que cette prédominance de l’objet, de l’apparence au profit de l’intériorité, scelle la disparition de l’humain sous les choses. Quand le matériel prime le spirituel...
Je terminerai en disant que le roman se termine au futur, ce qui ouvre la voie au champ des possibles, mais c’est plutôt ici un futur qui fige, qui condamne, un futur qui montre que l’auteur maîtrise ce qui va se passer parce que, justement, ce qui va se passer est pathétiquement prévisible…
La quête du bonheur est un parcours sans fin, fait de rêves et d’ambitions déçues, voilà ce qu’on peut retenir de ce roman, qui va au-delà du simple pamphlet contre la société de consommation. Je laisse ici la parole à l’auteur, dans une interview qu’il a donné dans les années 60 :
Journaliste X : " Les choses " ? C'est un titre qui intrigue, qui alimente les malentendus. Plutôt qu'un livre sur les choses, au fond n'avez-vous pas écrit un livre sur le bonheur ?
Georges Perec : C'est qu'il y a, je pense, entre les choses du monde moderne et le bonheur, un rapport obligé. Une certaine richesse de notre civilisation rend un type de bonheur possible : on peut parler, en ce sens, comme d'un bonheur d'0rly, des moquettes profondes, d'une figure actuelle du bonheur qui fait, je crois, que pour être heureux, il faut être absolument moderne. Ceux qui se sont imaginé que je condamnais la société de consommation n'ont vraiment rien compris à mon livre. Mais ce bonheur demeure un possible ; car, dans notre société capitaliste, c'est : choses promises ne sont pas choses dues.
Lisez ce livre en écoutant Perec : pas de sociologie, mais de la littérature.


Bonne nuit, à bientôt, j'espère que ce commentaire te parviendra malgré les bugs de cow' !