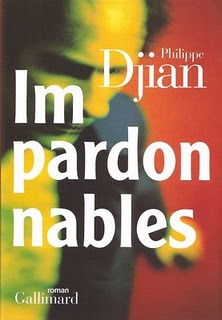 Impardonnables, Philippe Djian
Impardonnables, Philippe DjianJe viens fermer le roman, et j’ai le sentiment de rester sur ma faim. Est-ce le sentiment que Djian cherche à susciter chez le lecteur ? Probablement. Puisque dans ce roman, rien n’est jamais explicitement dit, tout n’est qu’évoqué, les évènements sont à déduire d’un mot, d’une phrase prononcée par le narrateur, Francis, un écrivain à succès auquel la vie ne sourit pas. Il a vu périr sa femme et l’ainée de ses deux filles dans un incendie, et quelques années plus tard, lorsque cette histoire commence, il doit faire face à la disparition de sa fille désormais unique, Alice. Devenue actrice, elle enchaîne les films et les excès en tous genres. Alors qu’il fait face à ce nouveau coup du sort, Francis nous livre ses pensées ; un évènement, une personne, un objet, font jaillir à sa mémoire des souvenirs, qui, on s’en rend compte, ne remontent pas à plus loin que le jour de l’accident.
Ce roman est comme un prisme, ou un réseau de bobines, dont les faces sont dévoilées sans suivre aucun ordre. Ni chronologique, ni thématique, rien, tout nous est donné comme ça, entre deux étoiles, celles qui séparent les paragraphes en autant de bribes, de lambeaux de vie. Les paragraphes s’enchaînent en suivant vaguement la ligne du temps depuis la disparition d’Alice jusqu’à la scène de fusillade…
La vie de cet écrivain qui survit grâce à des nouvelles publiées dans des magazines est un voile déchiré, en lambeaux, dont les fils pendants sont parfois déroulés pour nous révéler une bribe de l’histoire de cet homme sans cesse heurté par la vie. Un canevas complexe prend forme sous nos yeux, dont la résolution semble ne pas vraiment exister ; on ne comprend pas tout, tout est complexe, injuste, incompréhensible, à l’image de la vie. Pourquoi est-ce qu’Alice a disparu pendant deux mois sans donner de nouvelles, laissant place à tous les scénarios possibles, et est réapparue tout à coup, là où on l’attendait ? Pourquoi est-ce que Anne-Marguerite a succombé à son cancer ? Pourquoi est-ce que Judith, la seconde femme de Francis, celle grâce à laquelle il est revenu au monde, le trompe-t-elle avec Jérémie, le fils de A-M, ce gamin fou qui ne passe son temps à se battre, ne donne pas de nom à ses chiens et pleure comme un enfant à la mort du premier qu’il a adopté ? Judith qu’on ne voit jamais, qui fuit la compagnie de Francis après une dizaine d’années de vie commune, de vie manquée, ils se sont mariés trop rapidement, sur un coup de tête, ou plutôt dans un acte de survie.
Impardonnables… Tous sont impardonnables : Alice qui a disparu, Judith qui l’a trompé, Roger qui lui a menti, Jérémie, ce fils de substitution que je soupçonne d’être véritablement le fils de Francis, même A-M, Johanna et sa fille, emportées trop tôt, trop mal, trop injustement. Mais la vie c’est cela. Des coups durs, des choses inexplicables. On ne peut pardonner au destin de faire son office. Tout ce qui fait aussi mal est impardonnable… Impardonnables, ce titre au pluriel qui démultiplie les sujets de rancune, laisse présager que le pardon n’a aucune place dans ce roman. Et pourtant, avant la fin, il semble que Francis s’achemine vers le pardon, mais envers une seule personne… « Pourquoi elle ? » comme demande Alice. J’attendis qu’elle relève la tête, quelle me regarde dans les yeux, mais elle demeurait immobile. « Pour mille et une raisons, Alice », lui répondis-je.
Comment continuer à vivre quand il semble que tout soit perdu ? Seule l’écriture semble pouvoir empêcher Francis de sombrer. Lui qui n’arrivait presque plus à enchaîner deux phrases après l’accident, se sent soulevé par le désir d’écrire un roman. La littérature lui sauvera-t-elle la vie ?
N’y avais-je pas déjà un pied dans l’au-delà ? J’y pensais souvent depuis que nous nous étions séparés, Judith et moi – et l’extrême mauvaise humeur d’Alice, qui en soit n’avait guère d’importance, ajoutait encore à mon dépit. Des quatre femmes qui avaient donné un sens à mon existence, deux étaient mortes, une m’avait quitté, et la dernière refusait de m’adresser la parole.
Je remerciais le ciel de m’avoir donné la littérature. Je remerciais la littérature de m’avoir donné un travail, d’avoir subvenu aux besoins de ma famille, de m’avoir fait connaître les frissons du succès, de m’avoir châtié, de m’avoir grandi, et je ma remerciai aujourd’hui pour la main qu’elle me tendait encore, mais serait-ce suffisant désormais ? La littérature allait-elle tenir son rôle encore longtemps, pour ce qui me concernait ? Maintenant que j’étais seul, maintenant que la poussière retombait.
Francis est désemparé, même si dans toute cette histoire, on sent qu’il a des choses à se reprocher. Il est loin d’être parfait, il fait parfois les mauvais choix, n’agit pas toujours comme il faudrait, tout en tentant de de surmonter la douleur comme il peut. Je l’ai perçu comme un héros blessé mais s’efforçant de se relever, de parer les coups, plein d'autodérision qu'il est, mais qui ne peut empêcher son sang de couler et ses blessures de se rouvrir. Ce roman pose la question de l’amour, du deuil, de la souffrance et du pardon. Il interroge également la figure du père, de l’homme et de l’amant. Comment être père, amant et homme tout en souffrant ? Des sujets difficiles, mais que la construction hachée de Djian permet de rendre sans tomber dans le pathos ni l’édifiant.
Avec un roman pareil, le lecteur devient une sorte de détective, à l’affût de la moindre phrase pouvant être une piste, du moindre pronom ou adjectif pouvant constituer un indice dans cette quête de reconstruction, de compréhension. Encore un roman à l’image de son héros, déstructuré, déstabilisé, en équilibre précaire sans un monde où le pardon est impossible.
Ce que j’aime dans les romans de Djian, c’est ce flou qui demeure, ces questions qui planent, et qui donnent envie de relire le livre, dont le style est pourtant épuré, mais dont on semble ne jamais épuiser le sens. Chaque mot, chaque phrase compte, le lecteur est sans cesse en éveil, il ne faut pas manquer une bribe de cette œuvre qui entretient, jusqu’au bout, le mystère.
Aujourd'hui, mon avis... : Djian, c'est comme une petite musique grésillante, aux multiples coupures. Mais comme lorsqu'on écoute un morceau qu'on aime à la radio et que ça capte mal, on a l'impression de n'entendre que le meilleur. C'est un peu ce que je ressens à la lecture de ses romans, comme si'il disait l'essentiel, sans s'embarasser. En cela il peu paraître dur, mais au moins il ne s'encombre pas du paraître et nous plonge directement dans ce qui fait la profondeur et parfois la noirceur de l'être.
J'aime vraiment ce style coupé, fissuré et pourtant poétique, où une description en quelques lignes d'un coucher de soleil ou de la lande sous la tempête, cotoie des remarques sur les courses qu'il reste à faire, le chili qui cuit dans la casserole (37,2°!) ou les dernières parties de jambes en l'air sous les draps. Une écriture charnelle, à vif, qui ne laisse pas indifférent!
Lien vers une interview très intéressante de Djian : http://www.telerama.fr/livre/philippe-djian-inventer-une-histoire-est-sans-importance-c-est-la-langue-qui-compte-et-elle-seule,29528.php
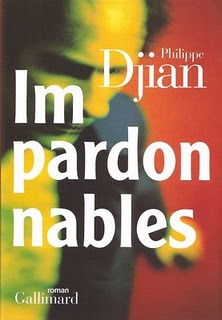 Impardonnables, Philippe Djian
Impardonnables, Philippe Djian

 Béatrix, Balzac
Béatrix, Balzac Antigone(s), Anouilh, Sophocle
Antigone(s), Anouilh, Sophocle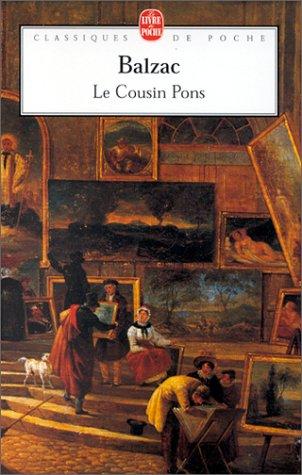 Le Cousin Pons, Balzac
Le Cousin Pons, Balzac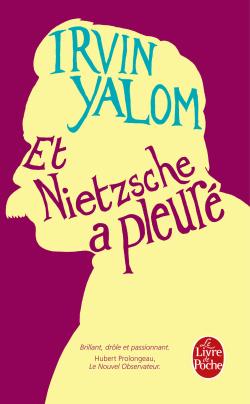 Et Nietzsche a pleuré
Et Nietzsche a pleuré