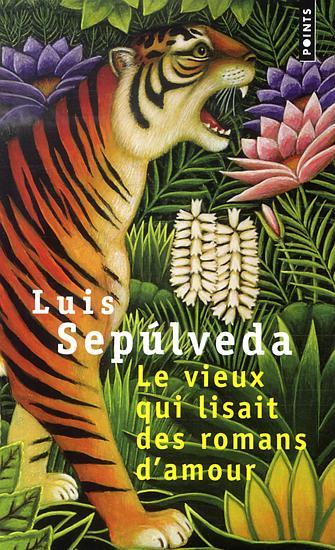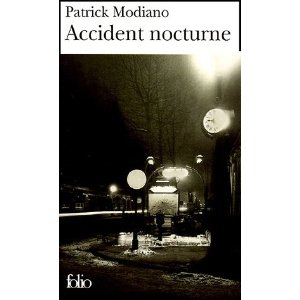Aurélia, Nerval

Voilà un petit ouvrage que j’ai lu avec plaisir, mais qui me laisse impuissante à le résumer. Je suis presque incapable de vous dire ce qu’il se passe dans Aurélia ; et je crois que c’est un peu normal. Le texte est un tissu de rêveries et de délires.
Nerval a perdu son amour ; Gérard a perdu Aurélia, celle qui est Jenny dans la vie réelle. Il l’a perdue et ne s’en remet pas. Dès lors, il sombre dans la folie. Mais une folie productive, une folie poétique, une de ces folies qui font voir des mirages, des monts et des merveilles. Bien que certains des songes de l’auteur soient forts angoissants, d’autres forment une véritable cosmogonie personnelle et innovante, liée à des thèmes qui lui sont chers.
On retrouve une partie de l’univers de Nerval dans ce petit texte inspiré, presque enthousiaste, mais dans un sens plus apollinien que dionysiaque (c’est une histoire d’amour platonique, influencée par des lectures, trop de lectures d’amour, comme Pétrarque et sa Laure, ou Dante et Béatrix). La métempsychose (ou réincarnation, autrement dit la survie des âmes), le syncrétisme (mélange d’influences, qu’elles soient ici culturelles ou religieuses. On sent son penchant pour l’orient et les religions polythéistes), la femme fatale et inaccessible, l’amour des aïeux et des formes anciennes. Le tout sous couvert du rêve. Ce rêve qui se mêle à la réalité, comme l’indique le sous-titre de l’œuvre : Aurélia, ou le rêve et la vie.
Un soir il croise une étoile ; l’Etoile. Peut-être sa seule Etoile, cette étoile qui est morte, dans El Desdichado. Ma seule Etoile est morte… Nouvel Orphée, il se ballade dans la ville, attiré par cette étoile, qu’il souhaite rejoindre. Là se trouvent ceux qui l’attendent.
Ici a commencé pour moi ce que j’appellerais l’épanchement du songe dans la vie réelle. A dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double,- et cela, sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m’arrivait. Seulement mes actions, insensées en apparence, étaient soumises à ce qu’on appelle l’illusion, selon la raison humaine…
Pour lui ce n’est pas de la folie, mais de l’illusion. Toutefois, il semble que les deux se ressemblent. Quand on voit des mirages, quand on perçoit des choses que les autres ne voient pas, c’est qu’on est un peu fou. Ici, cependant, Nerval insiste bien sur la dimension rationnelle qui demeure face à cet état qu’il subit. Il garde la maîtrise, on en a la preuve : il écrit. C’est le rêve, épanouissement quotidien et ordinaire de la psyché humaine, qui prend le pouvoir de son esprit, mêlant réel et imaginaire, comme une autofiction mêle réel et invention littéraire. C’est peut-être un peu cela Aurélia : un mélange de vrai et de faux, de réalité et d’onirisme, aboutissant toutefois à quelque chose de bien réel, mais au-delà du reste : la poésie.
Pourtant, pourtant, ce n’est pas non plus un récit poétique Aurélia. Le genre est hybride, à la frontière. Nerval affectionne le genre hybride de toute façon, la chimère, le mélange. L’odelette, la chanson, la petite forme ; la prose aussi. Le sonnet reste la grande forme, mais les strophes bougent, les vers sont mobiles, on peut composer une chimère avec les Chimères. Il use et abuse des matériaux, comme dans la Bohême Galante et les Petits Châteaux de Bohème. Des poèmes se retrouvent, entiers ; des thèmes sont récurrents, repris sans cesse, en variation, parfois même identiques. Dans Sylvie, pareil, on retrouve des épisodes malheureux de femmes fatales. Bref, Nerval c’est un univers, un univers qui touche au mystique. Un univers dont le cercle n’est pas large mais qui s’élève. Qui s’élève vers les hauteurs mystérieuses de la religion et de l’onirisme.
Des tableaux se succèdent sous ses yeux, créant matière au délire poétique. Ils sont parfois de pures rêveries dont l’auteur se souvient, ou d’autres fois ce sont de véritables hallucinations. Il croit voir Aurélia, plusieurs fois ; à un autre moment, il sent un double de lui-même à ses côtés. Il lui arrive d’avoir peur ; peur de ces songes qui lui font croire à l’existence d’êtres disparus, ou d’êtres qui n’existent pas. Il rêve de monstres, de combats originels, et d’autres fantasmagories.
L’ensemble se ressent de l’esthétique romantique, du microcosme et du macrocosme, de l’interpénétration des énergies. Un romantisme un peu mystique et surtout, cosmique.
Tout vit, tout agit, tout se correspond ; les rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacles la chaîne infinie des choses créées ; c’est un réseau transparent qui couvre le monde, et dont les fils déliés se communiquent de proche en proche aux planètes et aux étoiles. Captif en ce moment sur la terre, je m’entretiens avec le chœur des astres, qui prend part à mes joies et à mes douleurs.
Il se sent une partie du grand Tout, et cherche à unifier ses parcelles éparses.
Mon rôle me semblait être de rétablir l’harmonie universelle par art cabalistique et de chercher une solution en évoquant les forces occultes des diverses religions.
Avec Nerval le poète s’installe dans le rôle du mage désenchanté (rien à voir avec Hugo de ce côté-là), qui s’efforce de lier les énergies entre elles afin de retrouver une harmonie perdue.
Un petit ouvrage étonnant, unique en son genre je crois, qui concentre la poésie de Nerval sous couvert d’onirisme et de prose. Sa poésie est bien tombée dans la prose, mais ça reste sublime. Du beau délire, un vrai kiff (au sens étymologique, donc arabe du terme). Un kiff pour le lecteur, mais pas tellement pour Nerval, qui finira par se suicider en 1855…