La vie est ailleurs, Milan Kundera
Plus je m’y intéresse, plus Kundera me paraît avoir une conception du roman des plus intéressante, parce que des plus subversives (sapant les valeurs établies). Comme il l’explique dans l’Art du roman, le roman soulève des questions auxquelles il ne répond pas, puisque de toute façon, tout est plus complexe qu’on ne le croit. Les personnages sont des égos expérimentaux, des êtres imaginaires que l’auteur manipule à sa guise. Et surtout, le roman a pour vocation de dire ce que lui seul peut dire ; et c’est en cela qu’il est subversion. Qui, autrement que par l’intermédiaire d’un roman (ou peut-être d’un autre support littéraire comme le théâtre, quoi que…) pourrait dire que la politique et l’histoire ne sont qu’une comédie, une tragi-comédie monumentale et dérisoire, une fiction inconsciente ? Et encore pire, comme l’explique le post-facier de La vie est ailleurs (lequel insiste bien sur le fait qu'il serait fallacieux de tenir les ouvrages de Kundera pour des oeuvres de polémique poétique), que la poésie, toute poésie, toute pensée poétique est supercherie ? Terrible sentence que cela, qui fait de ce roman un des plus virulent pamphlet contre la poésie depuis Madame Bovary et Don Quichotte. On pourrait penser qu’alors le roman se renie lui-même. Mais attardons-nous sur ce que veut nous dire Kundera : ses romans n’affirment rien, sinon que toute affirmation est insuffisante. Derrière tout ordre, il y a un désordre, à toute réalité se mêle autant d’irréalité. Il est difficile de prendre conscience de cela, surtout que, si l’on ose aller au bout du raisonnement, la sentence est encore plus irrévocable : derrière la poésie, il n’y a rien… La vie est-elle vraiment ailleurs ?
Quand la mère du poète se demandait où le poète avait été conçu, trois possibilités seulement entraient en ligne de compte : une nuit sur le banc d’un square, un après-midi dans l’appartement d’un copain du père du poète, ou un matin dans un coin romantique des environs de Prague.
Quand le père du poète se posait la même question, il parvenait à la conclusion que le poète avait été conçu dans l’appartement de son copain, car ce jour là tout avait marché de travers.
Jaromil, pour sa mère, est le symbole de tous les possibles ; pour son père, il n’est qu’une erreur de parcours. Mais cette naissance marque pour la mère du poète et Jaromil le début d’une aventure ; ça y est, ils sont pris au piège de la fiction. Et voilà que débute l’âge lyrique (au sens hugolien du terme, le premier âge du poète, celui de l’enfance et de la naïveté. C'était d'ailleurs le premier titre que Kundera voulait donner à son roman). Etat de vie édénique, tout pour le bébé, tout pour ce petit que déjà tout prédestine à devenir un grand artiste. Jaromil dit des phrases rimées (du genre, le grand-papa est vilain, il a mangé le petit pain…)que sa mère s’empresse de recopier dans un carnet puis d’encadrer dans sa chambre ; donc Jaromil est un poète. Jaromil dessine des hommes à têtes de chiens parce qu’il ne sait pas dessiner de visages humaines ; Jaromil est donc un artiste. Sa mère lui fait prendre des cours de dessins, puis couche avec le professeur de dessin. Bref, l'épopée, s'il y a lieu, risque d'être burlesque...!
Le poète est alors à l’affût de tout se qui fait sa vie intérieures ; il essaie de se définir, comme l’écrivain définit son personnage. Mais tout est encore plus complexe qu’on ne croit ! Parce qu’en plus d’être un voyeur poussif et lâche, une lavette dirait-on, Jaromil est double. Et ce double, c’est Xavier. Xavier qui vit plusieurs rêves à la fois, aime plusieurs femmes, fait périr leurs amants qui deviennent des squelettes dans des armoires. Xavier est à l’action ce que Jaromil est à la contemplation. Il est la virilité que Jaromil s’efforce de capter dans le miroir où il ne cesse de contempler son reflet. Jaromil est un bébé, réification de la mère, bloqué à l’âge lyrique, pour qui l’âge épique n’est qu’un horizon lointain se dessinant dans ses rêves et dans les actes d’autrui, de ces autres poètes dont le spectre hante le roman. Pour le poète, le pleutre, l’élu déchu qui pourtant ne fait pas de mauvais vers, la vie est ailleurs. Il va pourtant tenter de s’extirper de cette fange dans laquelle il s’englue (sa mère le tirant par les pieds, telle une Thétis préparant son talon d’Achille). Il rencontre des poètes, des hommes influents ; il essaie de prendre part à la Révolution, il écrit des slogans de révolte, chef de file des étudiants en colère. Certains de ses poèmes sont publiés, certaines femmes à ses pieds. Mais la seule qui l’aime vraiment, c’est la petite rousse, la laide… Pas de chance me direz-vous ? Non, pas de force ni de volonté. Le poète a peur du regard des autres, toujours à l’affût du consentement, du regard qui l’embellit. C’est par les autres et leurs compliments qu’il existe. Sans eux il n’est rien, et se sent mal dans les sociétés hostiles. Il préfère le cadre réconfortant d’une chambre étroite. Le motif de la chambre, où l’on crée, où l’on s’aime, revient à plusieurs reprises dans le roman. Et la chambre de Jaromil a toujours été le lieu où sa mère pouvait le posséder, voulait le posséder, tout entier, sans rivale. La petite rousse n’a d’ailleurs jamais pu y rester… Jusqu’à sa mort, la mère du poète, qui n’a pas d’autre nom, pas d’autre existence que par lui, l’accompagne, et dans son dernier lit, le garde.
Le poète est alors à l’affût de tout se qui fait sa vie intérieures ; il essaie de se définir, comme l’écrivain définit son personnage. Mais tout est encore plus complexe qu’on ne croit ! Parce qu’en plus d’être un voyeur poussif et lâche, une lavette dirait-on, Jaromil est double. Et ce double, c’est Xavier. Xavier qui vit plusieurs rêves à la fois, aime plusieurs femmes, fait périr leurs amants qui deviennent des squelettes dans des armoires. Xavier est à l’action ce que Jaromil est à la contemplation. Il est la virilité que Jaromil s’efforce de capter dans le miroir où il ne cesse de contempler son reflet. Jaromil est un bébé, réification de la mère, bloqué à l’âge lyrique, pour qui l’âge épique n’est qu’un horizon lointain se dessinant dans ses rêves et dans les actes d’autrui, de ces autres poètes dont le spectre hante le roman. Pour le poète, le pleutre, l’élu déchu qui pourtant ne fait pas de mauvais vers, la vie est ailleurs. Il va pourtant tenter de s’extirper de cette fange dans laquelle il s’englue (sa mère le tirant par les pieds, telle une Thétis préparant son talon d’Achille). Il rencontre des poètes, des hommes influents ; il essaie de prendre part à la Révolution, il écrit des slogans de révolte, chef de file des étudiants en colère. Certains de ses poèmes sont publiés, certaines femmes à ses pieds. Mais la seule qui l’aime vraiment, c’est la petite rousse, la laide… Pas de chance me direz-vous ? Non, pas de force ni de volonté. Le poète a peur du regard des autres, toujours à l’affût du consentement, du regard qui l’embellit. C’est par les autres et leurs compliments qu’il existe. Sans eux il n’est rien, et se sent mal dans les sociétés hostiles. Il préfère le cadre réconfortant d’une chambre étroite. Le motif de la chambre, où l’on crée, où l’on s’aime, revient à plusieurs reprises dans le roman. Et la chambre de Jaromil a toujours été le lieu où sa mère pouvait le posséder, voulait le posséder, tout entier, sans rivale. La petite rousse n’a d’ailleurs jamais pu y rester… Jusqu’à sa mort, la mère du poète, qui n’a pas d’autre nom, pas d’autre existence que par lui, l’accompagne, et dans son dernier lit, le garde.
Un roman étonnant, parfois déstabilisant. La narration est simple, le ton léger, presque biblique parfois. Presqu’un conte pour enfant. Mais une fois qu’il arrive à l’âge adulte, Jaromil devient fortement antipathique. Il se débat dans sa turbulette enfantine (robe de chambre pour nourrisson, dans laquell il est impossible de marcher...), et cette violence se répercute sur autrui. Son apprentissage timide de l’amour se termine par une trahison envers celle qui l’y a initié. Il devient méprisant envers le peintre dont jusqu’alors il avait imité tous les discours. Un enfant criard, pleurnichard, souillé, ça n’est plus très édénique… Jaromil est le Rimbaud tchèque, qui fugue, court, s’enfuit et haïe sa mère, dans les bras de laquelle il retombe ensuite. Le voyant au milieu de la Révolution communiste. Et puis la sixième partie, comme une respiration (je ne vous en dirais pas plus), les interventions de l’auteur en métalepses (quand la narrateur prend la parole dans son oeuvre).
Regardons encore un instant Jaromil assis devant un demi de bière en face du concierge ; derrière lui, s’étend au loin le monde clos de son enfance, et devant lui, incarné par son ancien camarade de classe, le monde des actes, un monde étranger qu’il redoute et auquel il aspire désespérément.
Tout cela est beau, étonnant. Des fragments, un découpage en parties, des morceaux de vers, des aspérités parfois coupantes dissimulées sous des phrases sucrées et l’aveuglement de Jaromil. Parce que derrière tout ça, derrière la pleutrerie et le ridicule, il y a ce constat cinglant, dérangeant : la poésie est une vaste supercherie, qui tente de redonne espoir dans un monde où histoire et politique ne sont que tragi-comédie. Et derrière la poésie, le lyrisme, l’affirmation la plus grande de son intériorité, il n’y a rien…
La poésie est un territoire où toute affirmation devient vérité. Le poète a dit hier : la vie est vaine comme un pleur, il dit aujourd’hui : la vie est gaie comme le rire et à chaque fois il a raison. […] Le poète n’a besoin de rien prouver ; la seule preuve réside dans l’intensité de son émotion.
Pour Kundera, le lyrisme (expression poétique par essence) est une rhétorique vide et superflue, à cause de laquelle l'auteur, lorsqu'il emprunte cette voie, risque de se laisser aller à la confession ou à l'autobiographie déguisée. Alors que le romancier, libre et ironique, doit justement éviter de se laisser prendre au piège du langage. (J'ai trouvé récemment cette précision sur Kundera, qui m'a semblée des plus éclairantes)
Pour Kundera, le lyrisme (expression poétique par essence) est une rhétorique vide et superflue, à cause de laquelle l'auteur, lorsqu'il emprunte cette voie, risque de se laisser aller à la confession ou à l'autobiographie déguisée. Alors que le romancier, libre et ironique, doit justement éviter de se laisser prendre au piège du langage. (J'ai trouvé récemment cette précision sur Kundera, qui m'a semblée des plus éclairantes)
Tout semble n’être qu’apparence et illusion, interprétation et faux-semblants. Et si c’était vraiment cela, la réalité ? Dans le roman, c’est l’auteur qui rattrape le personnage, le prend au piège, le fait vivre, aimer, et parfois le tue. Dans la vie, c’est ce qu’on prend pour la réalité qui nous rattrape ? Alors on rêve d’un ailleurs, d’un endroit meilleur… Mais il n’y a pas d’issue.
Pourtant il faut vivre, quelque absurde que nous apparaisse la vie. Le suicide serait une gageure : réussi, il est pathétique ; raté, il est ridiculement comique. (remarques de Kundera qui m’ont paru particulièrement intéressantes et troublantes !) Il fait se rejoindre les deux pans de l’absurde. Alors, au lieu de quitter cette vie, cherchons là ailleurs. Pourquoi pas dans les romans… C’est peut-être cela que signifie le titre : la vie est ailleurs, sur les pages blanches, entre les lignes.
(C'est cela que Flaubert dénonçait dans Madame Bovary... Serions-nous bel et bien face à une aporie?!)
(C'est cela que Flaubert dénonçait dans Madame Bovary... Serions-nous bel et bien face à une aporie?!)


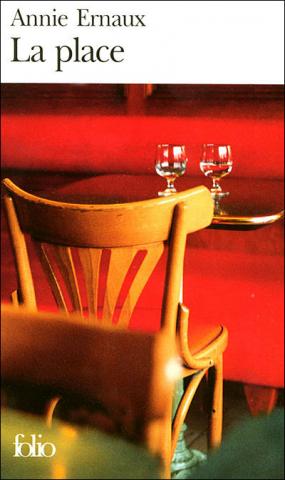 La Place, Annie Ernaux
La Place, Annie Ernaux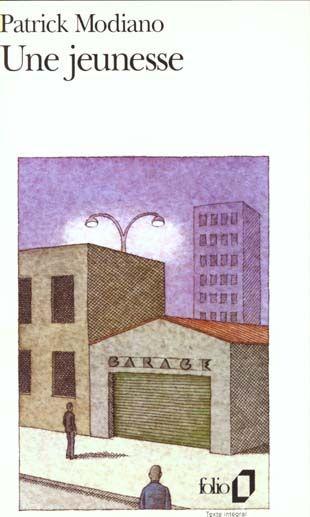 Une jeunesse, Patrick Modiano
Une jeunesse, Patrick Modiano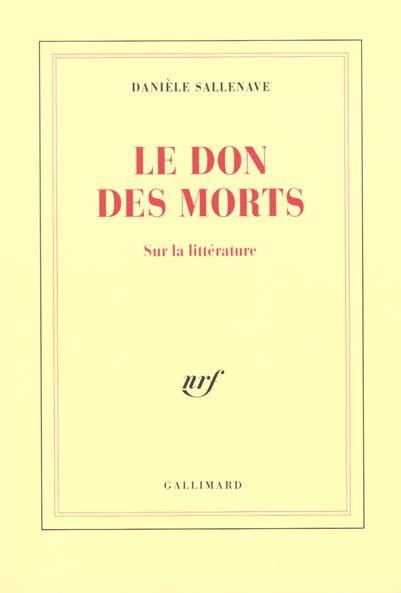 Le Don des Morts, Danièle Sallenave
Le Don des Morts, Danièle Sallenave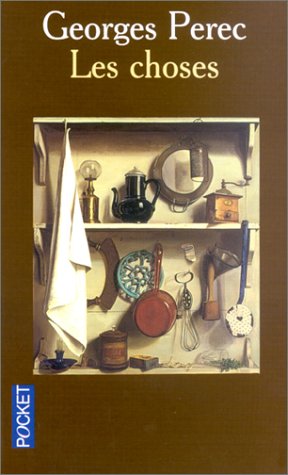 Les Choses, Georges Perec
Les Choses, Georges Perec