Le Monde dans les Livres
Mercredi 16 mars 2011 à 21:56
Mardi 22 mars 2011 à 0:33
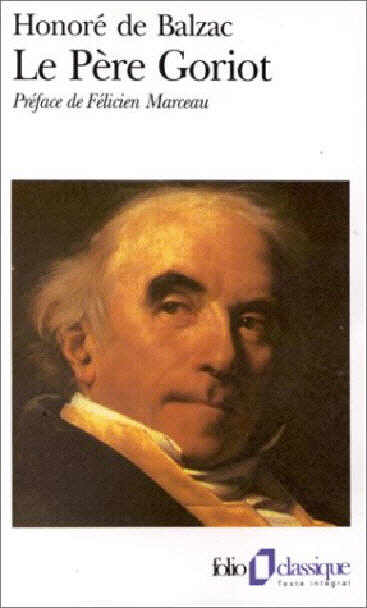 Le Père Goriot, Honoré de Balzac
Le Père Goriot, Honoré de Balzac Nous disions père pour Eugène... Et bien oui, en quelque sorte! puisque grâce au Père Goriot, il a pu se rapprocher de Madame de Nucingen, et se faire une place dans le grand monde au bras de cette belle, riche et influente maîtresse. Certes il est aidé en cela par ses liens de parentés avec Madame de Bauséant, grande amie de la Duchesse de Langeais soit dit en passant, qui dès ce roman évoque ses velléités moniales, et ses peines de cœur avec son capitaine. Comme quoi, tout se recoupe, et c’est là qu’on mesure l’importance du Père Goriot dans la Comédie Humaine. Le retour des personnages, belle invention tout de même, et grand plaisir de lecteur !
Mercredi 6 avril 2011 à 0:07
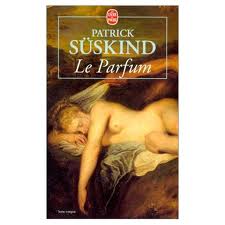 Le Parfum, Patrick Süskind
Le Parfum, Patrick SüskindMardi 31 mai 2011 à 23:58

L’inverse eut pu être vrai ; Sido aurait pu écrire Colette ; ou plutôt Colette, le capitaine, aurait pu écrire Sido. Vraiment. Le père de Colette était effectivement écrivain ; enfin il a essayé. On a retrouvé des carnets, dont les pages étaient blanches. Un mirage d’écrivain.
Finalement c’est sa fille, Colette (Sidonie-Gabrielle de son vrai nom) qui est devenue écrivain, et qui a écrit cette autobiographie. Mais Sido, ça n’est pas la petite fille, ça n’est pas l’auteur ; c’est sa mère. Sido c’est le centre de la rose des vents, le centre des points cardinaux, le point focal de la famille, la prêtresse du jardin, l’âme de la famille ; et le sujet du livre.
Où est l’autobiographie alors ? Et bien à travers le portrait de Sido, cette femme remariée, qui a déjà deux enfants, les sauvages de la dernière partie, Colette se construit. Mais aussi à travers le portrait du Capitaine, son père. La petite Colette se dessine en creux, via une hétérographie poétique, où l’écriture transporte, charme, perd parfois. Un style qui m’a perdue, peut-être parce que je l’ai lu de manière décousu, alors qu’un tel livre, bien qu’il soit court, requiert une attention de tous les instants. Chaque détail compte, chaque fleur, chaque couleur. La ville, la province, les goûts, les aspirations des divers personnages s’opposent mais se rejoignent finalement, pour fonder la famille de Colette et, dans l’ombre, l’image de l’auteur.
Je n'ai pas lu ce livre avec suffisamment d'attention... D'où l'évaporation des mots qui devaient en parler. Je le relirai. Et j'écrirai à nouveau. Je n'aime pas bâcler... J'ai tenté de restituer l'essentiel.
Mercredi 29 juin 2011 à 22:58

Des dates, un narrateur, de la fièvre, des cauchemars, des phénomènes étranges. C’est ce que l’on découvre au fil de cette nouvelle, sous forme de journal intime. Celui d'un narrateur qui sent monter en lui la fièvre et la folie. La nuit il fait des cauchemars, seul dans sa maison. Il a l’impression que quelqu’un est là, au-dessus de lui, qui l’épie, qui le guette. La nuit devient pour lui une menace. Il consulte le médecin mais rien à faire ; l’angoisse et la fièvre persistent.
Cette nuit, j’ai senti quelqu’un accroupi sur moi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s’est levé, repu, et moi je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer.
Il y a quelqu’un. Cette personne, cet être, n’est pas identifié. Peut-être pas identifiable. Là réside le mystère. Ce qui arrive est-t-il réel ou tout droit sorti de l’imaginaire du personnage ? Là se situe la frontière entre le merveilleux et la réalité, une terra incognita qu’on appelle le fantastique.
Au lieu de conclure par ces simples mots : « Je ne comprends pas parce que la cause m’échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles.
Telle est la puissance de l’imaginaire humain…
Cette nouvelle est purement fantastique dans la mesure où on balance sans cesse entre l’explication rationnelle et la pure fiction. Ce qui arrive au narrateur est déroutant. Certes on peut penser qu’il s’agit bien de cauchemars liés à la fièvre, au début. Mais dès lors qu'il réalise certaines expériences, on se voit dans l’obligation de douter.
6 juillet.- Je deviens fou. On a bu toute ma carafe cette nuit ;- ou plutôt, je l’ai bue ! Mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? Oh ! mon dieu ! Je deviens fou ! Qui me sauvera ?
10 juillet.- Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou ! Et pourtant ! Le 6 juillet, avant de me coucher, j’ai placé sur ma table du vin, du lait, de l’eau, du pain et des fraises. […] Le 9 juillet enfin, j’ai remis sur ma table l’eau et le lait seulement, en ayant soin d’envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j’ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L’invincible sommeil m’a saisi, suivi bientôt de l’atroce réveil. Je n’avais point remué ; mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons, en palpitant de crainte. On avait bu toute l’eau ! On avait bu tout le lait ! Ah ! mon Dieu !... Je vais partir toute à l’heure pour Paris.
Niveau protocole expérimental, il n’a rien à envier à la science, ou presque. Pourtant, malgré toutes ces précautions, les résultats sont plus que troublants. Dès lors, soit on estime que ce qui se passe a une origine surnaturelle, soit est issu de l’imagination fertile et un peu maladive du personnage (et par extension, du romancier). Une valse hésitation, qui permet de ranger ce texte dans le troublant tiroir du fantastique.
Peu à peu le narrateur parvient à mieux cerner celui qui le hante, et presque à le voir. Il dit rester lucide sur sa condition, être un halluciné raisonnant. Comme Nerval dans Aurélia, il semblerait que le personnage tienne à que ce qu’il avance ne passe pas pour la folie d’un fou. Il tient à convaincre le lecteur, ou plus probablement lui-même, que ce qui lui arrive n’est pas une farce de son imaginaire, mais le fait d’un être qui existe réellement. Cet être, c’est le Horla.
Malheur à nous ! Malheur à l’homme ! Il est venu, le…le…comment se nomme-t-il…le…il me semble qu’il me crie son nom, et je ne l’entends pas…le…oui…il le crie… J’écoute… je ne peux pas…répète… le… Horla… J’aientendu… le Horla… c’est lui… le Horla… il est venu !...
Bien que ce soit un journal, il semble que les impressions du narrateur soient saisies sur le vif, au moment même où il les vit. Ce peut être le cas. C’est le principe du journal ; saisir sur le vif les évènements de la journée. Tout est orchestré par cette angoissante folie qui s’empare du personnage, et rend l’histoire palpitante, haletante, un peu effrayante… On ne sait que croire, et c’est ça qui est prenant.
Cet être, ce Horla, l’oppresse, le poursuit. Il essaie de le fuir, part en voyage, s’échappe, s’évade. Mais s’il est dans sa tête, difficile de l’en déloger. S’il est dans sa maison, le mieux est d’y mettre le feu. Mais s’il est dans sa tête… ne reste que le suicide…

